📚 Révise ton bac en podcast ici ! 🎧
Rire et farce dans Gargantua
Polynésie française 2022 • Dissertation
fra1_2206_13_03C
Polynésie française, juin 2022 • Dissertation
4 heures
Intérêt du sujet • Le sujet vous invite à réfléchir aux différents aspects du comique rabelaisien et à montrer comment celui-ci s’avère porteur d’une vision du monde.
Dans le roman de Rabelais, Gargantua , pensez-vous que le rire ne soit que de l’ordre de la farce ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur Gargantua , sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.

Les clés du sujet
Analyser le sujet.

Formuler la problématique
Le génie comique de Rabelais se limite-t-il au seul déclenchement d’un rire farcesque, reposant sur un comique bas et grossier ?
Construire le plan

Les titres en couleur ou entre crochets ne doivent pas figurer sur la copie.
Introduction
[Accroche] « Le grand rire de Rabelais est un phénomène unique dans la littérature de tous les temps et à côté de lui, Aristophane, Boccace, Molière font figure de croque-morts » : ces mots de Marcel Aymé saluent la singularité de l’auteur de Gargantua . Dès l’« Avis aux lecteurs », le ton est effectivement donné : Rabelais place Gargantua sous le signe du rire. [Explication du sujet] Cependant, la question posée par le sujet semble suggérer que ce rire est plus complexe qu’il n’y paraît. [Problématique] Le génie comique de Rabelais se limite-t-il au seul déclenchement d’un rire farcesque, reposant sur un comique bas et grossier ? [Annonce du plan] Si l’œuvre joue en effet sur un comique farcesque [I] , elle fait aussi du rire un outil de réflexion critique [II] , pour en définitive le mettre au service de la philosophie humaniste [III] .
I. Un rire farcesque
1. des personnages et des situations hauts en couleur.
Les personnages de la farce sont dénués de complexité. C’est le cas des personnages de Gargantua : des géants , issus du folklore populaire, qui se prêtent à tous les excès. Le comique naît de leur démesure , perceptible par exemple dans l’évocation de la quantité de nourriture ou de boisson avalée… ou évacuée – il faut ainsi 17 900 vaches pour allaiter dignement Gargantua qui, à peine né, hurle : « À boire, à boire ! »
La farce se caractérise également par une intrigue schématique, jouant essentiellement sur l’ opposition entre la bêtise et la ruse , laquelle finit par triompher. Certains chapitres de Gargantua s’inscrivent délibérément dans cette veine farcesque , tels ceux relatant le vol des cloches de l’église Notre-Dame par Gargantua et les manœuvres plaisantes de Janotus de Bragmardo pour les récupérer. Ivre, le théologien cherche maladroitement à reprendre possession des cloches que le géant compte accrocher au cou de sa jument, « grande comme six éléphants ».
Rabelais s’inspire ici d’une farce du xv e siècle, La Farce de Maître Pathelin, où la ruse triomphe au détriment des benêts qui sont dupés.
D’autres épisodes reposent sur un comique de situation efficace : ainsi, l’ingestion impromptue par Gargantua de pèlerins cachés dans une salade interrompt avec humour la guerre picrocholine.
2. Grossièretés et obscénités
Le roman s’inspire du registre de la farce par ses nombreuses allusions grivoises qui ont valu à Rabelais une réputation d’obscénité et de paillardise. Le « bas corporel » est omniprésent : c’est en faisant « la bête à deux dos » que les parents de Gargantua le conçoivent. Une orgie de tripes précipite – diarrhée et astringent puissant aidant ! – la naissance du géant, narrée avec force détails peu ragoûtants.
Rabelais pousse la grossièreté jusqu’à l’outrance . L’épisode du « torchecul » repose ainsi sur l’énumération malicieuse et fantaisiste des expériences de Gargantua pour trouver le meilleur moyen de se nettoyer les fesses. Plus loin, un déluge d’insultes grossières, listées avec une jubilation manifeste, contribue au déclenchement de la guerre contre Picrochole.
II. Un rire subtil
1. une langue créative.
Cependant, au-delà du foisonnement des grossièretés farcesques, la langue de Rabelais frappe par sa créativité et le travail dont elle est l’objet , source de multiples effets comiques.
Les litanies fantaisistes, les galimatias, les jeux de mots témoignent d’une érudition de l’auteur dans des domaines variés . L’obscénité scatologique de l’invention du torche-cul, par exemple, se mêle au lexique médical spécialisé : « rectum », « périnée », « consoude ».
Gargantua atteste également de la grande curio sité linguistique de Rabelais, qu’il utilise à des fins comiques. L’auteur mélange ainsi à l’envi les différentes langues (français, grec, hébreu, latin, italien…) et invente de nouveaux mots, tel le terme « agélaste ». Sa maîtrise linguistique lui permet de désacraliser ces langues : Janotus écorche le latin lors d’une harangue qui se devait d’être solennelle, et qui, au lieu de cela, fait sourire.
Composé du préfixe privatif a et du grec « gelos » ( rire ), le néologisme « agélaste » désigne celui qui ne sait pas rire, et que fustige Rabelais.
Les noms des personnages eux-mêmes portent souvent un sens caché qui signale la culture de l’auteur et ridiculise leurs porteurs : il en est ainsi de Thubal Holopherne, « grand sophiste », précepteur de Gargantua, qui lui apprend à réciter les textes « par cœur et à l’envers ». Thubal signifie « confusion » en hébreu, tandis que Holopherne évoque le général de Nabuchodonosor II, cruel persécuteur des Juifs.
2. Un comique parodique et critique
Rabelais intègre de fait dans Gargantua de multiples références, qu’il parodie volontiers de manière à susciter une réflexion critique. Ainsi en est-il de l’épisode de la guerre picrocholine qui revisite, sur un ton burlesque, les romans de chevalerie. À travers le récit de ce conflit déclenché par une vulgaire querelle à propos de fouaces, le lecteur est invité à méditer sur ce qui peut légitimer la guerre ; le personnage de Picrochole, dangereux mais risible, lui permet de s’interroger sur l’attitude du bon souverain .
La création de personnages caricaturaux , simplifiés à l’extrême, permet à Rabelais d’épingler les vices et impostures de son époque. Ainsi le narrateur ironise-t-il sur les errances pédagogiques de Thubal Holopherne, piètre précepteur aux méthodes surannées, qui ne parvient qu’à abrutir son élève.
Le rire est donc porteur d’une intention critique et contestataire . Les mauvais religieux tombent ainsi sous le coup de la satire , depuis les théologiens incompétents, « vieux tousseux », jusqu’aux pèlerins abreuvés de superstitions, en passant par les moines inutiles qui ne sont que des « mâche-merdes », des fardeaux pour la société.
Au xviii e siècle, Voltaire met également le rire au service de la satire , dans des contes philosophiques tels que Zadig (1748) et Candide (1759).
III. Un rire humaniste
1. le rire : une voie d’accès à la pensée.
Dès le prologue, le facétieux Maître Alcofribas invite le lecteur à ne pas se fier aux apparences légères de son livre ; mais à les dépasser pour accéder au sens caché, à « la substantifique moëlle ». Rabelais agit ici en humaniste : il sait son lecteur capable d’interpréter le comique farcesque de son récit.
Amené, grâce au rire, à penser par lui-même , le lecteur forge sa propre vision du monde, se méfiant des préjugés et des savoirs imposés. L’épisode du torchecul, au-delà de la farce, peut aussi se lire comme la démonstration de l’ingéniosité d’un enfant qui expérimente et trouve par lui-même le moyen de s’humaniser, de se départir d’une part d’animalité.
2. Le rire au service d’une nouvelle vision de l’homme
Instrument qui aiguise l’intelligence du lecteur, le rire rabelaisien s’inscrit aussi dans une éthique de vie . À rebours des préjugés du Moyen Âge, Rabelais réhabilite le rire, car il croit en ses vertus thérapeutiques et l’associe à la santé physique et mentale. Au Moyen Âge, le rire est frappé de suspicion et souvent condamné par la religion : associé aux désordres corporels, voire au diable, il éloignerait de Dieu et serait signe de déchéance.
Le roman d’Umberto Eco Le Nom de la rose (1980) évoque ce rejet du rire : au xiv e siècle, un moine bibliothécaire cache le second tome de la Poétique (335 av. J.-C.) d’Aristote sur la comédie, afin que nul n’en prenne jamais connaissance.
S’inspirant d’Aristote, Rabelais précise dans son « Avis aux lecteurs » que « Mieux est de rire que de larmes écrire, / Parce que rire est le propre de l’homme ». Le rire, y compris dans sa forme farcesque, permet donc au lecteur de se délivrer de ses peines et de ses peurs. Le rire apaise, prépare l’homme à la réflexion et, in fine , à devenir un humaniste accompli .
Le roman invite finalement à cultiver une foi joyeuse en la vie : il se clôt sur l’invitation de Frère Jean à faire « grand chère », en écho à l’injonction qui termine l’« Avis aux lecteurs » : « Vivez joyeux ».
[Synthèse] Farcesque, mais riche de sens, le rire rabelaisien s’affiche comme un parti pris aux multiples vertus. Divertissant, il n’en est pas moins élaboré. Il recèle un « plus haut sens » et s’insère dans un jeu critique qui invite le lecteur à penser par lui-même, au-delà des apparences trompeuses. [Ouverture] Admiratif de « l’éclat de rire énorme » de Rabelais, Victor Hugo y voit, au xix e siècle, « un des gouffres de l’esprit » ( Les Contemplations, 1856).
Pour lire la suite
Et j'accède à l'ensemble des contenus du site
Et je profite de 2 contenus gratuits
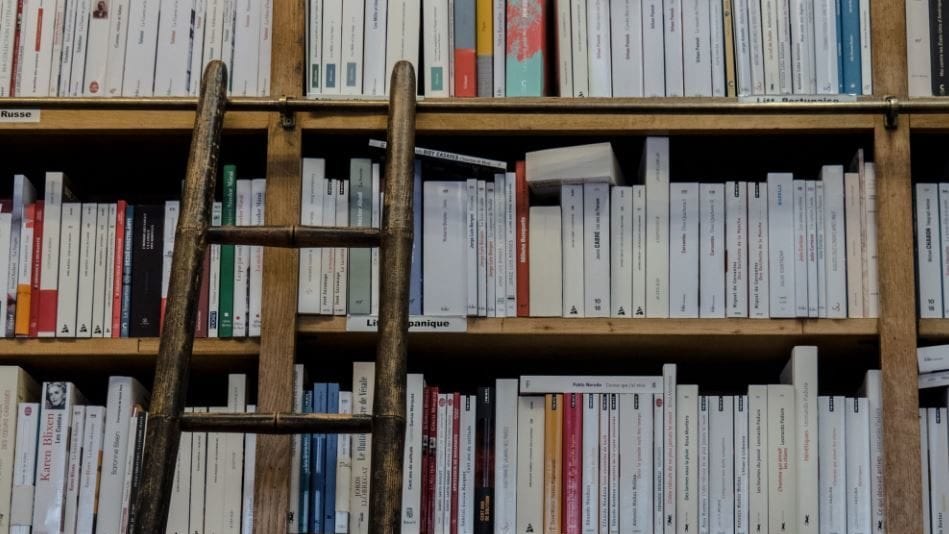
Commentaire et dissertation
Gargantua dissertation.
Nous proposons ici une dissertation sur Gargantua ( résumé chapitre par chapitre ICI ) de l’auteur humaniste Rabelais qui porte sur la question posée par le parcours associé « rire et savoir » . Ci-après, la problématique et le plan détaillé de la dissertation.
GARGANTUA DISSER TATION: SUJET
Sujet: Gargantua de Rabelais a-t-il pour fonction de nous amuser ou bien de nous instruire?
Problématique: Gargantua peut-il être réduit à une oeuvre légère?
1. Une oeuvre pour rire
A. gargantua: une oeuvre comique.
D’abord, l’oeuvre s’ouvre sur une formule qui annonce un programme comique: « Mieux est de ris que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l’homme ». Il s’agit donc bien de divertir le lecteur.
B. Rire et gauloiserie
Effectivement, Rabelais recourt au rire grossier à plusieurs reprises. Il est souvent provoqué par des moments épiques. Ainsi, nous pouvons citer le nombre de vaches servant à l’allaitement « dix sept mille neuf cent treize vaches » ou le nombre d’hommes abattus par Frère Jean « treize mille six cent vingt deux ». C’est l’ hyperbole qui crée un effet comique.
C. Le carnavalesque
En effet, Rabelais s’inscrit dans une tradition du rire. Ainsi, comme au théâtre, l’oeuvre relate des destructions et autres métamorphoses. Par exemple, l’ennemi de Gargantua, Picrochole, finit piteusement, après avoir livré une bataille sans merci à ses adversaires.
2. Un rire satirique
Dans Gargantua , Rabelais emploie également le rire à des fins de dénonciation.
A .L’église
D’abord, Rabelais dénonce l’indifférence du clergé face aux guerres qui apportent angoisse et désolation.
B. Dénonciation des croyances
Ensuite, Rabelais dénonce dans Gargantua des superstitions s’opposent fondamentalement aux valeurs de l’Eglise auxquelles adhère Rabelais. (Voir sa biographie)
C. Pour davantage de compassion
Enfin, Rabelais dénonce l’indifférence face à la souffrance individuelle et invite à davantage de compassion.
3. Gargantua : une oeuvre profonde
A. rire et satire.
Or, le rire vise également les professeurs sophistes, Rabelais les caricature. Ainsi, ces hommes se trouvent noyés dans l’urine de Gargantua.
B. Rire et épicurisme
Les héros sont des géants. Ils ont un gros appétit ce qui devient prétexte au détournement de certains préceptes tels que « la nature a horreur du vide » ( prétexte à faire bonne chère et à profiter des bonnes choses.)
C. Des valeurs humanistes
Dans Gargantua , Rabelais se fait le fer de lance de l’ Humanisme . Il y défend, notamment dans l’épisode de l ‘abbaye de Thélème , une nouvelle vision de l’éducation. En effet, il souhaiterait que davantage de place soit accordée à la réflexion et à l’épanouissement de l’élève plutôt que d’apprendre par coeur des phrases toutes faites.
GARGANTUA DISSERTATION: LA CONCLUSION
L’oeuvre de Rabelais est plus riche et complexe qu’il n’y paraît. Elle ne peut être réduite à un rire grossier car elle propose une satire mordante de l’époque et définit même une vision plus humaine pour l’avenir.
Nous espérons que cette fiche « GARGANTUA DISSERTATION » a pu t’aider. D’autres cours peuvent t’intéresser:
– Biographie de Rabelais
– Explication de texte (épisode de l’Abbaye de Thélème)
– Fiche sur l’Humanisme
2 réflexions sur « GARGANTUA DISSERTATION »
Le sujet invite à choisir un plan dialectique, ce que vous n’avez pourtant pas choisit faire : pourrait-on imaginer un plan du type: I) De toute évidence, Gargantua est une œuvre comique II) Toutefois, le sujet de l’éducation et de l’apprentissage est au cœur de la « chronique » III) Au-delà de cette opposition, ce livre d’Alcofribas Nasier invite le lecteur à se demander comment allier le rire et l’apprentissage. D’après Rabelais, il faut savoir rire et rire du savoir : les deux sont liés
Bonjour Pierre, Merci de cette réflexion. Le plan est tout à fait intéressant, il n’y a, heureusement, pas de plan ou de corrigé unique. Le vôtre est très pertinent.
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .
Pour s'améliorer en français
J'ai un compte, je me connecte !
Pas de compte ? Création gratuite !
Réinitialiser mon mot de passe !
Inscription
Créez un compte pour continuer..

Gargantua François Rabelais 5 sujets de dissertation possibles au bac de français
Vincenzo Foppa, Jeune Cicéron lisant, 1464.
Le site existe grâce à vous !
⇨ * 🎞️ Diaporama présentant les 5 sujets de dissertation *
- Préparer l'épreuve anticipée de français bac 2024
- "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle" Bac 2024
Disserter sur une oeuvre intégrale bac Gargantua, Les Caractères, La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Littérature d'idées
Rabelais, gargantua, la bruyère, les caractères, olympe de gouges, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, litterature d'idees , olympe de gouges déclaration des droits de la femme et de la citoyenne "écrire et combattre pour l'égalité".
Oeuvre : Olympe de Gouges Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Parcours bac : "Écrire et combattre pour l'égalité"
Savoir disserter sur une oeuvre intégrale du programme bac séquence "Littérature d'idées"
4 sujets pour s'entrainer à disserter sur La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges
Consulter les 4 sujets
La Bruyère, "Les Caractères", livres V à X Parcours : "La comédie sociale".
Oeuvre : La Bruyère, "Les Caractères", livres V à X
Parcours : "La comédie sociale".
4 sujets pour s'entrainer à disserter sur La Bruyère, Les Caractères
Rabelais, "Gargantua" Parcours : "Rire et savoir".
Oeuvre : Rabelais, "Gargantua"
Parcours : "Rire et savoir".
4 sujets pour s'entrainer à disserter sur Gargantua de Rabelais
Le programme du bac de français 2021
Montaigne, essais, «des cannibales», «des coches».
Œuvre : Montaigne, Essais, « Des Cannibales », « Des Coches »
Parcours : « Notre monde vient d’en trouver un autre »
9 sujets corrigés pour s'entrainer à disserter sur les Essais de Montaigne
Consulter les 9 sujets corrigés
Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) Parcours : Imagination et pensée au XVIIe siècle
Œuvre : Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI)
Parcours : Imagination et pensée au XVIIe siècle
3 sujets corrigés pour s'entrainer à disserter sur les Fables de La Fontaine
Consulter les 3 sujets corrigés
Œuvre : Voltaire, L'Ingénu Parcours : Esprit des Lumières
Œuvre : Voltaire, L'Ingénu
Parcours : Esprit des Lumières
1 sujet corrigé pour s'entrainer à disserter sur L'Ingénu de Voltaire
Consulter la correction du sujet
Oeuvre : Montesquieu, Lettres persanes Parcours : Le regard éloigné.
Oeuvre : Montesquieu, Lettres persanes
Parcours : Le regard éloigné.
2 sujets corrigés pour s'entrainer à disserter sur Les Lettres Persanes de Montesquieu
Consulter la correction des deux sujets
"La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle" Bac 2023
La Bruyère Les Caractères livres V à X/Parcours La comédie sociale-livre XI De l'Homme/Parcours Peindre les Hommes 5
Rabelais, "Gargantua" / Parcours : "Rire et savoir"/ Parcours : "La bonne éducation". bac 2024 0
Olympe de Gouges, "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (du "préambule" au "postambule") / Parcours : "Écrire et combattre pour l'égalité". 13
La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Rousseau, Emile ou de l'éducation bac 2022
La littérature d'idées du xvie siècle au xviiie siècle bac 2021.
Montaigne, les Essais.Découverte d'un autre monde 15
Montesquieu, "Lettres persanes" / parcours : Le regard éloigné 6
Le mythe du bon sauvage. Qu'est-ce que l'état de nature? 7
Dissertations sur des oeuvres au programme, littérature d'idées 18
Voltaire, "L'Ingénu" "Candide"/ parcours : Voltaire, esprit des Lumières. EAF 2021 5
Jean de La Fontaine, "Fables" (livres VII à XI) / parcours EAF 2021 : Imagination et pensée au XVIIe siècle. 11
Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, chapitre XIII, commentaire littéraire, littérature d'idées, EAF 2021
Etude linéaire de léry, histoire d’un voyage fait en la terre de brésil, ch 18 : comment raconte-t-il une histoire dont il connaît déjà le dénouement.
Date de dernière mise à jour : 07/05/2023
Ajouter un commentaire
- Quiz bac sur les études linéaires Montaigne les Essais, littérature d'idées
- Quiz ton bac de français : Marivaux, L'Île des esclaves/parcours maîtres et valets
- Quiz ton bac de français:Olympe de Gouges La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- Quiz ton bac de français Gargantua Rabelais, "Rire et savoir", "la bonne éducation"
- Quiz bac. Es tu prêt pour l'oral du bac de français?
- Quiz Rimbaud "Cahiers de Douai", parcours "Emancipations créatrices"
- Quiz ton bac de français : Molière, le Malade imaginaire, parcours spectacle et comédie
- Quiz ton bac de français : Marivaux, les Fausses Confidences, parcours "théâtre et stratagème"
- Quiz ton bac : La Bruyère les Caractères "comédie sociale", "peindre les hommes"
- Exercices bac Lagarce Juste la fin du monde crise personnelle/crise familiale
- Quiz ton bac J. Verne Voyage au centre de la Terre/parcours Science et fiction
- Quiz ton bac Sarraute Enfance parcours Récit /connaissance de soi
- Quiz ton bac Stendhal Le Rouge et Noir/parcours Le personnage de roman, esthétiques, valeurs
- Quiz ton bac de français, Yourcenar Mémoires d'Hadrien Soi-même comme un autre
- Quiz Guillaume Apollinaire Alcools parcours Modernité poétique
- Quiz Hugo, Les Contemplations livres I à IV parcours Les Mémoires d'une âme.
- Quiz Baudelaire les Fleurs du mal parcours bac Alchimie poétique la boue et l’or.
- Quiz sur Manon Lescaut, l'abbé Prévost, étude du roman bac EAF 2023, parcours/personnages en marge, plaisirs du romanesque
- Quiz Colette Sido, Les Vrilles de la vigne. La célébration du monde
- Quiz Balzac La Peau de chagrin–Les romans de l'énergie, création et destruction
- Quiz Balzac Mémoires de deux jeunes mariées, parcours "Raison et sentiments"
- Quiz ton bac en philosophie. Les auteurs, les séquences, les devoirs bac
- HLP classe de première, Humanités, Littérature, Philosophie, les pouvoirs de la parole et les représentations du monde
- Quiz bac. L'écrit de français. Exercices sur les procédés d'écriture pour réussir tes commentaires
- Quiz Hélène Dorion, Mes forêts Parcours bac : la poésie, la nature, l'intime
- Quiz La Rage de l'expression Ponge, parcours "Dans l'atelier du poète"

- Aide aux devoirs
Sujets de dissertation sur Gargantua de Rabelais et le parcours Rire et savoir
Le rire chez Rabelais n’est-il qu’un amusement ?
Plan détaillé:
I. Le rire comme amusement
A. La présence du burlesque et de l'exagération
B. L'usage des jeux de mots et de la parodie
II. Le rire comme vecteur de critique sociale
A. La satire des institutions et des personnages
B. Le rire pour souligner l'absurdité et l'injustice
III. Le rire comme pédagogie
A. La transmission de valeurs et de savoir à travers le rire
B. L'apprentissage par l'humour et le plaisir
Est-ce que la soif de savoir passe exclusivement par le rire dans Gargantua ?
I. L'apprentissage par le rire
A. L'humour comme moyen de vulgariser le savoir
B. Le plaisir du rire qui stimule la curiosité
II. D'autres vecteurs de savoir dans Gargantua
A. L'usage de la parodie et de la satire pour transmettre des messages
B. La valeur instructive des aventures et des personnages
III. L'ensemble du projet pédagogique de Rabelais
A. Le rire comme composante d'une méthode d'apprentissage plus large
B. L'importance de l'équilibre entre amusement et sérieux dans l'éducation
Si le rire dans le roman de Rabelais se veut constructif, n’est-il pas aussi destructeur ?
I. Le rire comme force constructive
A. La construction d'un esprit critique à travers le rire
B. L'usage du rire pour stimuler l'apprentissage et la curiosité
II. Le rire comme force destructrice
A. Le rire qui dénonce et détruit les travers de la société
B. L'humour noir et la satire, formes de rire destructrices
III. L'équilibre entre construction et destruction dans le rire
A. L'importance du rire comme moyen d'équilibre social
B. L'usage mesuré du rire par Rabelais pour maintenir cet équilibre
En quoi l’humour de Rabelais participe-t-il à un projet humaniste ?
I. L'humour comme outil de critique humaniste
A. Le rire comme moyen d'exposer les vices et l'ignorance
B. L'humour comme moyen de promouvoir l'intelligence et la raison
II. L'humour comme vecteur de valeurs humanistes
A. L'usage du rire pour valoriser l'humanité et la tolérance
B. Le rire qui soutient l'idéal de libre-pensée
III. L'humour au service de l'éducation humaniste
A. L'emploi du rire pour favoriser l'apprentissage et la curiosité
B. L'importance de l'humour dans la promotion d'une pédagogie libre et ouverte
Comment le rire nous éduque-t-il dans Gargantua de Rabelais ?
I. Le rire comme moyen de transmission du savoir
A. L'humour pour vulgariser les concepts complexes
B. Le rire qui stimule la curiosité et l'envie d'apprendre
II. Le rire comme outil de critique sociale
A. L'usage du rire pour dénoncer les vices et les travers
B. L'humour comme moyen de développer l'esprit critique
III. Le rire comme vecteur de valeurs
A. L'humour pour transmettre des principes moraux et éthiques
B. L'importance du rire dans la construction de l'identité et de la personnalité.
Sujet : « Le rire de Rabelais est en grande partie un superbe déguisement pour essayer de détourner les ennemis, brouiller les pistes, éviter les censures si terribles alors. » Dans quelle mesure ces propos de Michel Butor dans Répertoire II s'appliquent-ils à votre lecture de Gargantua ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur le livre de Rabelais ainsi que sur votre culture personnelle.
Problématique: Dans quelle mesure le rire dans "Gargantua" de Rabelais sert-il de stratégie pour déjouer la censure et véhiculer des critiques sous un voile d'humour ?
Plan de développement:
Introduction
Présentation de "Gargantua" de François Rabelais, œuvre emblématique de la Renaissance, connue pour son humour débordant et sa critique sociale.
Introduction des propos de Michel Butor, suggérant que le rire chez Rabelais est un moyen de contourner la censure et d'adresser des critiques sans s'exposer directement.
Annonce de la problématique et de l'approche analytique.
I. Le rire comme instrument de critique sociale et religieuse
Analyse des épisodes comiques de "Gargantua", notamment ceux qui mettent en scène les excès et les absurdités des figures d'autorité, comme les ecclésiastiques ou les éducateurs.
Discussion sur la manière dont Rabelais utilise le rire pour critiquer les institutions religieuses et éducatives de son époque, en soulignant leurs contradictions et leurs échecs.
Réflexion sur la portée de ces critiques et sur la capacité du rire à faire passer des messages subversifs sous couvert d'humour.
II. Le rire comme moyen de détournement de la censure
Exploration de la stratégie de Rabelais consistant à mêler des éléments grotesques et burlesques à ses critiques, rendant ainsi son œuvre difficile à censurer sans en altérer la nature profondément comique.
Examen des techniques littéraires utilisées par Rabelais, telles que la parodie, l'exagération et le jeu de mots, qui lui permettent de voiler ses intentions sous des couches d'humour.
Discussion sur l'efficacité de cette approche dans le contexte de la Renaissance, période marquée par une censure ecclésiastique et royale forte.
III. Le rire comme vecteur de philosophie et de savoir
Analyse de la dimension éducative du rire chez Rabelais, notamment à travers le personnage de Gargantua et son éducation humaniste, qui contraste avec les méthodes traditionnelles.
Réflexion sur la manière dont Rabelais utilise le rire pour promouvoir des idées humanistes, telles que l'importance de la connaissance, de la curiosité intellectuelle et de la modération.
Discussion sur la vision de Rabelais du rire comme moyen d'élévation spirituelle et intellectuelle, en lien avec la citation de Butor.
Synthèse des points abordés, répondant à la problématique en soulignant la complexité du rire dans "Gargantua" comme outil de critique, moyen de contournement de la censure et vecteur de savoir.
Réflexion sur la pertinence du rire rabelaisien dans le contexte contemporain, en tant que forme de résistance et d'expression subversive.
Ouverture sur la capacité de la littérature à utiliser l'humour pour aborder des questions sérieuses et stimuler la réflexion critique.
Dans quelle mesure dans Gargantua le rire est-il au service des valeurs intellectuelles et éthiques de l'auteur et comment permet-il à Rabelais de le faire accéder aux hautes sphères du savoir ?
Problématique: Comment le rire, dans "Gargantua" de Rabelais, sert-il à promouvoir les valeurs intellectuelles et éthiques de l'auteur tout en facilitant l'accès aux hautes sphères du savoir ?
Présentation de "Gargantua" de François Rabelais, soulignant l'importance du rire dans cette œuvre de la Renaissance pleine de verve et d'esprit.
Mise en avant de l'intention de Rabelais d'utiliser le rire non seulement comme un élément de divertissement, mais aussi comme un outil pédagogique et philosophique.
Annonce de la problématique et de la structure du développement.
I. Le rire comme expression des valeurs humanistes de Rabelais
Analyse de la manière dont Rabelais infuse son œuvre de principes humanistes, tels que l'importance de l'éducation, la curiosité intellectuelle, et la remise en question des autorités établies, à travers des scènes humoristiques et des personnages comiques.
Discussion sur les épisodes spécifiques de "Gargantua" où le rire est utilisé pour critiquer les méthodes d'éducation obsolètes et promouvoir une vision humaniste de l'apprentissage, centrée sur l'épanouissement personnel et la connaissance.
Réflexion sur la manière dont le rire renforce les messages éthiques de l'œuvre, notamment la tolérance, la générosité et l'esprit critique.
II. Le rire comme outil de subversion et de critique sociale
Examen des passages de "Gargantua" où le rire permet à Rabelais de remettre en question les institutions religieuses, judiciaires et académiques de son temps sans s'exposer directement à la censure.
Analyse de la façon dont le rire sert de masque pour aborder des sujets controversés, permettant ainsi à Rabelais de diffuser ses idées réformistes et critiques sous couvert de divertissement.
Discussion sur l'efficacité de cette approche pour toucher un public plus large et influencer les sphères intellectuelles de l'époque.
III. Le rire comme vecteur de diffusion du savoir
Exploration de la dimension éducative du rire dans "Gargantua", notamment à travers la parodie et la satire, qui encouragent le lecteur à réfléchir de manière critique aux sujets abordés.
Réflexion sur la manière dont Rabelais utilise le rire pour rendre accessible et attrayant un large éventail de connaissances, allant de la philosophie à la médecine, en passant par la linguistique et la géographie.
Analyse des techniques littéraires employées par Rabelais, comme le jeu de mots, l'hyperbole et la caricature, pour stimuler l'intellect du lecteur et favoriser une approche ludique du savoir.
Synthèse des principaux points abordés, soulignant la capacité de Rabelais à utiliser le rire comme un moyen efficace de promouvoir ses valeurs intellectuelles et éthiques, tout en facilitant l'accès aux hautes sphères du savoir.
Réflexion sur l'importance de l'humour dans la littérature en tant qu'outil pédagogique et de réflexion critique.
Ouverture sur la pertinence continue de l'approche rabelaisienne dans le contexte éducatif et culturel contemporain, où l'humour reste un moyen puissant de communication et d'enseignement.
Dans Gargantua, le rire ne sert-il qu'à créer une distance critique envers le savoir ?
Problématique: Le rire dans "Gargantua" se limite-t-il à instaurer une distance critique avec le savoir, ou remplit-il d'autres fonctions dans l'œuvre de Rabelais ?
Présentation de "Gargantua" de François Rabelais, mettant en lumière le rôle central du rire dans cette œuvre de la Renaissance.
Introduction de l'idée que le rire peut servir à établir une distance critique envers le savoir, mais aussi à explorer d'autres dimensions de l'expérience humaine.
Annonce de la problématique et du cadre d'analyse.
I. Le rire comme moyen de critique du savoir et de l'éducation
Analyse des épisodes et des personnages de "Gargantua" qui se moquent des institutions éducatives et des formes de savoir traditionnelles, comme la satire des écoles de Sorbonne et des méthodes pédagogiques obsolètes.
Discussion sur la façon dont Rabelais utilise le rire pour remettre en question les autorités établies et proposer une vision humaniste de l'éducation, centrée sur la curiosité et l'apprentissage par l'expérience.
Réflexion sur l'efficacité du rire pour engager le lecteur dans une critique des normes éducatives et intellectuelles de l'époque.
II. Le rire comme vecteur de valeurs humanistes
Examen des aspects de l'œuvre où le rire sert à promouvoir des valeurs humanistes, telles que la tolérance, la bienveillance et l'importance de la liberté individuelle.
Analyse des scènes comiques qui illustrent les idéaux de Rabelais en matière d'éducation et de savoir, comme l'éducation idéale de Gargantua par Ponocrates.
Discussion sur la manière dont le rire facilite l'adhésion du lecteur aux principes humanistes de l'œuvre, en rendant les concepts plus accessibles et engageants.
III. Le rire comme expression de la joie de vivre
Exploration de la dimension ludique et joyeuse du rire dans "Gargantua", où il célèbre la vitalité, l'abondance et le plaisir sensoriel, en opposition aux rigueurs de l'ascétisme et de la restriction.
Réflexion sur les festins, les jeux et les aventures dans l'œuvre comme manifestations d'une approche de la vie empreinte de gaieté et de générosité.
Analyse de la façon dont le rire contribue à une vision du monde où le savoir est intégré à une expérience de vie plus large et plus riche, pleine de curiosité et de joie.
Synthèse des points abordés, soulignant la multiplicité des fonctions du rire dans "Gargantua", qui dépasse la seule critique du savoir pour englober une affirmation des valeurs humanistes et une célébration de la vie.
Réponse à la problématique en affirmant que le rire chez Rabelais ne se limite pas à créer une distance critique, mais sert également à enrichir la dimension éducative et existentielle de l'œuvre.
Ouverture sur la pertinence du rire rabelaisien dans le contexte contemporain, comme moyen de remettre en question les structures établies tout en promouvant une vision positive et inclusive du savoir et de l'existence.
Pensez-vous que le rire est un bon moyen d'accéder au savoir ?
Présentation du rire comme élément central dans de nombreuses œuvres littéraires et philosophiques, soulignant son potentiel à la fois divertissant et éducatif.
Évocation de l'usage du rire par des auteurs tels que Rabelais, qui l'emploie comme un outil pour critiquer et transmettre des idées complexes de manière accessible.
I. Le rire comme vecteur de critique et de remise en question
Analyse de la manière dont le rire permet de déconstruire les idées reçues et de remettre en question les autorités établies, en favorisant une approche critique du savoir.
Discussion sur la capacité du rire à créer une distance propice à l'analyse et à la réflexion, en désamorçant les tensions et en ouvrant l'esprit à de nouvelles perspectives.
II. Le rire et la mémorisation des connaissances
Examen des recherches en psychologie et en pédagogie qui montrent que le rire et l'humour peuvent faciliter la mémorisation et l'apprentissage, en rendant le contenu plus engageant et mémorable.
Illustration par des exemples concrets où le rire a été utilisé avec succès dans des contextes éducatifs pour enseigner des concepts complexes ou abstraits.
III. Les limites du rire dans l'accès au savoir
Réflexion sur les risques de simplification excessive ou de déformation du savoir lorsque le rire est utilisé de manière inappropriée ou sans discernement.
Discussion sur la nécessité d'équilibrer l'approche ludique et humoristique avec la rigueur et la profondeur requises dans l'exploration de certains domaines du savoir.
Synthèse des points abordés, soulignant le rôle potentiellement enrichissant du rire dans l'accès au savoir, tout en reconnaissant la nécessité de l'utiliser judicieusement.
Réaffirmation de l'idée que le rire, lorsqu'il est bien employé, peut être un moyen puissant de stimuler la curiosité, la réflexion critique et l'engagement dans le processus d'apprentissage.
Ouverture sur la question de la place du rire et de l'humour dans les méthodes pédagogiques contemporaines et dans la communication du savoir.
Quelles sont les fonctions du rire dans gargantua ?
Problématique
Dans quelle mesure le rire, dans "Gargantua" de Rabelais, dépasse-t-il la simple fonction de divertissement pour s'ériger en instrument de critique, d'éducation et de contestation des normes sociales et intellectuelles de l'époque ?
Plan de développement
Présentation de "Gargantua" comme une œuvre majeure de la Renaissance française, caractérisée par son usage abondant du rire.
Mention de la diversité des interprétations du rire chez Rabelais, reflétant les multiples dimensions de son œuvre.
I. Le rire comme instrument de critique sociale et politique
Analyse des passages où le rire est utilisé pour moquer les institutions ecclésiastiques, l'éducation scholastique et les figures d'autorité, soulignant son rôle de véhicule pour la satire sociale.
Examen des personnages et des situations comiques employés par Rabelais pour dépeindre les vices et les absurdités de son temps, démontrant comment le rire sert à remettre en question l'ordre établi.
Discussion sur l'efficacité du rire pour contourner la censure et communiquer des idées subversives dans un contexte où la liberté d'expression était limitée.
II. Le rire comme outil pédagogique et vecteur de savoir
Exploration de la dimension éducative du rire dans l'œuvre, notamment à travers l'éducation de Gargantua, qui contraste avec les méthodes traditionnelles par son approche humaniste et ludique.
Réflexion sur la manière dont Rabelais utilise l'humour pour rendre l'apprentissage plus attrayant et pour encourager une approche critique et curieuse du savoir.
Analyse des allusions érudites et des jeux de mots présents dans le texte, illustrant comment le rire peut stimuler l'intellect et la réflexion.
III. Le rire comme expression de la joie de vivre et de la liberté individuelle
Discussion sur le rôle du rire dans la célébration de la vie, du plaisir et de la liberté, en opposition aux rigueurs de l'ascétisme et aux restrictions morales de l'époque.
Analyse des banquets, des jeux et des aventures de Gargantua et de ses compagnons comme manifestations d'un humanisme joyeux et d'un éloge de l'épanouissement personnel.
Réflexion sur la dimension carnavalesque de l'œuvre, où le rire évoque un renversement temporaire des hiérarchies sociales et une libération des contraintes.
Synthèse des principales fonctions du rire identifiées dans "Gargantua", soulignant sa richesse et sa complexité au-delà de la simple dimension humoristique.
Réaffirmation de la capacité du rire à engager le lecteur sur les plans intellectuel, critique et émotionnel, reflétant la vision humaniste de Rabelais.
Ouverture sur la pertinence contemporaine du rire rabelaisien comme moyen de résistance, d'éducation et d'affirmation de la joie de vivre.
Le roman de Rabelais, Gargantua, vous parait-il sérieux ?
Problématique: Dans quelle mesure "Gargantua" de Rabelais, malgré son apparence comique et extravagante, peut-il être considéré comme une œuvre sérieuse traitant de questions importantes de son époque ?
Présentation de "Gargantua" comme une œuvre emblématique de la littérature de la Renaissance, connue pour son utilisation audacieuse de l'humour et du grotesque.
Mention de la tendance initiale à percevoir le roman comme un divertissement léger en raison de son style comique.
I. La satire sociale et politique
Analyse de la manière dont Rabelais utilise l'humour et la satire pour critiquer les institutions de son époque, telles que l'Église, l'éducation scholastique et la monarchie.
Discussion sur les personnages et les anecdotes comiques qui, sous couvert de rire, véhiculent des critiques acerbes des abus de pouvoir et des hypocrisies sociales.
Réflexion sur l'efficacité de l'humour comme moyen de contournement de la censure et de communication de messages subversifs.
II. La promotion des idéaux humanistes
Exploration de l'humanisme de Rabelais, manifeste dans l'éducation idéale de Gargantua, qui contraste avec les méthodes pédagogiques rigides de l'époque.
Analyse des thèmes de la quête de savoir, de l'importance de la langue et de la culture, et de l'épanouissement individuel à travers le prisme de l'humour et de la parodie.
Discussion sur la manière dont le roman, malgré son ton léger, sert de plaidoyer pour une vision humaniste du monde, valorisant la connaissance, la tolérance et l'autonomie intellectuelle.
III. La réflexion philosophique et théologique
Examen des passages qui, derrière leur apparence humoristique, engagent le lecteur dans des réflexions profondes sur des questions philosophiques et théologiques, telles que la nature humaine, la foi et le libre arbitre.
Analyse de la manière dont Rabelais intègre des éléments de la pensée érasmienne, du scepticisme et de la réforme religieuse, invitant à une remise en question des certitudes et à une ouverture d'esprit.
Réflexion sur le rôle du rire comme moyen d'accéder à une forme de sagesse, encourageant une approche plus nuancée et moins dogmatique de la vie et de la spiritualité.
Synthèse des éléments qui attestent du sérieux de "Gargantua" malgré son apparence comique, soulignant la capacité de Rabelais à tisser ensemble humour et critique sociale, humanisme et réflexion philosophique.
Réaffirmation de la pertinence et de la profondeur de l'œuvre, qui dépasse le simple divertissement pour se positionner comme un texte clé dans la réflexion sur les enjeux de la Renaissance.
Ouverture sur la dualité intrinsèque de l'œuvre, qui incarne la complexité de la condition humaine, capable de susciter à la fois le rire et la réflexion sérieuse.
"Gargantua" est-il, comme l'écrit Montaigne, un roman "simplement plaisant" ?
"Gargantua" est-il réellement un roman "simplement plaisant", ou cette description sous-estime-t-elle la richesse et la portée de l'œuvre de Rabelais ?
Introduction de "Gargantua" de Rabelais, soulignant son humour exubérant et son style narratif extravagant.
Mention de la description de l'œuvre par Montaigne comme étant "simplement plaisant".
I. L'humour et le plaisir dans "Gargantua"
Analyse des éléments humoristiques de "Gargantua", tels que la satire, la parodie et le grotesque, qui contribuent à l'aspect plaisant de l'œuvre.
Discussion sur la manière dont Rabelais utilise le rire pour engager le lecteur, en rendant l'histoire accessible et divertissante.
Réflexion sur le rôle du plaisir dans la littérature de la Renaissance et sur la façon dont "Gargantua" s'inscrit dans cette tradition.
II. Au-delà du divertissement : satire et critique sociale
Exploration de la dimension satirique de "Gargantua", où Rabelais critique les institutions religieuses, l'éducation, et la politique de son temps.
Analyse de la subtilité avec laquelle Rabelais intègre ses critiques sous couvert d'humour, utilisant le plaisir comme un moyen de faire passer des messages plus profonds.
Discussion sur la capacité de l'œuvre à stimuler la réflexion critique chez le lecteur, en dépit de son apparence de "simple" divertissement.
III. "Gargantua" comme expression des idéaux humanistes
Examen des thèmes humanistes présents dans "Gargantua", tels que l'importance de l'éducation, la quête de la connaissance, et la valorisation de l'individu.
Analyse de la façon dont Rabelais promeut ces idéaux à travers l'histoire de Gargantua, notamment dans le célèbre épisode de l'éducation de Gargantua par Ponocrates.
Réflexion sur la dimension éducative de l'œuvre, qui va au-delà du simple plaisir pour véhiculer des valeurs et encourager une vision humaniste du monde.
Synthèse des points abordés, soulignant la complexité de "Gargantua" qui, bien qu'étant indéniablement plaisant et divertissant, recèle une profondeur et une richesse thématique qui dépassent le simple amusement.
Réaffirmation de la position de "Gargantua" comme une œuvre multidimensionnelle, qui allie plaisir et sérieux, divertissement et éducation, humour et critique.
Ouverture sur la capacité unique de la littérature, et particulièrement de l'œuvre de Rabelais, à fusionner le plaisir avec l'exploration de questions sociales, éthiques et philosophiques importantes.
Écrire commentaire
Noah Metge ( mercredi, 29 mai 2024 17:33 )
- Défiler vers le haut

Gargantua, Rabelais : résumé et fiche de lecture
Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
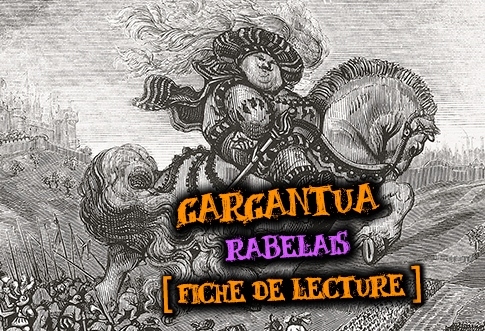
François Rabelais a publié Gargantua en 1534 sous le pseudonyme Alcofribas Nasier (anagramme de François Rabelais !) déjà utilisé pour Pantagruel en 1532.
Ces deux œuvres comiques et satiriques relatent les aventures de deux géants et leurs amis.
Gargantua est une œuvre comique qui marque une rupture avec le Moyen-Âge et peut être considérée comme un manifeste humaniste.
Dans un monde où les méthodes médiévales règnent encore en maître dans les universités, Rabelais propose un ouvrage d’une richesse extraordinaire dans lequel il expose une conception humaniste de l’éducation, de la politique et de la religion.
Analyses d’extraits de Gargantua :
- Prologue de Gargantua
- Gargantua, chapitre 14
- Gargantua, chapitre 17
- Gargantua, chapitre 21
- Gargantua, chapitre 33
- L’abbaye de Thélème, chapitre 57
- Lettre de Pantagruel à Gargantua, Pantagruel , chapitre 8
Dissertation sur Gargantua :
- Dissertation sur Gargantua (sujet d’annales)
Analyse de Gargantua en vidéo
Qui est Rabelais ?
Né à la fin du XVème siècle, moine puis médecin réputé, Rabelais a effectué de nombreux déplacements et plusieurs séjours en Italie. C’est un érudit passionné de culture antique .
Il est connu notamment pour Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), des œuvres comiques et satiriques relatant les aventures d’une famille de géants et leurs amis. Mais derrière l’exubérance et le rire de ces œuvres se cache une réflexion humaniste sur l’homme.
Comment résumer Gargantua ?
Gargantua s’ouvre par un prologue qui livre une clé de lecture : derrière le comique et le burlesque, Rabelais nous invite à extraire la « substantifique moelle » de l’oeuvre, c’est à dire à découvrir son sens profond .
L’histoire débute par l’ enfance et l’éducation du géant Gargantua : sa naissance extraordinaire, ses vêtements, son goût démesuré pour la nourriture et les boissons.
Gargantua bénéficie d’abord d’une éducation traditionnelle dispensée par des théologiens qui lui font apprendre les choses par cœur .
Mais cette méthode pédagogique est un échec : Gargantua devient « tout rêveur et assoti » (chapitre 15).
Son éducation est alors confiée à Ponocrates , un professeur humaniste qui lui fait suivre un programme où l’exercice intellectuel, physique et l’hygiène du corps sont importants.
Grâce à cette éducation humaniste, Gargantua est transformé.
Rabelais narre ensuite les guerres picrocholines qui opposent le roi Picrochole à Grandgousier (le père de Gargantua).
Le pacifique Grandgousier tente par tous les moyens d’éviter la guerre, mais face à la furie belliqueuse de Picrochole, il est contraint de mener une guerre défensive pour restaurer la paix.
La troupe de Gargantua , aidée par l’énergique Frère Jean des Entommeures, remporte la victoire .
La guerre finie, Gargantua offre en récompense à son ami Frère Jean des Entommeures l’étonnante abbaye de Thélème .
Cette abbaye s’oppose en tout point aux abbayes de l’époque dans lesquelles règnaient l’ordre, la pauvreté, la chasteté et l’enfermement.
A l’inverse, la devise de l’Abbaye de Thélème est « Fais ce que tu voudras ».
Cette liberté, loin de mener au chaos, permet aux jeunes gens bien éduqués de vivre dans l’ harmonie et l’ abondance .
Quels sont les thèmes importants dans Gargantua ?
L’éducation.
Les premiers chapitres de Gargantua répondent à la question : « Qu’est-ce qu’une bonne éducation ? » .
Cette interrogation est fondamentale car, pour les humanistes comme Rabelais, c’est l’ éducation qui permet à l’homme d’ exprimer le meilleur de sa nature .
L’éducation de Gargantua n’a pas été de tout repos !
Il a d’abord subi l’enseignement selon les méthodes médiévales fondées sur le par cœur , l’abstraction et le mépris du corps.
Les conséquences sont désastreuses . Grandgousier, le père de Gargantua, s’aperçoit que son fils « étudiait très bien et y mettait tout son temps, toutefois qu’en rien il ne profitait, et, qui pis est, en devenait fou, niais, tout rêveur et assoti. » (chapitre 15)
Grandgousier choisit alors pour son fils l’ éducation humaniste de Ponocrates, fondée sur la curiosité scientifique, la lecture des textes Anciens, la réflexion, la pratique, et l’hygiène du corps . Cette éducation est une réussite.
Gargantua évoque les fonctions naturelles du corps sans tabou : l’accouchement, le fait d’uriner, la défécation…
Ces allusions ne sont pas seulement comiques. Rabelais montre le corps comme une source de réjouissance .
Quelles sont les vertus d’un bon souverain ? Existe-t-il une guerre juste?
A travers les guerres picrocholines, qui font écho aux rivalités entre François Ier et Charles Quint pour la domination de l’Europe, Rabelais mène une réflexion sur ces questions politiques.
Il entend montrer l’ absurdité de la guerre et ses ravages.
Pour l’auteur humaniste, seule la guerre défensive se justifie . Ce n’est qu’après avoir tenté en vain la diplomatie et la conciliation que Grandgousier fait la guerre à Picrochole pour restaurer la paix.
La liberté et la société idéale
La liberté est un thème important dans Gargantua , au coeur des chapitres 52 à 58 sur l’Abbaye de Thélème .
Dans cette abbaye utopique, où sont accueillis les hommes et les femmes bien nés et bien éduqués, les murailles sont inexistantes et les jeunes gens n’ont qu’ une seule règle : « Fais ce que tu voudras . »
Loin de créer des conflits, cette liberté individuelle mène à une société épanouie et fraternelle .
Quelles sont les particularités de l’écriture de Rabelais dans Gargantua ?
L’ écriture de Rabelais est d’une variété et d’une richesse extraordinaires .
L’auteur use de différents niveaux de langue , mêlant termes techniques et savants, dialectes régionaux, expressions latines, mots vulgaires et mots inventés.
Cette exubérance lexicale s’exprime particulièrement dans les nombreuses énumérations qui étourdissent le lecteur.
Rabelais multiplie aussi les tonalités (satirique, épique, comique, lyrique…) et ne recule devant aucune forme du comique (calembours, situations farcesques, allusions obscènes et scatologiques…).
Que signifie le parcours « Rire et savoir »?
Gargantua de Rabelais est un point de rencontre entre le rire et le savoir.
En effet, derrière le rire, la farce et l’imagination exubérante, l’œuvre de Rabelais témoigne d’une soif de connaissance et de savoir typiquement humaniste.
Dès le prologue, Rabelais invite d’ailleurs le lecteur à ne pas se fier au comique apparent de l’œuvre afin d’en « sucer la substantifique moelle ». Le lecteur doit « interpréter » le sens profond derrière la plaisanterie.
(Pour aller plus loin, regarde ma vidéo sur l’humanisme dans laquelle tu verras que cette approche joyeuse du savoir incarne l’humanisme naissant )
Une œuvre placée sous le signe du rire
Gargantua est une œuvre placée sous le signe du rire .
Dès l’adresse aux lecteurs, le rire est présenté comme une consolation au chagrin et aux difficultés de la vie :
« Quand je vois la peine qui vous mine et consume, Il vaut mieux traiter du rire que des larmes Parce que le rire est le propre de l’homme. »
C’est donc par le rire que Rabelais nous invite à entrer dans son œuvre.
Une soif de connaissance
Mais le rire n’empêche ni l’érudition, ni l’étude et la réflexion.
Ainsi, Rabelais qui connaît le latin, le grec et admire la culture antique, nourrit son texte de références à Platon, Socrate, Aristote, Plutarque … Le prologue s’ouvre d’ailleurs sur une référence au Banquet de Platon et un éloge de Socrate, « prince des philosophes. »
La soif de connaissance transparaît également dans le programme éducatif de Gargantua puisqu’aucun domaine n’échappe à l’étude : la terre, la mer, les végétaux, les pierres, les métiers, les techniques humaines, les mathématiques, l’astronomie, la musique…
Rabelais se plaît à employer dans son œuvre un vocabulaire technique qui témoigne d’une érudition dans des domaines variés : lexique religieux, médical, juridique, universitaire. Ainsi, dans le chapitre 13 où Gargantua évoque l’invention d’un torchecul, l’humour scatologique côtoie un vocabulaire médical spécialisé : « le périnée », « la dysenterie », « matière fécale », « intestins ».
Le savoir est l’occasion d’un plaisir intellectuel intense
Le message est clair : le savoir et le sérieux ne font pas bon ménage.
Au contraire, le savoir doit être l’occasion d’un plaisir intellectuel intense , proche de l’ivresse .
L’écriture dionysiaque et l’inventivité lexicale de Gargantua désaltèrent et enivrent le lecteur comme un bon vin.
L’accès au savoir n’est plus caractérisé par la privation ou la pénitence mais par une vie festive .
Tu dois bien sûr comprendre que cette approche du savoir est originale !
Rabelais écrit en effet au début du XVIème siècle, à une époque où l’éducation est dominée par les austères méthodes médiévales , dites méthodes scolastiques, qui privilégient l’apprentissage par cœur, l’abstraction, et méprisent le corps.
Cette nouvelle approche du savoir par le rire marque une rupture avec le Moyen-âge et témoigne de la naissance de l’humanisme .

Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.
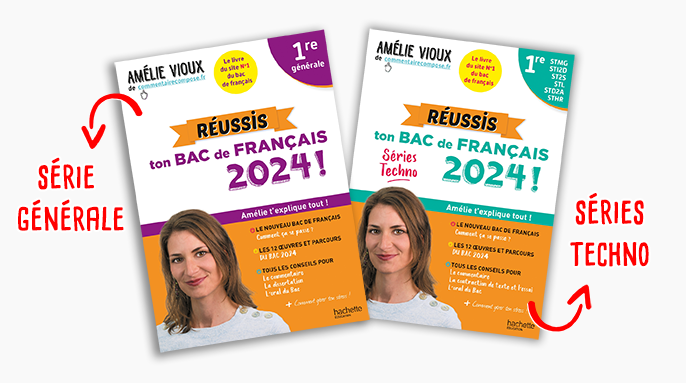
Qui suis-je ?
Amélie Vioux
Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).
Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.
Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.
Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.
J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.
13 commentaires
Bonjour, Serait-il possible que vous rajoutiez des fiches de lectures sur les lectures cursives de la littérature d’idée ?
Bonjour Marie, Il n’existe pas de programme officiel de lectures cursives : il s’agit d’œuvres librement choisies par vos enseignants, dans le cadre des parcours. En revanche, tu peux m’indiquer les ouvrages qui te sont proposés : je prends en compte vos suggestions pour mon choix de futures fiches de lecture.
Serait-il possible que vous rajoutiez une dizaine de citations clés pour les oeuvres dont vous faites les fiches ? Cela me serait très utile en vue de la dissertation.
J’ai acheté votre livre qui m’aide énormément et je le conseille à tout le monde !
Bonjour Mme, Merci pour vos aides. Si possible pourriez-vous rajouter aux fiches de lecture de Gargantua, Le Malade imaginaire, Manon Lescaut et Les Contemplations une liste avec une vingtaine de citations à retenir. Cela me serait très utile pour la dissertation. Merci encore.
Ça m’a beaucoup aidé, merci.
Bonjour, Quel travail ! Quelle pédagogie ! Merci beaucoup
Merciii beaucoup pour ces fiches.
Ça m’a beaucoup aidé surtout que je n’ai pas eu le temps de lire gargantua j’espère que ça passera pour mon interrogation de demain
alors c’est passé ?
Je vous remercie beaucoup pour cette fiche. Je prépare le CRPE 2022 et j’ai commencé la lecture de Gargantua. Une aide pour analyser le texte s’imposait.
Merci beaucoup Mme, je suis en terminale depuis le Sénégal mais je vous suis et grâce à vous je comprends très vite mes sujets. Encore une fois MERCI
J’ai tellement aimé votre faramineux travail que vous faites pour nous…. Merci infiniment….
Il est dommage que vous ne proposez pas une fiche de Rabelais.
Laisse un commentaire ! X
Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.
Site internet
Introduction à la Dissertation sur Gargantua : Un Guide Complet
Symbols: 4029
=== La dissertation sur un sujet littéraire nécessite une compréhension approfondie de l’œuvre et une analyse claire de ses thèmes et de son style. Parmi les œuvres littéraires les plus étudiées figure ‘Gargantua’, écrit par François Rabelais, un écrivain français de la Renaissance. Cet article sert de guide détaillé pour comprendre le contexte de ‘Gargantua’ et propose des techniques de rédaction pour la dissertation sur cette œuvre.
Chapitre 1: Comprendre le contexte de ‘Gargantua’
‘Gargantua’ est l’une des œuvres les plus célèbres de François Rabelais, qui appartient à un ensemble de romans comiques connus sous le nom de ‘La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel’. Écrit pendant la Renaissance, le roman est un récit satirique et humoristique qui critique les institutions et les idées de l’époque, notamment l’Église et l’éducation. Le personnage principal, Gargantua, est un géant dont les exploits et les aventures sont racontés tout au long de l’œuvre.
Dans le contexte de la Renaissance, ‘Gargantua’ se distingue par sa critique de l’orthodoxie et son appel à la liberté d’expression et à la pensée critique. Rabelais utilise le personnage de Gargantua pour parodier et satiriser les coutumes et les idées de son époque, notamment les excès de l’église et de l’éducation. Pour comprendre ‘Gargantua’, il est essentiel de comprendre la satire de Rabelais et son utilisation du rire comme moyen d’exposer les absurdités de son temps.
Rabelais utilise également l’œuvre pour explorer des thèmes philosophiques et existentiels, tels que la nature humaine et le sens de la vie. Gargantua est présenté comme une figure complexe, à la fois héros et anti-héros, qui incarne les contradictions et les tensions de la condition humaine. Les exploits de Gargantua servent de miroir pour examiner les vices et les vertus de l’homme, et le roman est une méditation sur la nature du bien et du mal, de la liberté et de la servitude.
Chapitre 2: Techniques de rédaction pour la dissertation sur ‘Gargantua’
La rédaction d’une dissertation sur ‘Gargantua’ implique une analyse détaillée du roman et une interprétation de ses thèmes et de son style. Le premier pas vers une bonne dissertation est la lecture attentive de l’œuvre. Il faut accorder une attention particulière à la structure du roman, à la caractérisation de Gargantua, aux thèmes principaux, au style de Rabelais et aux éléments satiriques et humoristiques. Il est également utile de prendre des notes détaillées pour faciliter l’analyse.
Deuxième étape, l’organisation des idées. Un plan clair peut aider
Enfin, la rédaction de la dissertation nécessite une attention particulière au style et à la grammaire. Il est essentiel d’écrire de manière claire et précise, d’éviter les généralisations et les clichés, et d’employer un vocabulaire approprié. Il est également important de relire le texte pour corriger les erreurs et améliorer la fluidité du texte. Une bonne dissertation sur ‘Gargantua’ doit être à la fois analytique et critique, et démontrer une compréhension profonde de l’œuvre.
=== La dissertation sur ‘Gargantua’ offre une occasion de se plonger dans l’univers satirique et philosophique de François Rabelais. Comprendre le contexte de l’œuvre et appliquer des techniques de rédaction efficaces sont des étapes cruciales pour réussir une analyse littéraire approfondie de ce roman. En fin de compte, la clé est de chercher à comprendre non seulement l’œuvre elle-même, mais aussi l’époque et la société dans lesquelles elle a été écrite, révélant ainsi la richesse et la complexité de ‘Gargantua’.
Metaphor, Lexicography, and Rabelais’s Prologue to Gargantua
- First Online: 28 December 2017
Cite this chapter

- Kathryn Banks 5
Part of the book series: Cognitive Studies in Literature and Performance ((CSLP))
268 Accesses
Marshalling history and contemporary science, Banks investigates what happens when writers revive the embodied content of “dead metaphors” or Latin etymons. Analysing Rabelais’s Prologue to Gargantua and Dolet’s Commentaries on the Latin Language , Banks shows that both fiction and lexicography highlighted semantic continuities between the abstract and the embodied by moving between the two, reflecting humanism’s “language turn.” However, Rabelais’s switches between embodied and abstract are more striking, and often found in discussions of cognition. Drawing on neuroscientific research into how language affects sensorimotor response, Banks argues that Rabelais thereby makes extensive calls on readers’ embodied cognition, which may come to the level of conscious reflection. Further light is shed on this by contrast with Charles de Bovelles’ treatment of the proverbs underlying Rabelais’s Prologue.
I would like to thank the Leverhulme Trust for the award of a Philip Leverhulme Prize, which is funding the research to which my work for this book belongs. This particular essay has been a long time in the making and has incurred a number of debts. I am deeply grateful to Terence Cave, who invited me to be a Research Lecturer in his project “Thinking with Literature,” leading me to present research on “kinesic Rabelais” and the Gargantua prologue in Durham in 2012 and Oslo in 2013. I am indebted to Ann Moss and to Marc Schachter, who both commented insightfully on drafts of this essay. Finally, thanks are due to participants at our 2014 Kinesis workshop, especially Guillemette Bolens, Neil Kenny and Raphael Lyne.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Institutional subscriptions
A different take on kinesis in Rabelais, in particular on friendship, is provided by Michel Jeanneret, another participant in the “Thinking with Literature” project and the Kinesis workshop. “Quand le sens passe par les sens: Rabelais et l’intelligence des corps,” Poétique 178 (2015): 157–62. See also Timothy Chesters, “Social Cognition: A Literary Perspective,” Paragraph 37 (2014): 63–71.
The expression “seamless web” is borrowed from Ann Moss, Renaissance Truth and the Latin Language Turn (Oxford: Oxford University Press, 2003), 49. The notion of a “web” of language is recurrent in Part I (“Words”) of Moss’s book.
Two vols, Lyon: Sebastian Gryphius, 1536 and 1538.
Les Images dans l’œuvre de Rabelais . Vol. 3: Un Aspect de l’Imagination créatrice chez Rabelais: l’emploi des images (Paris: Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, 1982), 143–8.
“What is most important here for a more general consideration of how literature constructs nationhood are the curious slippages from metaphorical to literal language.” For example “[t]hese metaphors may be dead metaphors, but Rabelais brings them to life again, for they are the terms that generate the narrative […] Panurge’s metaphorical description of the Turks as ‘treacherous dogs’ is neatly literalized.” Literature and Nation in the Sixteenth Century: Inventing Renaissance France (Ithaca, NY; London: Cornell University Press, 2001), 25, 51. Cf Neil Kenny’s suggestion that the Turkish episode discussed by Hampton brings together lambish leanness and other meanings of curiosus , demonstrating interestingly that embodied and abstract meanings may be associated because of not only the etymological or metaphorical derivation of abstract meanings from embodied ones but also the gathering together of disparate items under commonplace headings such as curiosus . “Plautus, Panurge, and ‘les aventures des gens curieux’,” in (Re)Inventing the Past: Essays in honour of Ann Moss , ed. Gary Ferguson and Catherine Hampton (Durham: University of Durham, 2003), 51–68. Movement between the figurative and the literal in Rabelais has also featured in my own previous research. “‘I speak like John about the Apocalypse’: Rabelais, Prophecy and Fiction,” Literature and Theology 26 (2012): 417–38. “Apocalypse and Literature in the Sixteenth Century: The Case of Rabelais and the Frozen Words,” in Visions of Apocalypse: Representations of the End in French Literature and Culture , ed. Leona Archer and Alex Stuart (Oxford: Peter Lang, 2013), 83–98.
According to Aristotle’s seminal definition, “metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else” Poetics , 1457b. See also Cicero, De Oratore , book III 155–69; Quintilian, Institutio Oratoria , book VIII, ch. 6: 1–18. Furthermore, for Aristotle and the rhetoricians, metaphorical status was determined on the level of the individual word, whereas in Rabelais’s writing it is on the level of a broader context—a sentence or sequence of sentences—that the degree of prominence of the embodied content is determined.
Rabelais, Œuvres complètes , ed. Mireille Huchon (Paris: Gallimard, 1994), 6–7. My translation, based on that of M. A. Screech, Gargantua and Pantagruel (London: Penguin, 2006), 207.
Screech, transl., Gargantua and Pantagruel , 207. Urquhart and Motteux, transl., Gargantua and Pantagruel , ed. Terence Cave (London: David Campbell, 1994), 20.
For crocheter , Randle Cotgrave’s 1611 English-French dictionary gives “to open, picke open, with a hooke, &c; also, to hang on a hooke,” while Jean Nicot’s 1606 Thresor de la langue française offers “resignare, Unco aperire” and, for “crocheter une serrure,” “Unco seram aperire.” For taster , Cotgrave offers “to tast; or take an eßay of; also, to handle, feele, touch, or grope for,” while for taster, tastonner , Nicot gives “attrectare, contrectare” but also translates some set expressions ( taster du vin, and taster et gouster petit à petit) in which taster refers to tasting, particularly in the context of wine.
“These results support a gradual abstraction process whereby the reliance on sensory-motor systems is reduced as the abstractness of meaning as well as conventionalization is increased, highlighting the context sensitive nature of semantic processing.” Rutvik H. Desai et al., “A piece of the action: Modulation of sensory-motor regions by action idioms and metaphors,” NeuroImage 83 (2013): 862. On simulation more generally, see the Introduction to this volume.
Desai et al., 868. For a fuller account of this view, see Jeffrey R. Binder and Rutvik H. Desai, “The neurobiology of semantic memory,” Trends in Cognitive Sciences 15 (2011): 527–36.
Leo Spitzer, Die Wortbildung also stilistiches Mittel exemplifiziert an Rabelais (Halle: Max Niemeyer, 1910).
On neologism and kinesic intelligence, see also Timothy Chesters in this volume.
The French word contenance referred, then as now, to the bearing of the body as a whole (rather than primarily to facial expression, as its English cognate does). See, for example, the Dictionnaire du moyen français, http://www.atilf.fr/dmf/definition/contenance . Cotgrave’s translation of contenance (presumably under the influence of English) emphasises the face but also makes clear that the word can mean the bearing or movement of the body: “the countenance, looke, cheere, visage, favor; gesture, posture, behaviour, carriage; presence, or composition of the whole bodie.”
Thanks are due to Marc Schachter for this observation.
http://www.atilf.fr/dmf/definition/contenance
See Introduction to this volume, pp. 4–5.
Des Mets et des mots: banquets et propos de table à la Renaissance (Paris: José Corti, 1987), 119–23.
See pp. 96–7 in the later section in this essay, “Thinking with Fiction: Rabelais’s ‘Modality Switches’.”
“A piece of the action,” 862, 867–8. See also Rutvik H. Desai et al., “The Neural Career of Sensory-motor Metaphors,” Journal of Cognitive Neuroscience 23 (2011): 2376–86.
On syntax and kinesis, see Terence Cave’s essay in this volume.
Bovelles, Charles de, Proverbiorum Vulgarium Libri tres ([Paris]: M.P. Vidouaeo, 1531), vol. II, f. lxxiii v . In transcribing Latin quotations I have, where relevant, changed ā to an or to am ; æ to ae ; ĕ to em ; i to j ; ῑ to in ; j to i ; q to que ; ß to ss ; u to v ; ŭ to um ; & to et . In the case of this quotation I have also corrected faciuntum to facientium , and solidam to solida . All translations from Latin are my own.
Rabelais (London: Duckworth, 1979), 129.
Metaphors We Live By (Chicago: Chicago University Press, 1980).
Binder and Desai, “The neurobiology of semantic memory.”
“Sage, Sapiens . Semble qu’il vienne de Sagax” (Nicot, 1606). The etymon of sage is now thought to be sapidus. Oscar Bloch and Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française (Paris: Presses Universitaires de France, 2002), first published 1932, 568.
“Sagax, sagacis, Cic. Qui ha grand flairement. Et per translationem, Qui conjecture et prevoit bien les choses advenir, Sage, Prudent, Bien advisé.[…] Sagaces canes. Cic. Qui sentent incontinent la trace de la beste, comme font les chiens qu’on appelle espagnols, et autres appelez pendants.” Lewis and Short’s modern dictionary also notes that the primary meaning of sagax , “of quick perception, whose senses are acute, sagacious,” is “chiefly of the acute sense of smelling in dogs.” The notion that the reader would actually be sagax like the dog, rather than merely saige , may possibly also be suggested by the presentation of the dog as an “example” rather than a simile, however Erasmus employed “example” with a broad Aristotelian sense that encompassed similitudes, analogies, and so on. Cf for Quintilian, example was the figure of comparison in which the things compared were most similar, hence example was unlike simile when simile compared animals to people ( Institutio Oratoria , bk 5, ch. 11.22), and sixteenth-century poetic theorists usually gave example a limited sense, attributing to it the function of providing models of conduct or models for writing. John D. Lyons, Exemplum: The Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), 6–20.
The Dictionnaire du moyen français gives A. “Répandre une odeur agréable”; B. “Répandre une odeur désagréable, puer”; C. “Percevoir, sentir une odeur.” http://www.atilf.fr/dmf
Cotgrave gives “to feele; also, to sent, smell, vent, wind; also, to tast or savor; also, to heere; also, to yeeld a sent, savor, or tast; or to sent, savor, or tast, of; to have a smacke, touch, or spice, of.”
Lewis and Short.
http://www.atilf.fr/dmf
Cotgrave gives “to esteeme; think, deeme, trowe, suppose, repute, hold; weigh, consider; judge; prise, value; regard, respect, hold deere, set by, make much account of.”
I do not render “translatus” or “translatio” using terms such as “figurative” or “metaphor” because—as I will discuss— Dolet considers the translatus as a matter of degree. “LOCIS multis (id quod tamen maximè in tertio Tomo nostro demonstrabimus, cùm de phrasi Linguae Latinae scribemus) tum in hoc, tum in primo Tomo nostro à nobis traditum est, linguae cuiusvis et usum, et venustatem non in vocum tantùm proprietate, sed in translatis potissimum dictionibus consistere (id quod, inquam, quanta maxima fieri poterit diligentia, et judicio, tertio Tomo nostro docebimus) dignitatemque praecipuam ex vocum translatione linguas omnes nancisci.” [“In many places both in this volume and in my first volume (and most of all I will show this in my third volume, when I write about expressions of the Latin language) I have passed on that the use and charm of any language consists not only in the proper meaning of words but most of all in transferred uses of words (that which, I say, I will show in my third volume with the greatest care which is possible, and judgement) and that all languages acquire their particular value from the ‘transferral’ of words.”] (Lyon: Sebastian Gryphius, 1538), vol. II, col. 883.
“COMMENTARIORUM meorum ratio tibi ut liquidius, faciliusque constet, quo in his utar ordine, scire te quidem velim. Principio propositae vocis significationem tum propriam, tum translatam ostendimus. Deinde usus varietatem distinguimus. Postremo exempla cumulamus: sed ea separatim. Nempe ut sua proprietati assignentur: translationi deinceps sua. Quod verò ad usus varietatem pertinet, sic nos quoque exempla secernimus, ut statim post dictionis proprietatem, translationemque (si quam fortè translationem habet) quanta possum diligentia, diligenter ostensam simplicia exempla sine intervallo sequantur.” [“So that you may more clearly and easily understand the method in my Commentaries, I want you to know the arrangement that I am using in them. First of all I show the meaning of the word under discussion, both its proper and transferred meaning. Then I distinguish its variety of uses. Last of all I pile up examples, but each of these things separately. So that examples are assigned to the proper meaning and then to the transferred meaning. But in setting forth the variety of uses, I also divide the examples in such a way that immediately after I have carefully shown with as much care as I am able the proper meaning and the transferred meaning of the word (if it has a transferred meaning), simple examples follow without a pause.”] “De Commentariorum ratione, et ordine” (Lyon: Sebastian Gryphius, 1536), vol. I, prefatory material, unpaginated.
For example, vol. II, cols. 884–5.
Meaning more usually moves from concrete to abstract than the reverse. For a discussion of this in relation to Indo-European perception verbs, see Eve Sweetser, From Etymology to Pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 23–48.
Institutio oratoria , book VIII, ch. 2.
Vol. I, col. 171.
“INDAGARE est venatorum more inquirere, qui loca, ubi ferae latibula habent, investigant: dicimus autem indago rem, vel, de re” (Vol. I, col. 170).
The verbs immediately following odoror in this citation—“sentiant […] existiment”—also mean that it bears an interesting similarity to Rabelais’s sequence “fleurer, sentir, estimer,” although the latter two verbs are not presented as synonyms or equivalents for odoror in the Cicero citation and one would not wish to draw firm conclusions from this (almost certainly coincidental) similarity.
Renaissance Truth , 27–8.
As Dolet puts it in the preface to the first volume (“De Commentariorum ratione, et ordine,” unpaginated), “Vocabuli verò primò positi proprietate, translatione, usus, constructionisque varietate et verbis nostris, et Ciceronis exemplis satis multis demonstrata, voces alias significationis cognatione superioribus affines actutum subjungo: rem deinde, quantum licet, perpetuo” [“After I have demonstrated both with my own words and with sufficiently many examples from Cicero the proper meaning and transferred meaning and the diversity of use and of arrangement of the word under discussion, I immediately join other words which are connected by kinship to earlier words then I continue this affair for as long as possible.”] Dolet draws attention to this practice relatively often, for example, Vol. II. Prefatory “De Secundi tomi ordine,” unpaginated; vol. II, cols. 1034, 1085, 1583. In the epitomes of the Commentarii produced by a Basle publisher (1537, 1539, 1540), the word entries in the first volume were rearranged alphabetically, although the original order was reproduced in tabular form after the lexicon proper; the second volume retained the arrangement by subject groups. The number of examples was also reduced. See Moss, 31–2. Dolet himself was proud of the order of his Commentarii , expressing this pride not only on a number of occasions in this work but also in others: see Michel Magnien, “La Philologie selon Dolet,” in La Philologie humaniste et ses représentations dans la théorie et dans la fiction , ed. Perrine Galand-Hallyn, Fernand Hallyn, and Gilbert Tournoy (Geneva: Droz, 2005), vol. II, 449, n. 30.
Vol. I, cols. 168–72.
The sudden rupture in their friendship did not occur until 1542. Mireille Huchon, “Dolet et Rabelais,” in Étienne Dolet 1509–2009 , ed. Michèle Clément (Geneva: Droz, 2012), 345–59. Richard Copley Christie, Étienne Dolet, The Martyr of the Renaissance 1508–1546: A Biography (London: Macmillan and Co., 1899), first published in 1880, 371–86.
Copley Christie, 229–40.
Gargantua may have been published in 1534 but Huchon speculates that it is most likely to have been in the first third of 1535. Œuvres completes , 1054–55.
On literary affordances, see Terence Cave, Thinking with Literature: Towards a Cognitive Criticism (Oxford: Oxford University Press, 2016), 46–62.
“Literature is powerful because, more than any other type of discourse, it triggers the activation of unpredicted sensorimotor configurations.” The Style of Gestures: Embodiment and Cognition in Literary Narrative (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2012), 17.
Ana Raposo et al., “Modulation of motor and premotor cortices by actions, action words and action sentences,” Neuropsychologia 47 (2009): 388–96.
Nicole K. Speer et al., “Reading Stories Activates Neural Representations of Visual and Motor Experiences,” Psychological Science 20 (2009): 989–99.
Kuzmičová, “Presence in the reading of literary narrative: a case for motor enactment,” Semiotica 189 (2012): 23–48. Ryan, Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001).
Drawing attention to this, Judith Anderson argues that we should “free Renaissance meaning from narrow, anachronistic lexicalisation.” Anderson also observes that Robert Estienne’s 1532 Thesaurus linguae latine draws attention to the principle of translatio . It does so in a less explicit and nuanced way than Dolet’s Commentaries . “Translating Investments: The Metaphoricity of Language, 2 Henry IV, and Hamlet,” Texas Studies in Literature and Language 40 (1998): 231, 235; reproduced in Translating Investments: Metaphor and the Dynamic of Cultural Change in Tudor-Stuart England (New York: Fordham University Press, 2005), 8–35.
Carruthers, The Experience of Beauty in the Middle Ages (Oxford: Oxford University Press, 2013), 80–134. “Lectio in cortice, meditatio in adipe” (Guigo II, Scala claustralium, 3.43–7; cited by Carruthers, 131, n. 49).
Montaigne and the Art of Free-Thinking (Oxford: Peter Lang, 2010), 73. See Terence Cave in this volume.
Bibliography
Anderson, Judith. Translating Investments: The Metaphoricity of Language, 2 Henry IV, and Hamlet. Texas Studies in Literature and Language 40 (1998): 231–67.
Google Scholar
———. Translating Investments: Metaphor and the Dynamic of Cultural Change in Tudor-Stuart England . New York: Fordham University Press, 2005.
Banks, Kathryn. Apocalypse and Literature in the Sixteenth Century: The Case of Rabelais and the Frozen Words. In Visions of Apocalypse: Representations of the End in French Literature and Culture , edited by Leona Archer and Alex Stuart, 83–98. Oxford: Peter Lang, 2013.
———. ‘I Speak Like John about the Apocalypse’: Rabelais, Prophecy and Fiction, Literature and Theology 26 (2012): 417–38.
Binder, Jeffrey R., and Rutvik H. Desai. The Neurobiology of Semantic Memory. Trends in Cognitive Sciences 15 (2011): 527–36.
Bloch, Oscar, and Walther von Wartburg. Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris: Presses Universitaires de France, 2002.
Bolens, Guillemette. The Style of Gestures: Embodiment and Cognition in Literary Narrative . Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2012.
Bovelles, Charles de. Proverbiorum Vulgarium Libri tres. Paris: M.P. Vidouaeo, 1531.
Carruthers, Mary. The Experience of Beauty in the Middle Ages . Oxford: Oxford University Press, 2013.
Cave, Terence. Thinking with Literature: Towards a Cognitive Criticism . Oxford: Oxford University Press, 2016.
Chesters, Timothy. Social Cognition: A Literary Perspective. Paragraph 37 (2014): 62–78.
Copley Christie, Richard. Étienne Dolet, The Martyr of the Renaissance 1508–1546: A Biography. London: Macmillan and Co., 1899.
Desai, Rutvik H., Lisa L. Conant, Jeffrey R. Binder, Haeil Park, and Mark S. Seidenberg. A Piece of the Action: Modulation of Sensory-Motor Regions by Action Idioms and Metaphors. NeuroImage 83 (2013): 862–69.
Desai, Rutvik H., Jeffrey R. Binder, Lisa L. Conant, Quintino R. Mano, and Mark S. Seidenberg. The Neural Career of Sensory-motor Metaphors. Journal of Cognitive Neuroscience 23 (2011): 2376–86.
Dolet, Etienne. Commentarii linguae latinae. 2 vols. Lyon: Sebastian Gryphius, 1536 and 1538.
Hampton, Timothy. Literature and Nation in the Sixteenth Century: Inventing Renaissance France. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.
Huchon, Mireille. Dolet et Rabelais. In Étienne Dolet 1509–2009 , edited by Michèle Clément, 345–59. Geneva: Droz, 2012. Cahiers d’Humanisme et Renaissance 98.
Jeanneret, Michel. Des Mets et des mots: banquets et propos de table à la Renaissance. José Corti, 1987.
———. Quand le sens passe par les sens: Rabelais et l’intelligence des corps. Poétique 178 (2015): 147–62.
Kenny, Neil. Plautus, Panurge, and ‘les aventures des gens curieux.’ In (Re)Inventing the Past: Essays in Honour of Ann Moss , edited by Gary Ferguson and Catherine Hampton, 51–68. Durham: University of Durham, 2003.
Kuzmičová, Anežka. Presence in the Reading of Literary Narrative: A Case for Motor Enactment. Semiotica 189 (2012): 23–48.
Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live By . Chicago: Chicago University Press, 1980.
Lyons, John D. Exemplum: The Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy . Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.
Magnien, Michel. La Philologie selon Dolet. In La Philologie humaniste et ses représentations dans la théorie et dans la fiction , edited by Perrine Galand-Hallyn, Fernand Hallyn, Gilbert Tournoy, vol. II, 439–62. Geneva: Droz, 2005.
Moreau, François. Les Images dans l’œuvre de Rabelais. Vol. 3: Un Aspect de l’Imagination créatrice chez Rabelais: l’emploi des images. Paris: Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, 1982.
Moss, Ann. Renaissance Truth and the Latin Language Turn. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Rabelais, François. Œuvres complètes. Edited by Mireille Huchon. Paris: Gallimard, 1994a.
———. Gargantua and Pantagruel . Translated by Sir Thomas Urquhart and Pierre Le Motteux, edited by Terence Cave. London: David Campbell, 1994b.
———. Gargantua and Pantagruel. Translated by M. A. Screech. London: Penguin, 2006.
Raposo, Ana, Helen E. Moss, Emmanuel A. Stamatakis, and Lorraine K. Tyler. Modulation of Motor and Premotor Cortices by Actions, Action Words and Action Sentences. Neuropsychologia 47 (2009): 388–96.
Ryan, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001.
Scholar, Richard. Montaigne and the Art of Free-Thinking. Oxford: Peter Lang, 2010.
Screech, Michael A. Rabelais. London: Duckworth, 1979.
Speer, Nicole K., Jeremy R. Reynolds, Khena M. Swallow, and Jeffrey M. Zacks. Reading Stories Activates Neural Representations of Visual and Motor Experiences. Psychological Science 20 (2009): 989–99.
Spitzer, Leo. Die Wortbildung also stilistiches Mittel exemplifiziert an Rabelais. Halle: Max Niemeyer, 1910.
Sweetser, Eve. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Download references
Author information
Authors and affiliations.
Durham University, Durham, UK
Kathryn Banks
You can also search for this author in PubMed Google Scholar
Editor information
Editors and affiliations.
Durham University, Durham, United Kingdom
Cambridge University, Cambridge, United Kingdom
Timothy Chesters
Rights and permissions
Reprints and permissions
Copyright information
© 2018 The Author(s)
About this chapter
Banks, K. (2018). Metaphor, Lexicography, and Rabelais’s Prologue to Gargantua . In: Banks, K., Chesters, T. (eds) Movement in Renaissance Literature. Cognitive Studies in Literature and Performance. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69200-5_5
Download citation
DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-319-69200-5_5
Published : 28 December 2017
Publisher Name : Palgrave Macmillan, Cham
Print ISBN : 978-3-319-69199-2
Online ISBN : 978-3-319-69200-5
eBook Packages : Literature, Cultural and Media Studies Literature, Cultural and Media Studies (R0)
Share this chapter
Anyone you share the following link with will be able to read this content:
Sorry, a shareable link is not currently available for this article.
Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative
- Publish with us
Policies and ethics
- Find a journal
- Track your research
Rabelais, Gargantua : dissertation
Introduction, le rire comme déguisement, un « livre-silène », un livre qui développe de sérieuses critiques, un rire de pur divertissement, amuser par le récit de « bons tours », le « bon mot » ou le plaisir de jongler avec les mots, un rire de subversion, tourner en dérision et réhabiliter, l'abbaye de thélème : l'utopie comme pied de nez final .
Off the Grid: Sally breaks down USA TODAY's daily crossword puzzle, Late Night

There are spoilers ahead. You might want to solve today's puzzle before reading further! Late Night
Constructor: Darby Ratliff
Editor: Amanda Ratliff
Comments from Today’s Crossword Constructor
Darby: I'm pretty sure that I was trying to put Last Night at the Telegraph Club in a puzzle when I can up with this theme – some combination of "night club" and "late night" swirling in my brain – and while I'll have to save Malinda Lo's novel for some other grid, I'm excited that this came together. Some favorite fill of mine includes Jason SEGEL (and Shrinking ), BAT PHONE, MONAE, BEST PAL, and OH RATS. I hope you enjoyed it!
What I Learned from Today’s Puzzle
- RAFT (16A: Survival game named for a whitewater vessel) The video game RAFT is set in the future, when polar ice caps have melted and flooded most of the planet. Players start out with a simple RAFT, and navigate through the game's world, in search of resources and habitable land. RAFT can be played in single-player or multiplayer mode. Although I wasn't familiar with this game, I was able to figure out the answer from the "whitewater vessel" hint.
- EAT (40A: Enjoy some kanuchi) Kanuchi is a soup made of ground hickory nuts. The hickory tree is endemic to North America, and kanuchi originated in the cuisine of the Cherokee, indigenous peoples of the southeast United States. Since hickory nuts are not usually commercially available, pecans or walnuts are sometimes substituted.
- SEGEL (28D: "Shrinking" actor Jason) In the TV series Shrinking (2023-present), Jason SEGEL portrays Jimmy Laird, a therapist who is grieving the death of his wife. The show centers on Jimmy as he becomes increasingly involved in his patients' lives.
Random Thoughts & Interesting Things
- CGI (9A: SFX in many sci-fi movies) SFX here stands for "special effects." The abbreviation alerts solvers that the answer will be an abbreviation. CGI is computer-generated imagery. The first feature-length movie to make use of CGI was Westworld in 1973.
- NASA (18A: Org. with Artemis and Apollo missions) I wrote about these two NASA (National Aeronautics and Space Administration) programs just a few days ago . The Apollo program lasted from 1962-1972, and ultimately resulted in astronauts walking on the Moon. Artemis is an ongoing NASA mission with a long-term goal of establishing a sustainable presence on the Moon.
- TESSA (23A: "Dear White People" actor Thompson) Dear White People is a 2014 movie set at a fictitious Ivy League college. TESSA Thompson plays the role of Samantha "Sam" White, a Black student at the predominantly white school. Sam uses her radio show, the titular "Dear White People," to call out racist transgressions at the school. Dear White People was adapted to a Netflix TV series in 2017.
- RPG (29A: D&D or Fire Emblem, for example) An RPG is a role-playing game, and refers to a game in which players assume the roles of characters in a fantasy world. Dungeons & Dragons ( D&D ) is a tabletop RPG first published in 1974. D&D is considered the first modern RPG. Fire Emblem is an RPG video game franchise published by Nintendo. It was first released in 1990.
- MAE (32A: "Handsome" cohost Martin) Handsome is a podcast hosted by comedians MAE Martin, Tig Notaro, and Fortune Feimster. Each week, the co-hosts consider a question asked by a friend. They discuss a variety of subjects as they attempt to answer the question.
- MONAE (53A: "Glass Onion" actor Janelle) Thank you, Darby, for giving me a chance to talk about Janelle MONAE's fabulous performance in the 2022 movie Glass Onion: A Knives Out Mystery . This movie is a whodunit with a quirky cast of characters, which happens to be my favorite movie genre. Janelle MONAE played two roles in Glass Onion , twin sisters Helen and Andi Brand.
- DNA (57A: Animated molecule in "Jurassic Park") Mr. DNA , a cartoon character that resembles an anthropomorphic DNA molecule, appears in the 1993 movie Jurassic Park . Mr. DNA is the mascot for the titular theme park, which features de-extinct dinosaurs. Mr. DNA explains to park visitors how the dinosaurs were created. Mr. DNA also makes appearances in the movie Jurassic World (2015) and the Netflix TV series Jurassic World Camp Cretaceous (2020-2022).
- DERN (66A: "Marriage Story" actor Laura) Marriage Story is a 2019 movie about a married couple navigating a divorce. Laura DERN played the role of Nora Fanshaw, the lawyer representing the wife (played by Scarlett Johansson). Laura DERN won an Academy Award for Best Supporting Actress for the role.
- IMANI (7D: Black Lives Matter activist and historian Blair) I learned about author, historian, and activist Blair IMANI from the April 5, 2024 puzzle . Her most recent book is titled Read This to Get Smarter about Race, Class, Gender, Disability & More (2021).
- JAPAN (21D: Tokyo 2020 host country) The 2020 Summer Olympics, branded as Tokyo 2020, were held in JAPAN in 2021 after being postponed due to the COVID-19 pandemic.
- KNOWS (49D: "I Think He ___" (Taylor Swift song)) "I Think He KNOWS" is a song from Taylor Swift's 2019 album, Lover.
- OGRES (51D: "___ are like onions" ("Shrek" quote)) "OGRES are like onions ... we both have layers," - Shrek.
- IMS (55D: Chat on AIM, e.g.) I was just reminded of AIM (AOL Instant Messenger) two days ago , and that information came in handy today.
- OREO (63A: "Twist, lick, dunk" cookie)
- DOCTORAL (8D: Word before "candidate" or "dissertation")
- BAT PHONE (35D: Private number used to call the Caped Crusader)
Crossword Puzzle Theme Synopsis
- JOIN THE CLUB (21A: "You and me both")
- BRING TO LIGHT (35A: Make evident)
- THINKING CAP (54A: Metaphorical headwear for brainstorming)
The last word of each theme answer can follow the word NIGHT to form a new phrase: NIGHT CLUB, NIGHT LIGHT, and NIGHT CAP.
USA TODAY crossword titles describe the puzzle's theme in some way (unless the puzzle is a freestyle, or themeless puzzle). Often this includes a hint telling solvers what part of the theme answers is involved in the theme. The word LATE in today's title serves that purpose, alerting solvers that it is the last word of each theme answer that relates to the word NIGHT. Thank you, Darby, for this excellent puzzle.
For more on USA TODAY’s Crossword Puzzles
- USA TODAY’s Daily Crossword Puzzles
- Sudoku & Crossword Puzzle Answers
- Share full article
Advertisement
Supported by
Sue Johnson, Psychologist Who Took a Scientific View of Love, Dies at 76
She believed the bond between adults was as sustaining as that between parent and child, and developed a therapy to strengthen and repair broken relationships.

By Penelope Green
Sue Johnson, a British-born Canadian clinical psychologist and best-selling author who developed a novel method of couples therapy based on emotional attachment, challenging what had been the dominant behavioral approach — the idea that behaviors are learned and thus can be changed — died on April 23 in Victoria, British Columbia. She was 76.
Her death, in a hospital, was caused by a rare form of melanoma, said her husband, John Douglas.
When divorce rates rose in the 1970s, couples therapy blossomed. Drawing from traditional psychotherapy practices, therapists focused mostly on helping distressed couples communicate more effectively, delve into their upbringings and “negotiate and bargain,” as Dr. Johnson put it, over divisive issues like parenting, sex and household chores.
In her own practice, however, she became frustrated at how her couples seemed to be stalling out.
“My couples didn’t care about insight into their childhood relationships,” she wrote in her book “Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love” (2008), which has sold more than a million copies and been translated into 30 languages. “They didn’t want to be reasonable and learn to negotiate. They certainly didn’t want to be taught rules for fighting effectively. Love, it seemed, was all about nonnegotiables. You can’t bargain for compassion, for connection. These are not intellectual reactions; they are emotional responses.”
In conventional therapy that sought to modify behavior, emotions had long been dismissed as problematic in dealing with marital issues — something to be tamed — and dependence on a loved one was seen as a sign of dysfunction.
Dr. Johnson thought otherwise. She knew of the attachment studies of John Bowlby , the British psychiatrist who studied children who had been traumatized by being orphaned or separated from their parents during World War II. Later researchers began to focus on adult attachments and noted how secure connections among couples helped them weather the inevitable storms of relationships.
Dr. Johnson began to see a couple’s mutual emotional dependence not as a weakness but as a strength, and thus developed techniques to help couples enhance those bonds. While working toward a Ph.D. at the University of British Columbia, she videotaped her therapy sessions and analyzed couples’ behaviors, from which she shaped a model of treatment with the help of her thesis adviser, Leslie Greenberg. They called it Emotionally Focused Therapy, or E.F.T.
They then tested their method by giving some couples behavioral therapy, some E.F.T., and others no therapy at all. The couples who had undergone E.F.T. fared the best: They fought less, felt closer to each other, and “their overall satisfaction with their relationships soared,” Dr. Johnson wrote.
She honed her method using the paradigm of attachment theory, which notes that pair bonding — the term for selective associations between two individuals of the same species — is a survival technique developed over millions of years of evolution. Her thesis was a scientific view of love.
But when she published her work, colleagues cried foul. They argued, she wrote, that “healthy adults are self-sufficient. Only dysfunctional people need or depend on others. We had names for these people: they were enmeshed, codependent, merged, fused. In other words, they were messed up.”
Decades of E.F.T. studies proved her colleagues wrong, she said. Nearly 75 percent of couples who went through the therapy, she wrote, reported being happier in their relationships, even those at high risk for divorce. E.F.T. has been recognized by the American Psychological Association as an evidence-based approach and is now taught in graduate schools and internship programs.
“By focusing on creating the security of the attachment between couples,” said Dr. John Gottman, co-founder of the Gottman Institute in Seattle, which seeks to strengthen relationships, “Sue focused on the idea of trust, and how couples can build trust with one another in the moment, and it changed everything in the field of couples therapy.”
Dr. Julie Gottman, his wife and co-founder, added, “In some ways we all remain children, and when we reach out for a lifelong love with our partners, we really have to know we’re fully accepted and embraced in the same way a parent embraces a child, and with that kind of acceptance people can really blossom.”
Studies have shown that consistent emotional support and strong partner bonds lower blood pressure, strengthen the immune system and reduce the death rate from cancer and the incidence of heart disease.
“In terms of mental health,” Dr. Johnson wrote in “ Love Sense: The Revolutionary New Science of Romantic Relationships ” (2013), “close connection is the strongest predictor of happiness, much more than making masses of money or winning the lottery. It also significantly lessens susceptibility to anxiety and makes us more resilient against stress and trauma.”
In 2007, Dr. Johnson set out to show how E.F.T. affected the brain. She worked with Dr. James Coan , a neuroscientist at the University of Virginia, who had shown, by scanning areas of the brain that register fear, how hand-holding would relieve stress in couples.
First, Dr. Johnson recruited heterosexual couples who reported being unhappy in their relationships. Researchers then subjected the women to electric shocks while their partners held their hands. For these couples, the hand-holding had no effect. Then, Dr. Johnson treated the same couples with a course of E.F.T. — about 20 sessions — and repeated the test. On the second try, the area of the women’s brains that would respond to threats stayed quiet.
“It was amazing, because this is what Sue had predicted as far back in 1989 without knowing anything about the brain,” Dr. Coan said. “She was a model for doggedly subjecting her therapeutic intuitions to scientific testing. You have to be a scholar of clinical psychology to understand how rare this is.”
“Love is a basic survival code,” Dr. Johnson wrote in “Love Sense.”
Susan Maureen Driver was born on Dec. 19, 1947, in Gillingham, England, the only child of Arthur and Winifred Driver. The Drivers ran a pub called the Royal Marine, and Sue grew up in its boisterous environment. “I spent a lot of time watching people meeting, talking, drinking, brawling, dancing, flirting,” she wrote. Her parents’ relationship was chaotic and contentious, and they divorced when she was 10.
She earned a degree in English literature at the University of Hull in East Yorkshire before moving to Canada, where she earned a master’s degree in literature and history at the University of British Columbia and worked as a counselor at a residential center for troubled teenagers. After beginning training as a therapist, she enrolled in a doctoral program in psychology and earned her Ph.D. in 1984. Her dissertation was about her work with E.F.T., and she was hired by University of Ottawa to teach in its department of psychology.
Dr. Johnson was married briefly in the 1970s and kept her first husband’s surname. She met Mr. Douglas, who was managing an engineering firm, in 1987, and they married a year later. In addition to Mr. Douglas, she is survived by their children, Sarah Nakatsuka and Tim and Emma Douglas.
In 1998, with Mr. Douglas and others, Dr. Johnson co-founded the International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy . It trains and certifies therapists around the world in E.F.T. and conducts clinical studies in the method. Both the Canadian and American military have offered E.F.T. programs to service members, and E.F.T. has been used to reduce stress among couples coping with a partner’s heart disease, diabetes or Parkinson’s disease.
“Underneath all the distress,” Dr. Johnson said, “partners are asking each other: Can I count on you? Are you there for me?”
Penelope Green is a Times reporter on the Obituaries desk. More about Penelope Green

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
En effet, Gargantua recèle de réelles critiques religieuses et politiques. Le chapitre , par exemple, intitulé « Pourquoi les moines sont refuis du monde, et pourquoi les uns ont le nez plus grand que les autres », remet en cause avec virulence l'utilité des moines, appelés « mâchemerdes » et comparés au singe qui ne fait que « tout conchier et dégâter ».
Voici une dissertation sur Gargantua de Rabelais (parcours au bac de français : Rire et savoir). Important : Pour faciliter ta lecture, le plan de cette dissertation est apparent et le développement est présenté sous forme de liste à puces. N'oublie pas que le jour J, ton plan et ton développement doivent être intégralement rédigés.
D'autres épisodes reposent sur un comique de situation efficace : ainsi, l'ingestion impromptue par Gargantua de pèlerins cachés dans une salade interrompt avec humour la guerre picrocholine.. 2. Grossièretés et obscénités. Le roman s'inspire du registre de la farce par ses nombreuses allusions grivoises qui ont valu à Rabelais une réputation d'obscénité et de paillardise.
Dissertation : proposition de corrigé Sujet : Gargantua est-il, comme l'affirme Montaigne dans ses Essais, un ouvrage « simplement plaisant » ? Introduction Au XVIe siècle, le terme « plaisant » désigne celui ou ce qui produit un divertissement agréable ou qui suscite le rire. Or dans la littérature médiévale, notamment les écrits
Nous proposons ici une dissertation sur Gargantua ( résumé chapitre par chapitre ICI) de l'auteur humaniste Rabelais qui porte sur la question posée par le parcours associé « rire et savoir ». Ci-après, la problématique et le plan détaillé de la dissertation. GARGANTUA DISSER TATION: SUJET.
Gargantua François Rabelais 5 sujets de dissertation possibles au bac de français Ces 5 sujets sur Gargantua sont liés au thème du parcours : « Rire et savoir ». Découvrez mon sujet corrigé en fin de vidéo ! Sujet #1 Un premier sujet qui va vous aider à trouver et présenter plusieurs fonctions du rire dans Gargantua.
de Gargantua et votre connaissance du parcours « Rire et savoir ». Conseils de méthode Pour éviter le hors-sujet, pour approfondir votre réflexion, il faut soi-gneusement étudier le sujet. En effet, la dissertation n'est pas une ques-tion de cours, mais une réponse personnelle, organisée, à une question précise. • Soulignez les ...
sous cet angle, le Gargantua est élan, volonté déclarée de changement. » Gérard Defaux, Préface de Gargantua, 1994. Dans uelle mesu e le i e d'un é ivain est-il victorieux ? Vous organiserez votre réflexion en prenant appui sur Gargantua et son parcours associé « Rire et savoir ».
Gargantua François Rabelais 5 sujets de dissertation possibles au bac de français Ces 5 sujets sur Gargantua sont liés au thème du parcours : « Rire et savoir ». Découvrez mon sujet corrigé en fin de vidéo! Sujet #1 Sujet Un premier sujet qui va vous aider à trouver et présenter plusieurs fonctions du rire dans Gargantua.
30 sujets de dissertation sur Gargantua. Très chers buveurs très illustres, veuillez vous servir dans la coupe ci-dessus pour trouver l'inspiration qui vous permettra de proposer à vos élèves des sujets de dissertation stimulants sur le plus fameux roman de l'ami Rabelais. 1.
Le roman Gargantua relËve du merveilleux, en mettant en scËne et en faisant coexister des personnages de nature diffÈrentes, hommes ordinaires et gÈants. Gargantua constitue bien une Suvre de divertissement, racontant les aventures d'un héros. L'ouvrage reprend ainsi le schéma d'un roman de chevalerie, en racontant l'enfance ...
Votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Rabelais, Gargantua au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture littéraire. « Un rire désormais victorieux y balaie sans résistance le vieux roi, le vieux monde, la vieille année. Rabelais, en fidèle disciple d'Erasme, y dit son mot sur tout
Pour réussir le bac de français, regardez cette analyse d'une dissertation d'élève sur _Gargantua_ de Rabelais. Je fais des remarques utiles pour vous faire ...
Consulter la correction des deux sujets ... Dissertations littérature d'idées 2022 Rabelais Gargantua/ Parcours: "Rire et savoir".chapitres XI à XXIV "La bonne éducation". La Bruyère, "Les Caractères", livres V à X / "Parcours : "La comédie sociale". livre XI "De l'Homme" "Peindre les Hommes, examiner la nature humaine".
Sujet #1 Le rire chez Rabelais n'est-il qu'un amusement ? Plan détaillé: I. Le rire comme amusement A. La présence du burlesque et de l'exagération B. L'usage des jeux de mots et de la parodie II. Le rire comme vecteur de critique sociale A. La satire des institutions et des personnages B. Le rire pour souligner l'absurdité et l'injustice III. Le rire comme pédagogie A. La ...
BAC DISSERTATION GARGANTUA. Parcours rire et savoir : Intro : François Rabelais publie en 1534 Gargantua, sous le pseudonyme anagramme d' Alcofribas Nasier, nom qu'il avait déjà utilisé pour Pantagruel, père de Gargantua, personnage qui a fait l'objet de son premier roman en 1532. Ces deux œuvres comiques et satiriques relatent les ...
INITIATION A LA DISSERTATION Au ous de son œuve Gargantua, Rabelais accorde une grande place à la politique. Il s'empesse, en patiulie, de desse le potait d'un etain nome de figues oyales. Quelles visions du Roi propose-t-il au lecteur ? Vous répondrez à cette question en prenant appui sur le roman Gargantua que vous avez lu.
13 commentaires. Voici un résumé et une analyse (fiche de lecture) de Gargantua de Rabelais. François Rabelais a publié Gargantua en 1534 sous le pseudonyme Alcofribas Nasier (anagramme de François Rabelais !) déjà utilisé pour Pantagruel en 1532. Ces deux œuvres comiques et satiriques relatent les aventures de deux géants et leurs amis.
La dissertation sur un sujet littéraire nécessite une compréhension approfondie de l'œuvre et une analyse claire de ses thèmes et de son style. Parmi les œuvres littéraires les plus étudiées figure 'Gargantua', écrit par François Rabelais, un écrivain français de la Renaissance. Cet article sert de guide détaillé pour ...
Analysing Rabelais's Prologue to Gargantua and Dolet's Commentaries on the Latin Language, Banks shows that both fiction and lexicography highlighted semantic continuities between the abstract and the embodied by moving between the two, reflecting humanism's "language turn.". However, Rabelais's switches between embodied and ...
Rabelais, Gargantua : dissertation Énoncé Sujet : « Le rire de Rabelais est en grande partie un superbe déguisement pour essayer de détourner les ennemis, brouiller les pistes, éviter les censures si terribles alors.
Dans Gargantua, le rire est un outil d'éducation et de transmission : il porte un savoir précieux, des valeurs fondamentales, il entretient l'imagination, l'inventivité, et un profond désir d'indépendance.
Dorothy Jean Tillman II at Arizona State University's commencement in Tempe, Ariz., this month. Ms. Tillman earned her doctoral degree in integrated behavioral health from the school at age 17.
Random Thoughts & Interesting Things. CGI (9A: SFX in many sci-fi movies) SFX here stands for "special effects." The abbreviation alerts solvers that the answer will be an abbreviation.
Schroeder came upon John Jacobs's 1855 narrative by an odd back door. Back in 2017, he was fresh out of graduate school in English, and trying to turn his Ph.D. dissertation about the history of ...
Sue Johnson, a British-born Canadian clinical psychologist and best-selling author who developed a novel method of couples therapy based on emotional attachment, challenging what had been the ...