

4 exemples de dissertation sur la Démocratie (1 corrigée)
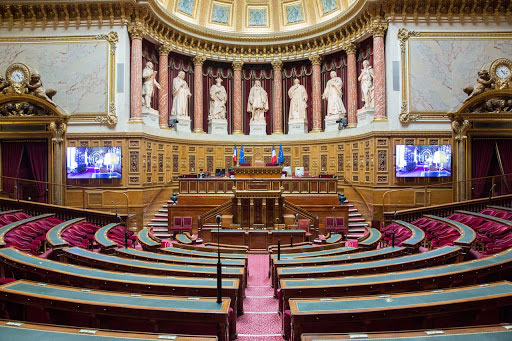
- Blog Prépa scientifique 4 exemples de dissertation sur la Démocratie (1 corrigée)
Nous vous proposons ici 4 sujets de dissertations sur le thème de la démocratie , au programme 2020 des épreuves de français-philo en prépa scientifique. Le sujet 3 est entièrement corrigé. En espérant que cela vous sera utile dans vos révisions pour éviter des erreurs en français aux concours . Vous vous rendrez compte que pour performer en dissertation il faut lire les œuvres au programme , mais cela ne suffit pas, il faut savoir les faire communiquer entre elles.
Si vous ressentez le besoin, vous pouvez faire appel à des cours de français à domicile ou des cours particuliers de philosophie pour vous aider à mieux comprendre les concepts et mieux comprendre ce qui est attendu de vous en termes de méthodologie de la dissertation.
STAGE INTENSIF MATHS SUP
Profite de tes vacances pour progresser en maths et physique.
96% de réussite aux concours 84% dans le TOP 10 99% de recommandation à leurs amis
Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5
Sujet de dissertation sur la démocratie n°1 : l’exemple d’une citation longue
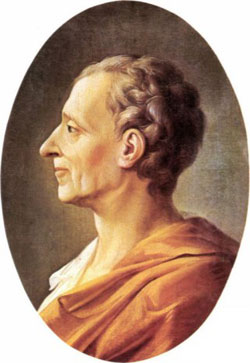
Dans De L’Esprit des lois , Montesquieu écrit que « Une autre espèce de démocratie, c’est celle où toutes les autres caractéristiques sont les mêmes, mais où c’est la masse qui est souveraine et non la loi. C’est le cas quand ce sont les décrets qui sont souverains et non la loi. Cela arrive par le fait des démagogues. […] Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues ; le peuple, en effet, devient monarque, unité composée d’une multitude , car ce sont les gens de la multitude qui sont souverains, non pas chacun en particulier mais tous ensemble. […] Donc un tel peuple, comme il est monarque, cherche à exercer un pouvoir monarchique, parce qu’il n’est pas gouverné par une loi, et il devient despotique, de sorte que les flatteurs sont à l’honneur, et un régime populaire de ce genre est l’analogue de la tyrannie parmi les monarchies.
C’est pourquoi le caractère de ces deux régimes (Le premier est “l’autre espèce de D” soit la monarchie où le peuple est une “masse” et l’autre est la tyrannie) est le même, tous deux sont des despotes pour les meilleurs, les décrets de l’un sont comme les ordres de l’autre, et le démagogue et le courtisan sont analogues et identiques. Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. »
Discutez le propos de ce philosophe à la lumière de votre lecture des œuvres au programme du thème 2020 sur la démocratie .
La glose du sujet de dissertation en démocratie : définition des mots-clés et explicitation de l’idée générale
Introduction dissertation démocratie : la recherche des mots-clés :
PHRASE 1 – > 1. “autre espèce de démocratie” / 2. “autres caractéristiques” / 3. “la masse” / 4. “la loi”.
- Cette expression sous-tend que la démocratie n’est pas forcément un concept unique et indivis même si on aurait pu le penser au premier abord.
- Tous les éléments de définition sont identiques sauf ceux énoncés dans la proposition relative introduite par “où” (pronom relatif qui reprend “autre espèce de démocratie”).
- + 4. La différence de cette “autre espèce” consiste en ce que le pouvoir soit aux mains de la “masse” et non de la “loi”.
PHRASE 2 -> “décrets” désigne une décision arbitraire sans le consensus du vote que nécessite une “loi”.
PHRASE 3 -> 1. “démagogues” -> désigne celui qui dit aux “gens” ce qu’ils veulent entendre. (Étymologiquement : celui qui mène le peuple selon son bon vouloir)
PHRASE 4 -> 1. “le peuple devient monarque” / 4. “unité composée d’une multitude” / 3. “les gens de la multitude qui sont souverains” / 2. “Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues”
- + 4 Le peuple devient monarque car il n’y a plus d’individualisation : c’est un tout, une unité. Cela rappelle le mot de “masse” très péjoratif. On sent le désaveu de Montesquieu.
- Quand les décrets supplantent la loi c’est là que les démagogues entrent en jeu : l’opinion devient trop importante.
PHRASE 5 -> 1. “un tel peuple… devient despotique” / 2. “cherche à exercer un pouvoir monarchique, parce qu’il n’est pas gouverné par une loi” / 3. “les flatteurs sont à l’honneur” / 4. “et un régime populaire de ce genre est l’analogue de la tyrannie parmi les monarchies”
- + 2 Un peuple, lorsqu’il n’est pas gouverné par une loi, devient despotique ; ce dernier terme s’oppose à “monarque” en ce qu’un despote a une volonté d’assujettissement de ceux qu’il gouverne. Il y donc une notion de danger ici.
- “populaire” = “qui plaît au peuple” ou “qui vient du peuple”. Un régime POUR (idée de la flatterie qui infléchit ledit peuple pour le profit du flatteur) le peuple et PAR le peuple.
PHRASE 6 -> Montesquieu développe l’analogie monarchie (= autre espèce de démocratie) / tyrannie : décrets / ordre, démagogue (flatte le peuple souverain) / courtisan (flatte le tyran)
PHRASES 7 et 8 -> Dans la démocratie qui n’est pas cette “autre espèce de D”, le peuple a élu des représentants. Ceux-ci permettent d’éviter le travers des décrets dénoncés par Montesquieu. En Effet, eux “sont capables de discuter les affaires”. La démocratie représentative, parce qu’elle s’appuie sur une constitution, ne risque donc pas de verser dans la tyrannie.
Propositions de problématiques de la dissertation démocratie n°1
Faites par des élèves du stage en maths spé et stage maths sup :
- Les représentants peuvent-ils éviter la dérive de la démocratie vers un régime despotique ?
- Quelles causes peuvent mener le peuple d’une démocratie vers le despotisme? (Quels éléments font que le peuple en démocratie peut tendre vers le despotisme ? (problème: faire: verbe pauvre)) faire : verbe vicaire.
- Quelle est l’importance des lois en démocratie ? // À quel point les lois sont-elles importantes dans une démocratie ? La démagogie est-elle inhérente à la démocratie ?
- Faut-il que le gouvernement d’un peuple démocratique soit mené par la globalité ou une portion élue/choisie de celui-ci ?
- Existe-t-il une forme de démocratie exempte de tout attrait vers la tyrannie ? La démocratie que plébiscite Montesquieu est-elle vraiment exempte de tout attrait vers la tyrannie parce qu’elle est représentative ?
Proposition finale de problématique faite par le prof qui donne cours en stage :
Nous pouvons nous demander si la démocratie, bien qu’elle mette par définition le pouvoir aux mains du peuple, demeurerait éloignée de la tyrannie en restreignant la souveraineté dudit peuple par le biais de ses représentants élus.
La multitude n’a pas de volonté propre, le démagogue tire son profit de ce fait puisqu’il insuffle (par la flatterie ou la rhétorique) sa propre volonté à cette multitude, c’est ce qui donne le peuple, qui lui a une volonté.
Par hypothèse, la multitude est inerte : pas de volonté propre. Le démagogue lui, par la flatterie ou la rhétorique, va insuffler son opinion personnelle pour son propre profit. On obtient ainsi le peuple monarque dont Montesquieu parle ici. Ce peuple tend vers le despotisme en raison de…
COURS PARTICULIERS PRÉPA SCIENTIFIQUE
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs professeurs particuliers en prépa., pour accélérer ma progression en prépa, sujet de dissertation en démocratie cpge n°2 (le sujet philosophique).
Peut-on attendre de la démocratie qu’elle soit conforme aux exigences de la raison ?
Vous répondrez à cette question en en faisant jouer le propos dans les œuvres au programme.
Piste -> la démocratie est aux mains de tout le monde. Chaque individu ayant une logique distincte d’autrui, on ne peut pas exiger de la démocratie qu’elle suive la raison au sens absolu.
Sujet de dissertation n°3 démocratie en prépa : l’exemple d’une citation brève
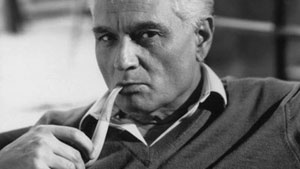
Dans Le Monde de l’éducation , Jacques Derrida écrit en 2000 que « L’historicité, la perfectibilité infinie, le lien originaire à une promesse font de toute démocratie une chose à venir. »
Vous analyserez et commenterez cet avis en raisonnant à partir de votre lecture des œuvres au programme.
Glose des mots-clés pour le sujet n°3
“Historicité” : fait d’être inscrit dans l’Histoire. La démocratie a marqué l’Histoire de l’humanité.
“La perfectibilité infinie” : plus le temps avance, meilleur est la D.
“Le lien originaire à une promesse” : cette promesse est celle de confier le pouvoir au peuple. “Lien” peut être pris en bonne comme en mauvaise part : attachement ou emprisonnement.
“Chose à venir” : plus le temps progresse, plus on s’approche d’une démocratie aboutie.
-> la citation de Derrida s’intéresse à la démocratie soumise à l’avancée du temps.
Propositions de problématique pour le sujet de dissertation sur la démocratie n°3
Par les élèves du stage de Pâques en prépa maths spé :
- La démocratie dans son intemporalité est-elle à l’abri d’un despotisme ?
- Nous pouvons nous demander si la démocratie, bien que perfectible dans le temps, n’est pas muselée par sa promesse, et donc imperfectible. (pb: museler) Imaginons que dans l’amorce il ait expliqué que “La promesse lie la démocratie à son origine : on peut comprendre ce lien en bonne part comme une continuité ou en mauvaise part comme un musellement.” + il aurait fallu avoir expliciter ce qu’est cette “promesse”.
- En quoi l’Histoire et la condition (même) selon Derrida de la démocratie font indéfiniment tendre l’Homme vers un idéal de démocratie ?
- La démocratie est-elle condamnée à une éternelle insatisfaction ?
- La poursuite de l’idéal démocratique voue-t-elle le citoyen d’une démocratie à l’insatisfaction ?
Proposition finale d’une problématique par le prof
Bien que la démocratie soit sempiternellement imparfaite à l’instant présent, la promesse qui la fonde justifie-t-elle qu’on continue de tenter de la mener à son aboutissement ? ( semper en latin signifie “toujours” ; “sempiternellement” = “qui dure toujours”)
ATTENTION On pourrait être tenté d’adopter un plan :
- I) Historicité
- II) Perfectibilité infinie
III) Lien originaire à une promesse
À NE PAS FAIRE
L’annonce de plan dans l’introduction dissertation démocratie qui suit s’appuie sur la proposition finale de problématique
I] Nous rappellerons d’abord que la démocratie existe, même imparfaitement, et que son existence est le témoignage d’une promesse qu’elle cherche à tenir.
II] Puis nous montrerons que, selon l’idéal (égalitaire) de la démocratie, elle est nécessairement à venir : la promesse doit toujours être menée à bien.
III] La démocratie n’est donc pas un état de fait mais une dynamique en mouvement : l’idée même de sa perfectibilité l’inscrit dans l’Histoire.
Dissertation sur la démocratie : développement du plan pour le sujet n°3
I] Ce n’est pas parce qu’une démocratie tend vers sa perfection qu’elle n’est pas une démocratie à l’instant T
- En quoi la démocratie est un régime fonctionnel / montrer qu’elle fonctionne puisqu’elle permet à chaque citoyen de s’exprimer librement // exemples : Assemblée -> bien que le système ait été dévoyé, l’Ekklesia offre aux citoyens athéniens, et ici aux femmes en particulier, la possibilité de transformer une volonté en une réalité politique / Complot : la liberté de la presse est fondamentale en D, on le voit avec Wheeler : il est AUTORISÉ à parler même si le régime de Lindbergh ne le SOUTIENT pas
- Une démocratie est, au départ, une solution pour résoudre certains maux : guerre, famine, conflit même si elle n’est pas forcément achevée ou idéale // exemples : Cavaliers -> Athènes ne va pas très bien en raison du contexte de la guerre du Péloponnèse HÉLIE (6000 héliastes = juges tirés au sort par an) / BOULÈ (élus) / EKKLESIA (libre d’accès) Aristophane critique au moment de l’écriture des Cavaliers le fait que Cléon ait corrompu les héliastes qui sont payés pour siéger et au moment de l’écriture de L’Assemblée il dénonce le paiement du triobole des ekklesiastes qui ne viennent plus siéger que pour cet argent sans participer aux débats. Tocqueville : Expose souvent les raisons de l’origine de la D.
- Une démocratie imparfaite, elle rencontre tout de même des pb // exemples : Cavaliers -> critique de la démocratie dans un but didactique avec l’exhibition de Démos mangeant sa pâtée / Tocqueville : même but didactique, il a écrit son essai pour prévenir les dangers et donner des moyens de les curer / Complot : avec Lindbergh, elle est “partiellement et partialement” imparfaite ; les juifs y sont lésés mais la majorité des citoyens voient ce régime comme une D. Roth est contre le système de politique intégrative mais, dans l’économie de ce roman et selon le point de vue de la majorité des Américains, c’est la famille Roth qui est anti-démocratique.
II] Mener la démocratie à son terme, c’est répondre à la promesse de son origine
III] La démocratie est une dynamique qui l’inscrit dans l’Histoire (cf. La démocratie est providentielle selon Tocqueville)
- c) Il faut engager la responsabilité citoyenne :
La responsabilité citoyenne est donc engagée : il faut véritablement vouloir aller de l’avant. C’est pourquoi le roman de Roth se focalise sur le jeune Philip, entouré de jeunes gens : son frère Sandy, son cousin Alvin, ses amis Earl et Seldon. La jeunesse de ces personnages met en scène la destinée encore à dessiner de l’Amérique. Et cette destinée est plurielle tout en étant plus ou moins inféconde : Seldon sauve Philip alors que le protagoniste l’abhorre ; Earl doit déménager pour rejoindre son père alors qu’il éveillait Philip à des horizons nouveaux. La jeunesse est en effet le moment charnière, où se forgent les consciences, à la fois par le milieu et par les discours qui nous entourent. En partageant le lit voisin à celui de Philip, Sandy, Alvin puis Seldon forgent son caractère, l’inspirent, le font réfléchir et lui permettent de devenir quelqu’un sur qui on peut compter . Pour éviter les dangers qui parsèment la route, longue et sinueuse, de la démocratie, les citoyens doivent être capables de concevoir ce qui est encore à améliorer. Démos, dans Les Cavaliers, caricature le peuple qui serait incapable de se caricaturer lui-même, à l’inverse de Tocqueville qui cherche à la fin de son essai à « embrasser d’un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau ». Il revient bien aux citoyens de garder le cap, pour garder la démocratie dans cette dynamique de perfectibilité.
Proposition de corrigé dissertation démocratie du sujet n°3
Je vous propose ci-après une correction de la dissertation portant sur le sujet de Derrida dans Le Monde de l’éducation. À plusieurs reprises, j’y inclus des remarques à votre attention en bleu. J’ai mis les grands titres qui évidemment ne figureraient pas plus que lesdites remarques dans une copie. Si nécessaire, vous pouvez revenir vers moi pour que je vous donne les titres de chaque sous-partie. Je peux également vous préciser quelle logique suit l’articulation d’une idée à une autre même si, après relecture, cela me semble clair.
Lorsque Simone Weil définit la démocratie comme « [un moyen] en vue du bien », la philosophe refuse de voir la démocratie comme une fin en soi, comme un aboutissement. Elle dit en l’espèce que la démocratie est un outil que les peuples démocratiques utilisent pour s’accomplir. Cette position est contredite par un propos de Jacques Derrida : « l’historicité, la perfectibilité infinie, le lien originaire à une promesse font de toute démocratie une chose à venir ». La démocratie n’est ici plus un état de fait – et elle ne peut donc plus être un outil – elle est « à venir » : elle n’est donc plus un moyen dont disposeraient les hommes en vue d’une autre fin mais devient sa propre fin. La proposition peut déconcerter. Ne vivons-nous pas en démocratie ? De nombreux régimes dans le monde étant constitués sous ce terme, ce nom de « démocratie » serait-il pourtant impropre ? On peut aisément entendre qu’elle est perfectible – son système électoral reflète mal la volonté du peuple dans son ensemble certaines de ses institutions semblent bien éloignées de ses préoccupations ; mais cette imperfection justifie-t-elle qu’on la considère nécessairement incomplète ? Partant, il conviendra de se demander si bien que la démocratie soit sempiternellement imparfaite à l’instant présent, la promesse qui la fonde justifie qu’on continue de tenter de la mener à son aboutissement. Nous rappellerons d’abord que la démocratie existe, même imparfaitement, et que son existence est le témoignage d’une promesse qu’elle cherche à tenir. Puis nous montrerons que, selon l’idéal égalitaire de la démocratie, elle est nécessairement à venir : la promesse doit toujours être menée à bien. La démocratie n’est donc pas un état de fait mais une dynamique en mouvement : l’idée même de sa perfectibilité l’inscrit dans l’Histoire.
(I) Ce n’est pas parce qu’une démocratie tend vers sa perfection qu’elle n’est pas une démocratie à l’instant T)
Nous ne pouvons pas nier que nous vivons dans des régimes que l’on appelle « démocratie ». Ces régimes ont été établis pour répondre à la promesse d’instaurer l’égalité entre les hommes. La démocratie est une réponse politique à la forme que doit prendre le vivre ensemble. À son fondement, il y a une promesse qui lie entre eux les individus qui acceptent cette forme de gouvernement. Ainsi, expliquer comment s’est fondée la démocratie permet d’expliquer son évolution. C’est le sens de la démarche de Tocqueville, comme le montre le titre de la quatrième partie du deuxième tome de son essai, « De l’influence qu’exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société politique » . L’instauration de ce régime, qui paraît si neuf et si faillible aux Européens du XIXe siècle, est une réponse à la tension entre égalité et liberté qui le sous-tend et cette tension, non résolue par la seule constitution du régime, continue d’agir sur les citoyens américains. Le quatrième tome de De La Démocratie en Amérique vient pousser les effets des conclusions américaines dans les démocraties de l’Europe et tend à montrer au lectorat contemporain de l’auteur que, chez eux aussi, la démocratie a toute sa place. Dans L’Assemblée des femmes , la prise de pouvoir par les femmes montre une évolution comique et fantasmée de la société et non une véritable révolution qui mettrait fin au régime. En inventant de nouvelles lois, les femmes impulsent une forme nouvelle à la démocratie athénienne, que l’on célèbre lors du banquet à la fin de la pièce. Ainsi, chez Aristophane comme chez Roth, les œuvres se terminent sur une image, certes nouvelle, de la démocratie. En effet, dans Le Complot contre l’Amérique, le lecteur découvre à la fin ce qu’il connaît déjà pourtant bien : en sortant de la temporalité uchronique, il est soulagé de revenir à ce régime qu’il avait perdu le temps du roman. Cette image nouvelle s’explique par le fait que la démocratie tient sa promesse de manière évolutive. Loin d’être finie une fois instaurée, elle s’inscrit dans l’histoire, qui peut être vue en ce sens comme progressive. ***
La démocratie se réinvente à chaque fois que change la forme que prend la réponse à la promesse initiale. La fantaisie de L’Assemblée des femmes illustre ces changements possibles. La hiérarchie sociale du début de la pièce fait place à un communisme nouveau, où l’égalité est élevée en principe supérieur à la liberté ; c’est pourquoi le Jeune homme finit par céder sa liberté aux Vieilles qui revendiquent l’égalité de ses faveurs. Roth aussi met en scène ce qui fait évoluer la société et pendant la majeure partie du roman, les États-Unis font l’expérience d’un État nouveau. Par leur vote, les citoyens américains ont exprimé le choix d’un nouveau venu en politique, bien plus jeune que le plus âgé et plus expérimenté président en place. Cette expérience qui s’avère funeste est vite abandonnée. Dans les deux cas, on voit que la démocratie sait s’interroger, qu’elle mue selon les choix que les votes expriment et que ces changements peuvent être abrogés s’ils sont jugés néfastes. L’évolutivité caractérise donc les régimes démocratiques. ***
Comment comprendre ces aléas, si on considère l’histoire comme un progrès constant et absolu ? Il ne faut pas oublier qu’il y a, en plus de la promesse, une mythologie de l’origine : l’origine devient elle-même un discours qui alimente l’imaginaire des citoyens. Cela a deux effets : le premier, positif, permet de consolider la démocratie, solidement fondée par et dans cet imaginaire collectif. Le second est plus négatif, car au nom d’une promesse initiale, il peut y avoir la volonté réactionnaire d’un retour aux origines. L’importance de cet imaginaire est rappelée par Tocqueville : « chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd dans la foule, et l’on n’aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même » . On le devine aussi dans la philatélie du jeune Philip, dont l’imaginaire de l’Amérique passe par les timbres, ses images officielles. Le cauchemar de les voir souillés par la croix gammée est une mise en abîme du cauchemar de l’uchronie. On se donne des images effroyables pour se rassurer de l’image de la démocratie qu’on a : imparfaite mais bel et bien là et fidèle à ce que l’on attend d’elle. ***
Cependant, puisque la réponse démocratique ne cesse de se chercher, on est en droit de dire que l’avènement de la démocratie n’a pas encore eu lieu.
NB : Je précise ici une chose dont nous n’avons pas parlé : la transition. Une transition DOIT être ménagée entre chaque grande partie. Théoriquement, elle reprend sommairement ce qui a été dit et annonce ce qui va suivre. La transition qui précède ici ne donne, formellement, que l’annonce de la suite. Mais si vous regardez la dernière phrase de la troisième sous-partie, vous verrez que j’ai rédigé la conclusion partielle de sorte qu’elle soit aussi la première partie de la transition. En outre, pour la mise en page, ne sautez pas de lignes entre les sous-parties d’une même grande partie ; Google doc m’y contraint et c’est la raison pour laquelle il y a ici des sauts de ligne à supprimer que je signale par ***. Si ces questions formelles de mises en page ne sont pas claires pour vous, n’hésitez pas à me demander des précisions.
(II) Mener la démocratie à son terme, c’est répondre à la promesse de son origine)
Nous disions plus haut vivre en démocratie, une démocratie qui est donc. Mais on peut légitimement inverser la proposition en repartant de l’idée de Derrida : si la démocratie est perfectible, c’est qu’elle n’ est pas encore, du moins pas tout à fait. Le premier problème relève encore de l’imaginaire. Comment nommer et concevoir cette « chose à venir » ? Il faut être visionnaire, comme veut l’être Tocqueville qui affirme tout le long De La Démocratie en Amérique vouloir réussir à théoriser ce qui n’est encore qu’embryonnaire, innommé. C’est cette notion même qu’il explique lorsqu’il imagine le despotisme d’un nouveau genre hérité de l’égalitarisme excessif : « La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer. » Mais comment tendre vers quelque chose que l’on ne peut pas encore voir ? L’imaginaire des origines, le souvenir de cette origine mythologique peuvent donc bloquer la marche en avant de la démocratie, en s’imposant contre l’idéal promis ou plutôt l’imaginaire dudit idéal promis vers lequel il faut tendre. Dans Les Cavaliers , le Charcutier préfère raconter au Chœur comment il l’a emporté sur le Paphlagonien au Conseil, sans se soucier une seule fois de ce qu’il était bon de faire pour la cité. *** Je ne mets qu’un exemple parce qu’il ne m’en vient aucun autre. Si une idée vous vient, n’hésitez pas à l’incorporer.
Cependant, l’avenir a aussi un lourd poids et l’idéal dont nous parlions peut devenir un fardeau quand on désespère de pouvoir l’atteindre. Ainsi il n’est pas seulement question de ne pas entrevoir l’avenir, il est question de le trouver trop loin de nous ou trop parfait et donc irréel ou au moins immatériel. Cette idée est mise en scène par Aristophane dans L’Assemblée des femmes : c’est le bon sens féminin qui dicte les décisions de Praxagora et pourtant son idéal égalitariste semble bien illusoire quand on songe à la division que ses lois ont provoquée parmi les citoyens : Chrémès contre l’égoïsme de son voisin, les trois Vieilles contre le Jeune homme et sa compagne. Chez Roth, le retour à la démocratie n’est pas non plus l’avènement d’une meilleure démocratie. Le dernier chapitre s’appelle « La peur perpétuelle » et montre la violence qui perdure au-delà du retour à l’ordre que laissait supposer la fin de l’uchronie romanesque avec le retour de Roosevelt. Les événements ne sont pas seulement liés à l’organisation démocratique de la société et celle-ci ne semble pas suffire à rendre la société parfaite. ***
On considère alors inutile d’aller mieux, de peur justement d’empirer les choses. On pense que la situation dans laquelle on est constitue déjà un progrès par rapport à un avant qu’on feint parfois de renier et on s’illusionne en pensant que l’histoire – et l’Histoire – peut s’arrêter là. Le Premier esclave – il me semble que dans votre éditions de référence, les traducteurs ont pudiquement nommé « serviteurs » les deux esclaves de Démos mais je garde ici le sens grec originel de δούλος [doulos] « esclave » – des Cavaliers n’est pas très attaché à chercher le meilleur intendant possible pour Démos, il en veut simplement un qui pourra le débarrasser du fourbe et calomniateur Paphlagonien. Il ne vise donc pas ce qu’il y a de mieux pour son maître – et donc pour le peuple qu’il symbolise par allégorie. Il veut simplement ce qu’il y a de mieux pour lui, et s’accommode très bien d’un autre démagogue, quitte, peut-être, à recommencer son manège. De même, Tocqueville rappelle que les citoyens « tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres » et que « ce n’est donc jamais qu’avec effort que ces hommes s’arrachent à leurs affaires particulières pour s’occuper des affaires communes » : il est plus confortable de préférer le bien au mieux. ***
La démocratie est donc toujours encore à venir. Son état actuel est assez démocratique pour la nommer ainsi sans pour autant qu’on puisse s’en satisfaire. Quel rôle joue l’idée de sa perfectibilité pour la faire advenir ?
(III) La démocratie est une dynamique qui l’inscrit dans l’Histoire (cf. La démocratie est providentielle selon Tocqueville))
La démocratie « à venir » est perfectible et c’est la notion même de perfectibilité qui l’inscrit dans une dynamique et dans l’Histoire. Les auteurs des œuvres au programme jouent à se faire peur. Illustrer les périls qui guettent la démocratie, c’est déjà se rassurer : cela n’est pas arrivé et cela n’arrivera pas. On a échappé au pire. On peut le deviner par la « Note au lecteur » du Complot contre l’Amérique , qui rappelle d’emblée que le roman « est une œuvre de fiction ». Roth peint par le biais de la fiction une limite de la démocratie, qui laisse entrevoir le risque de son échec et nous pousse à la défendre. En ce sens, ce romancier n’est pas moins didactique que Tocqueville : sa mise en garde est adressée aux États-Unis du XXIe siècle – dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme » – et le roman participe lui-même de la perfectibilité de la démocratie américaine. De même, les exagérations proposées par les comédies d’Aristophane visent à provoquer un sursaut démocratique chez les citoyens athéniens pour qu’enfin cessent la montée des démagogues et la guerre du Péloponnèse. ***
Mais accepter les imperfections de la démocratie actuelle, ce n’est pas nécessairement la mettre en péril. Mettre en scène ses imperfections et appeler aux changements nécessaires pour sa perfection, c’est comprendre qu’elle est ancrée dans l’Histoire et que chaque renouveau amène une démocratie nouvelle. Cette démocratie nouvelle, ou plutôt renouvelée, qui accouchera de ces sursauts et élans citoyens (« citoyens » est un adjectif ici) , sera ainsi à nouveau perfectible, et ainsi de suite : c’est la perfectibilité infinie. Ainsi, par la notion même de perfectibilité et par sa mise en scène, on peut espérer aller de l’avant. La crieuse publique – ici non plus je ne suis pas sûr du nom du personnage selon la traduction de votre édition – qu’engage Praxagora ne termine-t-elle pas son discours par des propos encourageants : « avancez donc » et « allons » ? C’est également ainsi que conclut Tocqueville : « je vois de grands périls qu’il est possible de conjurer ; de grands maux qu’on peut éviter ou restreindre, et je m’affermis de plus en plus dans cette croyance que pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir ». ***
La responsabilité citoyenne est donc engagée : il faut véritablement vouloir aller de l’avant. C’est pourquoi le roman de Roth se focalise sur le jeune Philip, entouré de jeunes gens : son frère Sandy, son cousin Alvin, ses amis Earl et Seldon. La jeunesse de ces personnages met en scène la destinée encore à dessiner de l’Amérique. Et cette destinée est plurielle tout en étant plus ou moins inféconde : Seldon sauve Philip alors que le protagoniste l’abhorre ; Earl doit déménager pour rejoindre son père alors qu’il éveillait Philip à des horizons nouveaux. La jeunesse est en effet le moment charnière, où se forgent les consciences, à la fois par le milieu et par les discours qui nous entourent. En partageant le lit voisin à celui de Philip, Sandy, Alvin puis Seldon forgent son caractère, l’inspirent, le font réfléchir et lui permettent de devenir quelqu’un sur qui on peut compter . Pour éviter les dangers qui sèment la route, longue et sinueuse, de la démocratie, les citoyens doivent être capables de concevoir ce qui est encore à améliorer. Démos, dans Les Cavaliers, caricature le peuple qui serait incapable de se caricaturer lui-même, à l’inverse de Tocqueville qui cherche à la fin de son essai à « embrasser d’un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau ». Il revient bien aux citoyens de garder le cap, pour garder la démocratie dans cette dynamique de perfectibilité.
Conclusion dissertation démocratie
Inutile donc de déplorer la faillite des démocraties modernes. Elles ne sont pas parfaites, ne le seront peut-être jamais. Il ne faut pas pour autant abandonner l’idéal démocratique. Au contraire, c’est en comprenant et en acceptant que la démocratie n’est pas un état de fait mais une dynamique qu’on comprend et accepte à quel point son imperfection est le moteur de son histoire et de l’Histoire elle-même. La réponse particulière qu’apporte la démocratie à la grande question du politique prend la forme d’une promesse qu’on tient en partie. Promesse tenue ? À chaque étape du processus démocratique, un peu plus en tout cas : c’est ainsi que la démocratie, en visant son propre idéal, devient sa propre fin. Derrida questionne l’aspect non- advenu de la démocratie et n’a pas pour enjeu de conceptualiser les difficultés du projet démocratique. Ne réduit-il pas ainsi à néant le projet de se demander si la démocratie « n’est qu’un idéal », parce que l’idéal exigerait d’opposer l’aspect absolu de la démocratie et sa réalité, au profit de son inscription dans une dynamique encourageant les citoyens à s’inventer sans cesse en acteurs démocratiques d’un nouveau type ? Pour respecter la remarque que beaucoup de rapports de juty soulèvent à propos des ouvertures de conclusion (à savoir qu’une “trop bonne” ouverture devrait alerter le candidat qui aurait peut-être dû songer à en user plutôt en III), je me borne ici à élargir le propos de Derrida et donc de cette dissertation sans aller chercher un aspect trop novateur qui aurait mérité d’être utilisé comme partie finale.
COURS EN PREPA MATHS SUP
Les meilleurs professeurs particuliers en cpge, sujet de dissertation n°4 .

Jean-Louis Barrault (1910-1994), un grand homme de théâtre, a dit « La dictature c’est « ferme ta gueule », la démocratie c’est « cause toujours ». » Votre lecture des œuvres au programme vous permet-elle d’adhérer à ce jugement que reprendront à l’identique Coluche ou Woody Allen par exemple ?
Piste -> Attention à ne pas juger le style de la citation. Ici, expliquer la colère et la spontanéité : oui ; dire que le propos est peu profond : non. L’auteur expose l’apparente honnêteté de la dictature et l’hypocrisie relative de le Démocratie.
Cette dissertation est corrigée dans autre article du blog.
Exercice bonus en dissertation sur la démocratie en CPGE
Résumez le texte suivant en 100 mots (plus ou moins 10%)

Je connais un certain nombre de bons esprits qui essaient de définir la Démocratie. J’y ai travaillé souvent, et sans arriver à dire autre chose que des pauvretés, qui, bien plus, ne résistent pas à une sévère critique. Par exemple celui qui définirait la démocratie par l’égalité des droits et des charges la définirait assez mal ; car je conçois une monarchie qui assurerait cette égalité entre les citoyens ; on peut même imaginer une tyrannie fort rigoureuse, qui maintiendrait l’égalité des droits et des charges pour tous, les charges étant très lourdes pour tous, et les droits fort restreints. Si la liberté de penser, par exemple, n’existait pour personne, ce serait encore une espèce d’égalité. Il faudrait donc dire que la Démocratie serait l’Anarchie. Or je ne crois pas que la Démocratie soit concevable sans lois, sans gouvernement, c’est-à-dire sans quelque limite à la liberté de chacun ; un tel système, sans gouvernement, ne conviendrait qu’à des sages. Et qui est-ce qui est sage ?
Même le suffrage universel ne définit point la Démocratie. Quand le pape, infaillible et irresponsable, serait élu au suffrage universel, l’Église ne serait démocratique par cela seul. Un tyran peut être élu au suffrage universel, et n’être pas moins tyran pour cela. Ce qui importe, ce n’est pas l’origine des pouvoirs, c’est le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants.
Ces remarques m’ont conduit à penser que la Démocratie n’existe point par elle-même. Et je crois bien que dans toute constitution il y a de la Monarchie, de l’Oligarchie, de la Démocratie, mais plus ou moins équilibrées.
L’exécutif est monarchique nécessairement. Il faut toujours, dans l’action, qu’un homme dirige ; car l’action ne peut se régler d’avance ; l’action, c’est comme une bataille ; chaque détour du chemin veut une décision. Le législatif, qui comprend sans doute l’administratif, est oligarchique nécessairement ; car, pour régler quelque organisation, il faut des savants, juristes ou ingénieurs, qui travaillent par petits groupes dans leur spécialité. Plus la société sera compliquée, et plus cette nécessité se fera sentir. Par exemple, pour contrôler les assurances et les mutualités, il faut savoir ; pour établir des impôts équitables, il faut savoir ; pour légiférer sur les contagions, il faut savoir.
Où est donc la Démocratie, sinon dans ce troisième pouvoir que la Science Politique n’a point défini, et que j’appelle le Contrôleur ? Ce n’est autre chose que le pouvoir, continuellement efficace, de déposer les Rois et les Spécialistes à la minute, s’ils ne conduisent pas les affaires selon l’intérêt du plus grand nombre. Ce pouvoir s’est longtemps exercé par révolutions et barricades. Aujourd’hui, c’est par l’interpellation qu’il s’exerce. La Démocratie serait, à ce compte, un effort perpétuel des gouvernés contre les abus du pouvoir. Et, comme il y a, dans un individu sain, nutrition, élimination, reproduction, dans un juste équilibre, ainsi il y aurait dans une société saine : Monarchie, Oligarchie, Démocratie dans un juste équilibre.
Alain, Propos sur les pouvoirs , « Le Contrôle », 79, propos du 12 juillet 1910.
D’autres ressources en français pour les prépas scientifiques ont été mises en ligne :
- La démocratie à Athènes en prépa scientifique
- La démocratie aux Etats-Unis en prépa scientifique
- Cours de français sur la démocratie en prépa scientifique
- Exemples d’épreuves de français aux concours : démocratie
- Etude d’une dissertation de prépa sur la démocratie
- Citations sur la démocratie en prépa
- Corrigé d’une dissertation sur le thème de la démocratie en prépa
- Dissertation sur la démocratie en CPGE scientifique
N'hésite pas à partager l'article
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.

Dissertation corrigée: L’Amour. O. WILDE, Portrait de Dorian Gray

Comment bien lire Le Banquet ? – français/philo en prépa scientifique

Faut-il lire les œuvres en prépa scientifique ?
- 3 rue de l'Estrapade 75005 Paris
- [email protected]
- 01 84 88 32 69
Qui sommes-nous ?
- Témoignages et avis
- Notre newsletter
Nous rejoindre
- Devenir professeur
- Notre équipe
Copyright @ GROUPE REUSSITE - Mentions légales
Reçois par email les infos pour réussir.

Travaillez où et quand vous voulez grâce à notre application déjà utilisée par plus de 100 000 élèves en France.
Dissertation sur la démocratie: sujet, l’introduction, résumé, conclusion.
Symbols: 31722
Words: 5287
“La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.” – Abraham Lincoln (États-Unis)
“La démocratie est une chose merveilleuse, à condition de ne pas se soucier de qui en sort.” – François Mitterrand (France)
“La démocratie est le pire des systèmes politiques, à l’exception de tous les autres qui ont été essayés.” – Winston Churchill (Royaume-Uni)
“La démocratie doit être quelque chose de plus qu’un simple choix entre ce qui est bon pour la gauche ou la droite.” – Václav Havel (République tchèque)
“La démocratie est un processus sans fin et imparfait qui nécessite la participation active de tous les citoyens.” – Nelson Mandela (Afrique du Sud)
Ces dictons montrent que la démocratie est considérée comme un idéal politique dans certains cas, mais aussi comme un système imparfait qui nécessite une participation active des citoyens pour fonctionner correctement.
La démocratie est un régime politique largement répandu à travers le monde, mais son efficacité et sa pertinence restent souvent remises en question. Cette dissertation a pour but d’examiner les différents aspects de la démocratie, de ses origines historiques à son fonctionnement actuel, afin de déterminer si elle est un idéal politique réalisable ou simplement un mirage.
I. Les origines de la démocratie A. La démocratie athénienne : un modèle fondateur B. Les influences antiques sur la pensée démocratique moderne
II. Les caractéristiques de la démocratie A. Le principe de souveraineté populaire B. La protection des droits et libertés individuels C. La séparation des pouvoirs
III. Les défis de la démocratie moderne A. La montée des populismes et des régimes autoritaires B. La crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques C. Les limites de la représentativité et de la participation citoyenne
IV. Les alternatives à la démocratie A. Les régimes autoritaires : avantages et limites B. Les modèles participatifs : vers une démocratie renouvelée
V. La démocratie : idéal politique ou mirage ? A. Les avantages et limites de la démocratie B. La pertinence de la démocratie face aux défis actuels C. Les perspectives d’avenir pour la démocratie
Introduction :
La démocratie est un concept politique qui fait rêver les peuples depuis des siècles. Elle est souvent présentée comme un idéal à atteindre pour garantir la liberté et l’égalité des citoyens. Cependant, malgré sa popularité, la démocratie est souvent remise en question, notamment face aux difficultés qu’elle rencontre dans sa mise en œuvre. Ainsi, cette dissertation a pour but d’examiner si la démocratie est un idéal politique réalisable ou simplement un
I. Les origines de la démocratie
A. la démocratie athénienne : un modèle fondateur.
La démocratie athénienne est souvent considérée comme le premier modèle de démocratie de l’histoire. Elle s’est développée à Athènes, en Grèce, au Ve siècle avant J.-C., et a influencé la pensée politique occidentale jusqu’à nos jours.
Dans la démocratie athénienne, tous les citoyens avaient le droit de participer aux décisions politiques de la cité, lors des assemblées du peuple. Chacun pouvait y prendre la parole et exprimer son opinion, quels que soient son statut social ou sa richesse. Les lois étaient votées par l’assemblée, et les magistrats étaient tirés au sort, pour éviter les abus de pouvoir.
Cette forme de démocratie était limitée à une minorité de la population, car seuls les hommes libres et nés à Athènes pouvaient participer. Les femmes, les étrangers et les esclaves étaient exclus du système politique.
Malgré ses limites, la démocratie athénienne a représenté une avancée significative dans l’histoire politique de l’humanité. Elle a permis la participation des citoyens aux décisions de la cité, et a favorisé l’émergence de la culture démocratique en Occident.
B. Les influences antiques sur la pensée démocratique moderne
La pensée démocratique moderne s’est nourrie des influences antiques, en particulier de la démocratie athénienne. Les penseurs politiques de l’époque moderne ont cherché à comprendre les principes qui ont fait le succès de la démocratie grecque, et à les adapter à leur propre contexte politique.
Parmi les influences antiques sur la pensée démocratique moderne, on peut citer :
- Le concept de souveraineté populaire : l’idée que le pouvoir politique émane du peuple, et que les citoyens ont le droit de participer aux décisions politiques qui les concernent.
- Le principe de l’égalité devant la loi : l’idée que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de statut social ou de richesse.
- Le concept de justice : l’idée que les lois doivent être justes, c’est-à-dire équitables et conformes à l’intérêt général.
- Le droit à la liberté d’expression : l’idée que les citoyens ont le droit de s’exprimer librement, sans craindre la répression du pouvoir politique.
Ces principes ont été repris et adaptés par les penseurs politiques modernes, tels que Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, ou encore Thomas Jefferson. Ils ont été à l’origine de la fondation des États démocratiques modernes, en Europe et en Amérique du Nord.
II. Les caractéristiques de la démocratie
A. le principe de souveraineté populaire.
Le principe de souveraineté populaire est l’un des fondements de la démocratie moderne. Il signifie que le pouvoir politique appartient au peuple, qui l’exerce à travers des institutions démocratiques. Ce principe implique que les citoyens ont le droit de participer à la vie politique de leur pays, en votant lors des élections, en exprimant leur opinion, en manifestant pacifiquement, en pétitionnant les autorités, etc.
Le principe de souveraineté populaire est étroitement lié à l’idée de légitimité politique. En effet, si le pouvoir politique émane du peuple, alors il est légitime, car il correspond à la volonté de la majorité. En revanche, si le pouvoir est exercé par une élite ou une minorité, il peut être considéré comme illégitime, car il ne correspond pas à la volonté du peuple.
La souveraineté populaire implique également que les élus et les gouvernants doivent rendre compte de leur action devant le peuple, et être responsables de leurs décisions. Les institutions démocratiques, telles que le parlement, le gouvernement, la justice, les médias, ont pour fonction de garantir le respect de la souveraineté populaire, en protégeant les droits et les libertés des citoyens, en assurant la transparence et la responsabilité des décisions politiques, et en favorisant la participation citoyenne à la vie publique.
Cependant, la souveraineté populaire peut être mise en danger dans certaines situations, par exemple lorsque les élus ou les gouvernants ne respectent pas les droits fondamentaux des citoyens, ou lorsqu’ils cherchent à restreindre la liberté d’expression ou de manifestation. Dans ces cas, la souveraineté populaire peut être remise en cause, et il est alors du devoir des citoyens de défendre leurs droits et de faire respecter la démocratie.
B. La protection des droits et libertés individuels
La protection des droits et libertés individuels est une caractéristique essentielle de la démocratie moderne. Ces droits et libertés sont généralement considérés comme universels et inaliénables, c’est-à-dire qu’ils sont applicables à tous les individus, sans distinction de race, de sexe, de religion ou d’autres critères.
Les droits et libertés individuels protégés par la démocratie incluent notamment la liberté d’expression, la liberté de conscience, la liberté de réunion et d’association, la liberté de la presse, la protection de la vie privée, l’égalité devant la loi, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la propriété, et le droit de participer à la vie politique.
La protection de ces droits et libertés est assurée par les institutions démocratiques, telles que la justice, les médias, les organisations de la société civile, les parlements et les gouvernements. Les lois et les règlements sont également des instruments importants pour protéger les droits et libertés individuels, en garantissant par exemple l’égalité devant la loi, la liberté d’expression ou la protection de la vie privée.
Cependant, la protection des droits et libertés individuels peut être mise en danger dans certaines situations, par exemple lorsqu’un gouvernement cherche à restreindre la liberté d’expression ou de réunion, ou lorsqu’il bafoue les droits des minorités. Dans ces cas, il est du devoir des citoyens de se mobiliser pour défendre leurs droits et de faire respecter les principes démocratiques.
En somme, la protection des droits et libertés individuels est une condition sine qua non pour l’exercice de la démocratie. C’est en garantissant ces droits et libertés que la démocratie assure la participation et l’inclusion de tous les citoyens, et qu’elle permet la construction d’une société juste et équitable.
C. La séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est une autre caractéristique essentielle de la démocratie moderne. Elle consiste à diviser le pouvoir politique en plusieurs branches distinctes, afin d’éviter qu’un seul individu ou groupe ne concentre tous les pouvoirs et ne puisse ainsi abuser de sa position.
Les trois branches principales du pouvoir dans une démocratie sont généralement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est celui qui est chargé de mettre en œuvre les lois et les politiques publiques, et il est généralement exercé par le gouvernement ou le chef de l’État. Le pouvoir législatif est celui qui est chargé de créer les lois, et il est généralement exercé par un parlement ou une assemblée représentative. Le pouvoir judiciaire est celui qui est chargé d’interpréter et d’appliquer les lois, et il est généralement exercé par des tribunaux indépendants.
La séparation des pouvoirs permet de garantir l’indépendance et l’impartialité des différentes branches du pouvoir, et d’éviter qu’un seul individu ou groupe ne puisse prendre des décisions arbitraires ou injustes. Elle assure également la transparence et la responsabilité des décisions politiques, en permettant aux différentes branches du pouvoir de se contrôler mutuellement et de s’assurer que les décisions sont prises dans l’intérêt de tous les citoyens.
Cependant, la séparation des pouvoirs peut être mise en danger dans certaines situations, par exemple lorsque le pouvoir exécutif cherche à influencer le pouvoir judiciaire, ou lorsque le pouvoir législatif ne remplit pas son rôle de contre-pouvoir. Dans ces cas, il est du devoir des citoyens de se mobiliser pour défendre la séparation des pouvoirs et de faire respecter les principes démocratiques.
En somme, la séparation des pouvoirs est une condition essentielle pour la démocratie moderne, car elle permet d’assurer la transparence, l’indépendance et la responsabilité des décisions politiques. C’est en garantissant la séparation des pouvoirs que la démocratie peut assurer l’égalité devant la loi et la protection des droits et libertés individuels.
En conclusion, la démocratie est un régime politique qui repose sur plusieurs caractéristiques essentielles. La souveraineté populaire, la protection des droits et libertés individuels et la séparation des pouvoirs sont les piliers fondamentaux de la démocratie moderne.
La souveraineté populaire implique que le pouvoir politique appartient au peuple, qui est le seul détenteur légitime du pouvoir. La protection des droits et libertés individuels permet de garantir l’égalité devant la loi et la protection des droits des minorités, ainsi que de permettre une participation et une inclusion de tous les citoyens dans la vie politique. La séparation des pouvoirs permet de garantir la transparence, l’indépendance et la responsabilité des décisions politiques, en évitant la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d’un seul individu ou groupe.
Ces caractéristiques sont donc indispensables pour la démocratie et doivent être respectées et défendues par les citoyens, afin d’assurer le bon fonctionnement de la démocratie et le respect des principes démocratiques.
Cependant, la démocratie n’est pas un idéal parfait et absolu, mais plutôt un processus constant d’amélioration et de réflexion. Les citoyens doivent donc être vigilants et s’engager activement dans la défense des principes démocratiques, afin d’assurer un avenir démocratique et juste pour tous.
III. Les défis de la démocratie moderne
A. la montée des populismes et des régimes autoritaires.
La montée des populismes et des régimes autoritaires est un phénomène préoccupant pour la démocratie moderne. Ces mouvements politiques remettent en question les principes démocratiques fondamentaux, tels que la souveraineté populaire, la protection des droits et libertés individuels et la séparation des pouvoirs.
Les mouvements populistes s’appuient souvent sur des discours simplistes et démagogiques, qui visent à galvaniser les citoyens en présentant des solutions faciles à des problèmes complexes. Ils cherchent également à diaboliser les minorités et les opposants politiques, en créant une atmosphère de tension et de polarisation qui peut conduire à la violence et à l’exclusion.
Les régimes autoritaires, quant à eux, s’appuient sur une concentration excessive de pouvoir dans les mains d’un seul individu ou d’un petit groupe, qui ne respecte pas les principes démocratiques et les droits et libertés individuels. Ces régimes cherchent souvent à contrôler les médias et à limiter la liberté d’expression, afin d’empêcher toute critique ou opposition.
La montée des populismes et des régimes autoritaires peut donc avoir des conséquences graves pour la démocratie, en sapant les fondements démocratiques et en mettant en danger la participation et l’inclusion de tous les citoyens dans la vie politique.
Il est donc crucial pour les citoyens de rester vigilants et de s’engager activement dans la défense des principes démocratiques. Cela implique de participer activement aux élections et aux débats publics, de s’informer de manière critique et indépendante, et de résister aux discours simplistes et démagogiques. Cela implique également de soutenir les organisations qui défendent les droits et libertés individuels, et de se mobiliser pacifiquement pour défendre les principes démocratiques lorsqu’ils sont menacés.
En somme, la montée des populismes et des régimes autoritaires doit être combattue avec fermeté, afin de préserver les principes démocratiques fondamentaux et de garantir un avenir démocratique et juste pour tous.
B. La crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques
La crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques est un autre défi majeur pour la démocratie moderne. Cette crise peut être causée par divers facteurs, tels que la corruption, le manque de transparence, la polarisation politique, l’écart entre les promesses politiques et les résultats obtenus, ou encore le sentiment de frustration et d’impuissance face à des problèmes complexes et persistants.
Cette crise de confiance peut conduire à une baisse de la participation électorale, une méfiance accrue envers les médias et les institutions publiques, une montée du populisme et de la radicalisation politique, ainsi qu’une augmentation des conflits sociaux et des tensions entre les citoyens.
Il est donc crucial de rétablir la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques, en promouvant la transparence, l’accountability et la participation citoyenne. Cela peut se faire en renforçant les mécanismes de lutte contre la corruption et en favorisant l’indépendance des médias et des organes de contrôle. Cela implique également de permettre une participation citoyenne plus active et significative dans les processus de décision, en impliquant les citoyens dans les débats publics et en leur donnant des moyens d’influencer les politiques publiques.
Il est également crucial de reconnaître et de répondre aux préoccupations et aux attentes des citoyens, en offrant des solutions concrètes et efficaces aux problèmes les plus urgents, tels que le chômage, la pauvreté, l’insécurité ou le changement climatique. Cela implique de renforcer les politiques publiques dans ces domaines, en travaillant avec les partenaires sociaux et la société civile pour identifier les priorités et les solutions les plus appropriées.
En somme, la crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques est un défi majeur pour la démocratie moderne, mais il peut être surmonté en renforçant la transparence, l’accountability et la participation citoyenne, et en répondant aux préoccupations et aux attentes des citoyens. Il est donc crucial pour les acteurs politiques, sociaux et économiques de travailler ensemble pour renforcer la démocratie et garantir un avenir démocratique et juste pour tous.
C. Les limites de la représentativité et de la participation citoyenne
Bien que la représentativité et la participation citoyenne soient des piliers de la démocratie moderne, elles présentent également des limites et des défis qui doivent être pris en compte.
Tout d’abord, la représentativité peut être mise en question lorsqu’il y a un décalage entre les intérêts et les préférences des citoyens et les actions des représentants élus. Les élus peuvent être influencés par des groupes d’intérêts ou des lobbies, ce qui peut altérer leur représentativité. De plus, la représentativité peut être affectée par des systèmes électoraux qui favorisent certains partis ou groupes politiques, ou par une participation électorale faible qui ne reflète pas la diversité des opinions et des besoins de la population.
De même, la participation citoyenne peut être limitée par des obstacles pratiques ou financiers, ou par un manque de ressources et de compétences pour s’engager dans des processus de participation active. Les personnes les plus vulnérables et marginalisées peuvent être les plus touchées par ces obstacles, ce qui peut entraîner une représentation inégale des intérêts et des besoins des citoyens.
En outre, la participation citoyenne peut être affectée par la polarisation politique et les conflits sociaux, qui peuvent rendre difficile la recherche de consensus et l’engagement de tous les acteurs dans des processus de dialogue et de coopération.
Face à ces limites, il est important de renforcer la représentativité et la participation citoyenne en promouvant la transparence, l’accountability et l’indépendance des institutions publiques et en renforçant les mécanismes de contrôle et de participation citoyenne. Il est également important de travailler à réduire les obstacles pratiques et financiers à la participation, en investissant dans l’éducation civique et la participation active des citoyens, en particulier des groupes les plus vulnérables et marginalisés.
En somme, bien que la représentativité et la participation citoyenne soient des éléments clés de la démocratie moderne, il est important de reconnaître leurs limites et de travailler à les surmonter afin de garantir une représentation équitable et une participation significative de tous les citoyens dans les processus de prise de décision.
IV. Les alternatives à la démocratie
A. les régimes autoritaires : avantages et limites.
Il est difficile de parler d’avantages des régimes autoritaires, car ils sont généralement associés à des violations des droits de l’homme, des restrictions de la liberté d’expression et de la presse, ainsi qu’à un manque de transparence et de responsabilité de la part des dirigeants.
Cependant, certains partisans de ces régimes soutiennent que leur efficacité économique et leur stabilité politique justifient leur autoritarisme. Les régimes autoritaires peuvent en effet prendre des décisions plus rapidement et plus facilement que les démocraties, car ils ne sont pas soumis aux contraintes et aux débats associés à la prise de décision démocratique. De plus, ils peuvent imposer une discipline budgétaire stricte, ce qui peut être bénéfique pour l’économie.
Cependant, ces avantages économiques sont souvent obtenus au détriment des droits fondamentaux des citoyens et peuvent conduire à une concentration de richesse et de pouvoir entre les mains des élites au pouvoir. De plus, les régimes autoritaires sont souvent associés à la corruption et à l’injustice, car les dirigeants n’ont pas de comptes à rendre à leurs citoyens ou à des instances indépendantes. Ils peuvent également être plus vulnérables aux conflits internes et aux crises politiques, car leur légitimité dépend souvent de la force militaire ou de la répression.
En somme, bien que certains avantages économiques puissent être associés aux régimes autoritaires, il est important de considérer leurs coûts en termes de droits de l’homme, de justice et de stabilité politique. Les démocraties sont souvent plus résilientes aux crises et peuvent garantir une plus grande liberté et une meilleure représentation des citoyens, même si cela peut parfois être plus lent et plus complexe que les décisions prises par les régimes autoritaires.
Voici quelques exemples de régimes autoritaires
La Corée du Nord : un régime totalitaire caractérisé par la dictature d’un seul homme, la famille Kim. Ses avantages sont la stabilité politique et l’efficacité du processus décisionnel, mais au détriment des libertés individuelles, des droits de l’homme et de la liberté de la presse.
Chine : régime communiste autoritaire, combinant une économie planifiée et un parti unique. Ses avantages sont la stabilité politique, une croissance économique rapide et la réduction de la pauvreté, mais au détriment des libertés individuelles, des droits de l’homme et de la démocratie.
Russie : un régime autoritaire dirigé par Vladimir Poutine, caractérisé par un pouvoir centralisé et une forte influence de l’État sur les médias et les institutions. Il n’y a pas d’avantages ! La Russie tue les Ukrainiens !
Les régimes autoritaires peuvent assurer la stabilité politique et économique, mais souvent au détriment des libertés individuelles et des droits de l’homme. Les dirigeants peuvent prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement, mais sans la participation des citoyens et la liberté d’expression, cela peut conduire à des décisions injustes ou inadéquates. En outre, ces régimes peuvent être enclins à la corruption et à l’abus de pouvoir, car il n’y a souvent pas de contre-pouvoirs indépendants pour contrôler les dirigeants. Dans l’ensemble, les avantages des régimes autoritaires sont souvent de courte durée et peuvent être largement compensés par les limites et les inconvénients qui résultent de leur existence.

B. Les modèles participatifs : vers une démocratie renouvelée
Face aux défis actuels de la démocratie représentative, des modèles participatifs émergent comme des alternatives pour renouveler la démocratie et impliquer davantage les citoyens dans le processus de prise de décision.
Ces modèles participatifs prennent différentes formes, allant des consultations citoyennes aux budgets participatifs, en passant par les assemblées citoyennes et les jurys populaires. Leur objectif est de permettre une participation plus directe des citoyens à la prise de décision, en leur donnant la possibilité de contribuer à l’élaboration de politiques publiques et à l’identification des problèmes locaux.
Ces modèles participatifs peuvent avoir plusieurs avantages. Tout d’abord, ils permettent aux citoyens de se sentir plus impliqués dans la vie publique et de renforcer leur engagement civique. Ils peuvent également renforcer la légitimité des décisions prises, en impliquant les citoyens dans le processus de prise de décision et en leur donnant la possibilité de s’exprimer sur les enjeux qui les concernent directement.
Cependant, les modèles participatifs ne sont pas exempts de limites. Ils peuvent être biaisés en faveur des groupes les plus organisés et les plus motivés, qui peuvent être sur-représentés dans les consultations ou les assemblées citoyennes. De plus, ils peuvent nécessiter des ressources importantes, notamment en termes de temps et d’argent, ce qui peut limiter leur portée et leur accessibilité.
En somme, les modèles participatifs peuvent offrir une voie pour renouveler la démocratie et impliquer davantage les citoyens dans le processus de prise de décision. Cependant, il est important de reconnaître leurs limites et de veiller à ce qu’ils soient conçus de manière inclusive et équitable pour garantir une participation effective de tous les citoyens.
V. La démocratie : idéal politique ou mirage ?
A. les avantages et limites de la démocratie.
La démocratie présente plusieurs avantages :
- La participation citoyenne : la démocratie permet aux citoyens de participer activement à la vie politique de leur pays en votant et en exprimant leur opinion. Les élections libres et équitables garantissent que chaque citoyen a une voix égale dans le choix de ses représentants.
- Les libertés individuelles : la démocratie garantit les droits fondamentaux de chaque citoyen, tels que la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et la liberté de réunion.
- La stabilité politique : la démocratie offre une plus grande stabilité politique et une meilleure gestion des crises, car les gouvernements sont tenus de rendre des comptes à leur peuple et doivent chercher le consentement des citoyens pour les décisions importantes.
Cependant, la démocratie présente également des limites :
- La lenteur des processus décisionnels : la démocratie est un processus délibératif qui implique souvent des négociations et des compromis, ce qui peut rendre les décisions plus lentes et plus difficiles à prendre.
- La représentativité limitée : les représentants élus peuvent ne pas toujours être représentatifs de la diversité de la population, ce qui peut conduire à une certaine marginalisation des minorités.
- La corruption : les gouvernements démocratiques peuvent être sujets à la corruption, en particulier lorsqu’il y a des lobbies et des intérêts particuliers qui influencent les décisions politiques.
- La faible participation citoyenne : dans certains cas, la participation citoyenne peut être faible, en particulier chez les jeunes et les groupes marginalisés, ce qui peut affaiblir la démocratie en tant que système.
En somme, la démocratie est un système politique qui présente des avantages importants en termes de participation citoyenne, de libertés individuelles et de stabilité politique, mais qui doit également relever des défis tels que la lenteur des processus décisionnels et la représentativité limitée des représentants élus.
B. La pertinence de la démocratie face aux défis actuels
La pertinence de la démocratie est de plus en plus remise en question face aux défis actuels tels que la montée des populismes, la crise de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques, les limites de la représentativité et de la participation citoyenne, et les changements économiques et technologiques rapides qui affectent la vie quotidienne des citoyens.
Cependant, malgré ces défis, la démocratie reste le système politique le plus adapté pour répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens. En effet, la démocratie permet aux citoyens de participer activement à la vie politique de leur pays et de prendre des décisions importantes qui affectent leur vie quotidienne. Elle garantit également les libertés individuelles et protège les droits fondamentaux de chaque citoyen.
De plus, la démocratie permet une plus grande transparence et responsabilité des gouvernements, en rendant les gouvernements responsables de leurs actions et en offrant des mécanismes pour contrôler leur pouvoir.
Enfin, la démocratie encourage l’innovation et la créativité, en permettant à des idées nouvelles et diverses de s’exprimer et d’être discutées dans l’espace public.
Bien que la démocratie soit confrontée à des défis importants, elle reste un système politique dynamique et adaptable, qui peut évoluer pour répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens dans un monde en constante évolution. Il est donc important de défendre et de renforcer la démocratie, tout en travaillant à surmonter ses défis et ses limites pour en faire un système plus inclusif et efficace.
C. Les perspectives d’avenir pour la démocratie
Les perspectives d’avenir pour la démocratie dépendront en grande partie de la manière dont les gouvernements, les citoyens et les organisations travaillent ensemble pour renforcer et améliorer le système démocratique.
Une première perspective est de renforcer la participation citoyenne, en permettant aux citoyens de s’impliquer davantage dans le processus de prise de décision et en élargissant les canaux de participation, tels que les plateformes numériques. Les gouvernements pourraient également encourager la participation citoyenne en intégrant des mécanismes de participation dans la prise de décision politique, tels que les référendums, les consultations populaires et les jurys citoyens.
Une autre perspective est de renforcer la transparence et la responsabilité des gouvernements, en mettant en place des mesures pour garantir que les gouvernements soient responsables de leurs actions et que les citoyens aient accès à l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Cela pourrait inclure des mesures telles que la transparence budgétaire, la divulgation des conflits d’intérêts, la surveillance des activités gouvernementales et la liberté de la presse.
Une troisième perspective est de renforcer la coopération internationale, en reconnaissant que de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés sont mondiaux et nécessitent des solutions coordonnées. Les gouvernements pourraient travailler ensemble pour renforcer les institutions et les normes internationales qui soutiennent la démocratie, telles que l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe.
Enfin, une quatrième perspective consiste à s’adapter aux défis de la technologie et de l’économie, en veillant à ce que la démocratie reste pertinente et inclusive dans un monde en constante évolution. Cela pourrait impliquer de nouvelles formes de participation citoyenne en ligne, de nouvelles mesures de protection des données et de la vie privée, et une réglementation adaptée pour protéger les droits des travailleurs dans une économie numérique en rapide évolution.
En somme, l’avenir de la démocratie dépendra de la manière dont nous répondrons aux défis actuels et dont nous travaillerons à renforcer et à améliorer le système démocratique pour qu’il soit plus inclusif, transparent et responsable.
Conclusion :
En fin de compte, la démocratie reste un idéal politique qui a su inspirer de nombreux régimes à travers le monde. Cependant, ses limites et ses défis ne peuvent être ignorés. Ainsi, la démocratie doit constamment être repensée et réinventée afin de répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens, tout en conservant ses principes fondateurs.
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
- Plan de dissertation
Plan de dissertation : méthodologie et exemples
Publié le 27 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 14 février 2022.
Le plan d’une dissertation est la structure ou le “squelette” de votre dissertation.
Table des matières
Combien de parties pour un plan de dissertation , plan de dissertation : apparent ou pas , les types de plan pour une dissertation, exemple de plan pour une dissertation (de philosophie), le plan d’une dissertation juridique, le plan d’une dissertation de philosophie.
Nous conseillons de faire un plan en trois parties (et deux sous-parties) pour les dissertations en général.
Toutefois, ce n’est pas obligatoire et vous pouvez le faire en deux parties (et trois sous-parties).
C’est différent pour les dissertations de droit ! Pour les dissertations juridiques, le plan doit contenir deux parties (et pas trois).
Reformuler des textes efficacement
Reformulez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre outil de paraphrase gratuit.
Reformuler un texte gratuitement
Le plan d’une dissertation peut être apparent ou non, tout dépend du type de dissertation rédigé.
Les dissertations de philosophie n’ont en général pas de plan apparent. Les titres apparaissent dans une phrase introductive.
Attention ! Pour les dissertations juridiques, les titres doivent être apparents et ils ne doivent pas comporter des verbes conjugués.
Il en existe plusieurs et chaque type de plan de dissertation a ses spécificités.
1. Le plan d’une dissertation dialectique
Le plan dialectique (ou critique) est un plan « thèse, antithèse et synthèse ». Il est utilisé lorsque l’opinion exprimée dans le sujet de dissertation est discutable et qu’il est possible d’envisager l’opinion inverse.
Le plan d’une dissertation dialectique suit le modèle suivant :
I. Exposé argumenté d’une thèse. II. Exposé argumenté de la thèse adverse. II. Synthèse (dépassement de la contradiction)
2. Le plan de dissertation analytique
Le plan analytique permet d’analyser un problème qui mérite une réflexion approfondie. Vous devez décrire la situation, analyser les causes et envisager les conséquences. Il est possible de faire un plan « explication / illustration / commentaire ».
Le plan d’une dissertation analytique suit généralement le modèle suivant :
I. Description/explication d’une situation II. Analyse des causes/illustration III. Analyse des conséquences/commentaire
3. Le plan de dissertation thématique
Le plan thématique est utilisé dans le cadre de questions générales, celles qui exigent une réflexion progressive.
I. Thème 1 II. Thème 2 III.Thème 3
4. Le plan de dissertation chronologique
Le plan chronologique est utilisé dans le cas d’une question sur un thème dont la compréhension évolue à travers l’histoire.
I. Temporalité 1 II. Temporalité 2 III. Temporalité 3
Voici un exemple de plan analytique pour une dissertation sur le thème « l’Homme est-il un animal social ? « .
1. La nature en nous 1.1. L’être humain, un animal parmi les autres ? 1.2. Les pulsions humaines comme rappel de notre archaïsme ? 2. La personne humaine : un être de nature ou de culture ? 2.1. La société comme impératif de survie : l’Homme est un loup pour l’Homme 2.2. La perfectibilité de l’Homme l’extrait de la nature 3. Plus qu’un animal social, un animal politique 3.1. L’Homme, un être rationnel au profit du bien commun 3.2. La coexistence humaine et participation politique du citoyen
Quel est votre taux de plagiat ?
En 10 minutes, vous pouvez savoir si vous avez commis du plagiat et comment l’éliminer.
- La technologie de Turnitin
- Un résumé de toutes les sources trouvées
- Une comparaison avec une base de données énorme
Faites la détection anti-plagiat

Les dissertations juridiques sont construites en deux parties et ont un plan apparent.
Le plan a une forme binaire : deux parties (I et II), deux sous-parties (A et B) et parfois deux sous-sous-parties (1 et 2). Votre plan de dissertation doit reposer sur quatre idées principales.
Plus d’informations sur le plan d’une dissertation juridique
Les dissertations de philosophie sont construites en trois parties (en général) et n’ont pas de plan apparent.
Chaque partie est introduite avec une phrase d’introduction.
Plus d’informations sur le plan d’une dissertation de philosophie
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2022, 14 février). Plan de dissertation : méthodologie et exemples. Scribbr. Consulté le 19 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/plan-de-dissertation/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., la méthode de la dissertation de philosophie , exemple de dissertation de philosophie.
Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
- We're Hiring!
- Help Center

La démocratie tout en dissertations

Programme CPGE scientifiques 20 dissertations corrigées
Related Papers
Seb M-Laure Goudezoone
laurence Hansen-Love
Laurence Hansen-Love
« La démocratie est le pire des régimes − à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » (Democracy is the worst form of government − except of all those other forms who have been tried from time to time). Cette fameuse boutade de Churchill est d’autant plus intrigante qu’elle est, au premier abord en tout cas, inintelligible. La démocratie n’est-elle pas à nos yeux non seulement le meilleur des régimes, mais encore le seul qui soit acceptable ? À ce titre, il est d’ailleurs effectivement revendiqué par quasiment tous les États de la planète en ce début de XXIe siècle.
Revue Critique De Fixxion Francaise Contemporaine
Alexandre Gefen
Théophile Pénigaud
Revue d'histoire littéraire de la France
Catherine Colliot-Thélène
Revue des sciences de l'éducation
Pierre Dehalu
Courrier hebdomadaire du CRISP
Vincent de Coorebyter
La démocratie aux Etats-Unis et en Amérique, 1918-1989
John Crowley
Jerome LEBRE
RELATED PAPERS
Putuberbagi
Putuberbagi Blog
Hrønn Thorn
International Journal of Contemporary Pediatrics
ajit kumar shrivastava
Advanced Materials Research
Ioan Száva
EasyChair Preprints
Christoph Benzmüller
Annuaire international de justice constitutionnelle
Nathalie BERNARD MAUGIRON
Julius Gardin
Nova et Vetera
Gilles Emery
Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference (LREC04). European Language Resources Association
Peter Halacsy
Mary Hernandez
Computers & Security
Stewart Kowalski
Inflammatory Bowel Diseases
Wendy Komocsar
Environmental Research
Theron Johnson
Journal of soil science and plant nutrition
Rainer Horn
Critical Quarterly
Rick de Villiers
Modern Rehabilitation
Malahat Akbarfahimi
Víctor Erasmo Sotero Solís
Brill | Nijhoff eBooks
Jurnal Riset Kesehatan Nasional
Fadhilah Rizka Utami
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal
Md. Kamrul Hasan Shabuj
RELATED TOPICS
- We're Hiring!
- Help Center
- Find new research papers in:
- Health Sciences
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science
- Academia ©2024
- [ fr ]
librecours.eu
- Monlycée.net
- Pronote d'Alain
- Situation de la pandémie
HGGSP en première, thème 1 – La démocratie
« comprendre un régime politique : la démocratie ».
Étudier les caractéristiques et l’affirmation d’un régime démocratique à travers sa pratique, ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long.
24 à 25 heures peuvent être consacrées à ce thème du programme. Après une introduction sur la notion de démocratie , le premier axe porte sur « penser la démocratie : démocratie directe et démocratie représentative » (Athènes antique ; Benjamin Constant), le second axe sur « avancées et reculs des démocraties » (Tocqueville ; Chili ; Espagne) et la conclusion sur l’Union européenne .
- Inspection générale, Thème 1 – Comprendre un régiment politique : la démocratie , Ressource d’accompagnement, septembre 2019. → https://eduscol.education.fr/document/23653/download
Thème précédent : Introduction à l’HGGSP . Thème suivant : HGGSP en première, thème 2 – Les puissances .
Sélection par la professeur-documentaliste d’ouvrages disponibles au CDI du lycée Alain :
- Benjamin Constant, Œuvres : texte présenté et annoté par Alfred Roulin , Paris, Gallimard, 1964.
- Claude Polin, De la démocratie en Amérique, Tocqueville : analyse critique , Paris, Hatier, 1985 (1973 ?).
- Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme , Paris, Gallimard, 1987.
- Antoine de Baecque (dir.), Une histoire de la démocratie en Europe , Paris, Le Monde éd., 1991.
- Jacques Maurice et Carlos Serrano, L’Espagne au XXe siècle , Paris, Hachette, 1996.
- Bruno Bernardi, La démocratie , Paris, Flammarion, 1999.
- Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité , Paris, Éd. du Seuil, 2010.
- Jean-Baptiste Rendu, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la démocratie , Paris, Hatier, 2011.
- Solange Gonzalez, L’école, la démocratie : réussir le concours commun d’entrée en 1re année d’IEP-Sciences Po 2016 , Paris, Ellipses, 2015.
Exemples de sujets d’E3C2 sur le thème de la démocratie
- Comment caractériser la démocratie ? Vous pourrez en décrire les principes fondateurs, les modes de fonctionnement et les limites en vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année.
- Pourquoi le fonctionnement de la démocratie directe fait-il débat ? Vous vous appuierez sur des exemples de démocratie et sur des auteurs ayant pensé la démocratie.
- Comment la souveraineté du peuple s’exerce-t-elle dans les démocraties ? Vous pourrez construire votre réflexion autour des différentes formes de démocraties étudiées au cours de l’année : directe, représentative, déléguée.
- Quelles sont les différentes conceptions de la démocratie ? Vous appuierez votre réflexion sur les situations historiques passées et récentes et les auteurs étudiés au cours de l’année. Vous mettrez en avant les principes communs qui fondent la démocratie et les différentes manières de concevoir celle-ci.
- Comment les démocraties envisagent-elles la participation des citoyens à la vie politique ? Vous appuierez votre réflexion sur des exemples étudiés au cours de l’année : démocratie directe, représentative, déléguée.
- Les démocraties peuvent-elles être remises en cause ? Vous pourrez nourrir votre réflexion de la pensée de Tocqueville, de l’exemple du Chili et des contestations au sein de l’Union européenne.
- Comment les transitions démocratiques peuvent-elles s’opérer ? Vous pourrez évoquer le rôle des acteurs, le déroulement et les limites du processus à partir d’exemples étudiés au cours de l’année.
- Montrez que la démocratie connaît des contestations et des crises. Vous pourrez appuyer votre réflexion sur les acteurs des crises, les faiblesses dénoncées et les conséquences de ces crises.
- Comment les citoyens interviennent-ils dans le fonctionnement de l’Union européenne ? Vous envisagerez leur rôle dans la mise en œuvre de la démocratie européenne ainsi que dans sa remise en cause.
- Quel est le lien entre le fonctionnement de l’Union européenne et la manière dont celle-ci est remise en question depuis 1992 ? Vous analyserez l’évolution du fonctionnement de l’Union européenne du point de vue de la démocratie, puis vous mettrez cette évolution en lien avec les critiques dont la construction européenne a été l’objet depuis 1992.
- Quelles peuvent être les limites de la démocratie représentative ? Après avoir donné les caractéristiques d’une démocratie représentative, vous montrerez quelles peuvent en être les limites en vous appuyant sur des exemples étudiés au cours de l’année.
Suivez aussi les sous-rubriques ci-dessous
- Stock de docs à analyser
Articles publiés dans cette rubrique
- Introduction sur la démocratie
C’est quoi la démocratie ? C’est le premier thème du programme d’HGGSP en première.
- Axe 1 – Penser la démocratie
Athènes au V e siècle & Benjamin Constant.
- Axe 2 – Avancées et reculs
Dérives selon Tocqueville ; reculs au Chili ; avancées aux Portugal et Espagne.
- Travail conclusif – L’Union européenne et la démocratie
Faire l’Europe, ou critiquer l’Europe ?
- Fiches de révision démocratiques
Une proposition ; si vous voulez faire différemment, publiez-la.
- De la liberté des anciens comparée à celle des modernes
Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes , 1819 (l’intégral).
- Compo. – Vivre et penser la démocratie
Dissertation d’une élève sur ce sujet pendant l’hiver 2019.
- Reconstitution des débats au Parlement européen
Jeu de rôle sur la politique.
- We the People
Site de pétitions sur le site internet de la Maison-Blanche, sous les présidence d’Obama puis de Trump.
- Bagatelle sur un tombeau
- Carte : les fortifications du second XIX e siècle
- De Bibliotheca
- Droits d’auteur et licences d’utilisation
- La blague européenne officielle
- Les petites annonces de L’Os à moelle
- Quelques uchronies à lire
- Sélection de sites
- Toponymes originaux
- Noms des corps du Système solaire
- L’âge de la voile
- Les premiers cuirassés
- L’ère des dreadnoughts
- L’ère des porte-avions
- Où sont les porte-avions de l’US Navy ?
- Carte : les ports mondiaux
- La marine de guerre chinoise
- Perles du collège Clemenceau, 2003-2004
- Perles du collège Clemenceau, 2004-2005
- Perles du collège Clemenceau, 2005-2006
- Perles du collège Clemenceau, 2006-2007
- Perles du collège Clemenceau, 2007-2008
- Perles d’Alain, 2008-2009
- Perles d’Alain, 2009-2010
- Perles d’Alain, 2010-2011
- Perles d’Alain, 2011-2012
- Perles d’Alain, 2012-2013
- Perles d’Alain, 2013-2014
- Perles d’Alain, 2014-2015
- Perles d’Alain, 2015-2016
- Perles d’Alain, 2016-2017
- Perles d’Alain, 2017-2018
- Perles d’Alain, 2018-2019
- Perles d’Alain, 2019-2020
- Perles d’Alain, 2020-2021
- Perles d’Alain, 2021-2022
- Perles d’Alain, 2022-2023
- Perles d’Alain, 2023-2024
- Autres perles
- Perles de profs
- 2002-2003, cinquième 1 & 2
- 2003-2004, quatrième B
- 2003-2004, quatrième E
- 2003-2004, quatrième G
- 2003-2004, sixième B
- 2003-2004, sixième C
- 2004-2005, troisième en Bretagne
- 2006-2007, quatrième A à Versailles
- 2007-2008, cinquième C
- 2009-2010, première ES 3
- 2009-2010, première S 5
- 2009-2010, seconde 11
- 2009-2010, seconde 6
- 2010-2011, première ES 2
- 2010-2011, première S 5
- 2010-2011, seconde 11
- 2010-2011, seconde 5
- 2011-2012, première ES 1
- 2011-2012, seconde 8
- 2012-2013, première ES 2
- 2012-2013, première S 6
- 2013-2014, option en terminale S
- 2013-2014, première ES 2
- 2013-2014, seconde 5
- 2013-2014, voyage en Chine
- 2013-2014, voyage en Lorraine
- 2017-2018, première ES 4
- 2017-2018, seconde 2
- 2017-2018, seconde 6
- 2017-2018, terminale S 1
- Du beurre d’escargot
- Faire du pain
- Guacamole de l’apéro
- Lasagnes aux oreilles de cochon
- Les oies du lycée Alain
- Omelette aux oranges pour ribaudes et rufians
- Palombes ?
- Recettes pour rugbymen
- Salade d’aubergines et de poivrons rôtis
- Une pizza pour Thibaut
- Ballade autour de Château-Rouge
- Carte : fortifications parisiennes
- Carte : mémoires parisiennes
- Carte : riches et pauvres à Paris
- Insurrection
- Quartiers de Paris
- 2017, voyage à Édimbourg
- 2018, voyage à Londres
- 2019, voyage à Londres
- 1865 – O Captain ! My Captain !
- 1883 – Lettre de Ferry concernant l’instruction morale et civique
- 1888 – Lettre de Jaurès aux instituteurs et institutrices
- 1953 – Conseils aux jeunes professeurs
- 1957 – Lettre de Camus à son instituteur
- 2020 – Lettre aux professeurs d’histoire-géographie
- 2023 – « Vous serez courageux ; solidaires ; intelligents ; tolérants »
- Conseils typographiques
- Exercice de typographie
- La faute de l’orthographe
- Les biologistes s’amusent
- Playlist de prof
- Réforme 2019 des programmes
- Cours de relations internationales
- Introduction sur océan et espace
- Axe 1 – Rivalités entre puissances
- Axe 2 – Enjeux de la coopération
- Travail conclusif – La voie chinoise
- 1969, Moon disaster
- 1977, message aux extraterrestres
- Doc. – Propagande spatiale
- ISS : la Station spatiale internationale
- Carte – Le domaine maritime chinois
- Doc. : 2016, Tiangong-2 & Shenzhou 11
- Liste de dissertations sur « de nouveaux espaces de conquête »
- Liste d’études de doc(s) sur « de nouveaux espaces de conquête »
- QCM sur l’espace
- Bellicistes en 1791
- Doc. – Guerre & paix avec Napoléon
- A New Beginning (2009)
- Correspondance entre Samantha et Andropov
- Doc. – Le pacte Briand - Kellogg en 1928
- Doc. : 1991, une photo sur une guerre
- Doc. – La guerre civile irakienne
- Doc. – Un nouvel ordre international ?
- Entrer en guerre, l’exemple français de 1991
- La division Daguet en 1990-1991
- Proclamation du califat en 2014
- Clausewitz en Ukraine
- De l’importance à donner aux guerres
- Doc. – Justifier une guerre
- Doc. – La stratégie de défense française
- Obama contre la guerre
- Quelques sources sur la guerre en Ukraine
- Introduction sur la guerre
- Axe 1 – La dimension politique de la guerre
- Axe 2 – Le défi de la construction de la paix
- Travail conclusif – Le Moyen-Orient
- Liste de dissertations sur « faire la guerre, faire la paix »
- Liste d’études de doc(s) sur « faire la guerre, faire la paix »
- QCM sur les guerres contre l’Irak
- Révisions sur la guerre et la paix
- Doc. – Entrée de Manoukian au Panthéon
- Doc. – Le Kassaman
- Doc. – Pourquoi faire la guerre ?
- Génocide à la machette
- Le point de vue des manuels algériens
- L’historiographie de la guerre d’Algérie en France
- Liste de dissertations sur « histoire et mémoires »
- Liste d’études de doc(s) sur « histoire et mémoires »
- Cours sur le patrimoine
- Liste de dissertations sur « le patrimoine »
- Liste d’études de doc(s) sur « le patrimoine »
- Right here, right now
- Liste de dissertations sur « l’environnement »
- Liste d’études de doc(s) sur « l’environnement »
- Introduction sur la connaissance
- Axe 1 – Produire et diffuser des connaissances
- Axe 2 – La connaissance, enjeu politique et géopolitique
- Travail conclusif – Le cyberespace
- Doc. – Le Nobel des Curie
- Carte – Les datacenters
- Déclaration d’indépendance du cyberespace
- Madame Pierre Curie
- Liste d’études de doc(s) sur « l’enjeu de la connaissance »
- Liste de dissertations sur « l’enjeu de la connaissance »
- Révisions sur la connaissance
- 2020, sujet zéro n° 1
- 2020, sujet zéro n° 2
- 2020, sujet zéro n° 3
- 2021, sujet J1 pour la Métropole et les DOM
- 2021, sujet J2 pour la Métropole et les DOM
- 2021, sujet J1 pour les centres étrangers (g 1)
- 2021, sujet J2 pour les centres étrangers (g 1)
- 2021, sujet J1 pour l’Amérique du Nord
- 2021, sujet J2 pour l’Amérique du Nord
- 2021, sujet pour l’Asie et l’Océanie
- 2021, sujet J1 pour candidat libre
- 2021, sujet J2 pour candidat libre
- 2021, sujet J1 de rattrapage
- 2021, sujet J2 de rattrapage
- 2022, sujet J1 pour la Polynésie française
- 2022, sujet J2 pour la Polynésie française
- 2022, sujet J1 pour la Métropole
- 2022, sujet J1 pour les centres étrangers (g 1)
- 2022, sujet J2 pour la Métropole
- 2022, sujet J2 pour les centres étrangers (g 1)
- 2022, sujet J1 pour l’Asie et l’Océanie
- 2022, sujet J1 pour l’Amérique du Nord
- 2022, sujet J1 pour Mayotte et l’AEFE
- 2022, sujet J2 pour l’Asie et l’Océanie
- 2022, sujet J2 pour l’Amérique du Nord
- 2022, sujet J2 pour Mayotte et l’AEFE
- 2022, sujet J1 du rattrapage
- 2022, sujet J2 du rattrapage
- 2022, sujet J1 pour l’Amérique du Sud
- 2022, sujet J2 pour l’Amérique du Sud
- 2022, sujet J1 pour la Nouvelle-Calédonie
- 2022, sujet J2 pour la Nouvelle-Calédonie
- 2023, sujet J1 pour la Polynésie française
- 2023, sujet J2 pour la Polynésie française
- sujet J1 pour les centres étrangers (g 1)
- Sujet J2 pour les centres étrangers (g 1)
- Sujet J1 pour la Métropole
- Sujet J2 pour la Métropole
- Sujet J1 pour le Liban
- Sujet J2 pour le Liban
- Sujet J1 pour l’Asie-Pacifique
- Sujet J2 pour l’Asie-Pacifique
- Sujet J1 pour l’Amérique du Nord
- Sujet J2 pour l’Amérique du Nord
- Sujet J1 pour La Réunion
- Sujet J2 pour La Réunion
- 2023, sujet J1 pour la Nouvelle-Calédonie
- 2023, sujet J2 pour la Nouvelle-Calédonie
- 2023, sujet de rattrapage pour la Polynésie
- 2023, sujet J2 du rattrapage
- 2023, sujet J1 pour l’Amérique latine
- 2023, sujet J2 pour l’Amérique latine
- Exemples de sujets du grand oral
- Épreuve terminale d’HGGSP
- À lire, à voir ou à écouter
- Méthode : l’épreuve orale terminale
- Méthode : l’étude critique
- Méthode : la dissertation
- Parfois, les élèves de terminale participent
- Programme de la spé HGGSP en terminale
- Carte : des lieux de mémoire
- Doc. : le Parti communiste français et la Résistance
- La lettre de Guy Môquet
- Petites commémo’ entre amis
- Doc. : le lancement du plan Marshall
- Méthode : l’analyse de document(s)
- Méthode : la réalisation d’une production graphique
- Méthode : la réponse à une question problématisée
- Liste des sujets possibles au bac en ES/L
- Sujets d’annales zéro 2012
- Sujets du bac ES ou L 2013
- Sujets du bac ES ou L 2014
- Sujets du bac ES ou L 2015
- Sujets du bac ES ou L 2016
- Sujets du bac ES ou L 2017
- Sujets du bac ES ou L 2018
- Sujets du bac ES ou L 2019
- 2015 : les États-Unis et le monde à la fin des années 1960
- Liste des sujets possibles au bac en S
- Sujets d’annales zéro 2014
- Sujets du bac S 2015
- Sujets du bac S 2016
- Sujets du bac S 2017
- Sujets du bac S 2018
- Sujets du bac S 2019
- Apprenez vos cartes !
- Croquis : l’inégale intégration des territoires dans la mondialisation
- Croquis : le continent africain, contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation
- Croquis : les dynamiques territoriales au Brésil
- Croquis : les dynamiques territoriales aux États-Unis
- Croquis : les espaces maritimes, approche géostratégique
- Croquis : Mumbai, inégalités et dynamiques territoriales
- Croquis : pôles et flux de la mondialisation
- Faire un croquis sur les pôles et flux
- EMC et laïcité
- Pluralisme des croyances et des cultures
- Vidéo : mettre les gens dans des cases
- Cours : des cartes pour comprendre le monde
- Croquis : la puissance militaire étasunienne
- Doc. : cartes du PIB et de la pollution
- Doc. : cartes sur les internautes
- Cours : les dynamiques de la mondialisation
- Doc. : 2017, Xi à Davos
- Doc. : la mondialisation financière
- Schéma : les flux de marchandises
- Schéma : les flux pétroliers
- Schéma : les villes alpha
- 2005, le manifeste de Porto Alegre
- Carte : exemples au Sahara
- Carte : les limites du Sahara
- Cartes : villes américaines à apprendre
- Corrigé : internet en Afrique
- Cours : les grandes aires continentales
- Croquis : des régions brésiliennes caricaturales
- Croquis : une Afrique caricaturale
- Doc. : 2006, le président des États-Unis est le Diable
- Doc. : 2015, Obama en Afrique
- Doc. : l’intégration régionale en Amérique du Nord
- Doc. : le portable en Afrique
- Faire un croquis sur Internet en Afrique
- Schéma : les ressources sahariennes exportées
- Cours : l’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie
- Doc. : l’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie
- Doc. : le Kassaman
- L’État, l’historien et l’« exigence de vérité »
- Cours : l’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France
- QCM : prérequis sur la Seconde Guerre mondiale
- Doc. : 1995, le discours du Vel’d’Hiv’
- Doc. : avant-propos de Paxton
- Doc. : la première génération d’historiens
- Doc. : le tournant des années 1990-2000
- Doc. : Macron à Oradour
- Les mémoires de Chirac
- Carte : bases des forces armées des États-Unis
- Corrigé : 2018, Trump au G7
- Doc. : les États-Unis et le monde à la fin des années 1960
- Doc. : les États-Unis et le monde en 1947
- Doc. : les États-Unis et le monde en 1990
- Doc. : les États-Unis et le monde en 2014
- Doc. : les États-Unis et le monde en 2016
- 2009, le discours du Caire d’Obama
- 2012, Obama a refusé de construire l’Étoile de la Mort
- 2016, And the Winner is...
- 2017, Troop Talk
- Des tensions en mer de Chine
- Doc. : 1972, communiqué de Shanghai
- Doc. : 2001, l’entrée de la Chine à l’OMC
- Doc. : 2009, discours et défilés d’anniversaire
- Doc. : l’alliance sino-soviétique
- Doc. : la Chine et le monde des années 1960 aux années 1980
- Doc. : la guerre de Corée vue de Chine
- Doc. : la rupture sino-soviétique
- Carte : Proche et Moyen-Orient
- Conseils aux voyageurs
- Des repères géographiques au Moyen-Orient
- Doc. : 2014, le califat selon Dabiq
- Doc. : 2016, l’odeur de la troisième guerre mondiale
- Doc. : l’élection présidentielle syrienne de 2014
- Doc. : la Chine au Moyen-Orient
- Doc. : les hydrocarbures, un des enjeux du Moyen-Orient
- Cours : grandes puissances et conflits
- Doc. : divisions pendant la République de Weimar
- Proclamations de la république à Berlin
- USPD & SPD : Bedingungen zum Eintritt in die Regierung
- Was will der Spartakusbund
- Cours : les échelles de gouvernement
- Doc. : approfondissement et élargissement
- Doc. : étapes pour l’Union européenne
- Doc. : la gouvernance mondiale
- Doc. : le rôle de l’État en France
- Doc. : quel est l’avenir de l’Union européenne ?
- Doc. : une photo de famille
- Juncker sur le Brexit
- L’appel de Cochin
- Le nationalisme, c’est la guerre !
- Mayday ! Il faut sauver le soldat Europe !
- 1849, l’idée des États-Unis d’Europe
- Méthode : l’analyse de doc(s)
- Méthode : la composition
- Méthode : le croquis
- Méthode : le schéma
- Programme en terminale ES/L
- Programmes en terminale S
- Tu veux les sujets d’histoire-géographie du bac S ?
- Liste de questions problématisées pour la terminale
- Programme en terminale (2019)
- Chapitre d’introduction à l’HGGSP
- Doc. – De la démocratie représentative (Reclus et Sieyès)
- Doc. – Du rôle du citoyen (Mendès France et Debré)
- Doc. – Tocqueville et les législatives de 1848
- Élections, piège à cons
- Voter, c’est abdiquer
- Doc. – Caricatures sur la démocratisation au Portugal
- Doc. – Réactions au coup d’État de 1973
- El pueblo marcha
- Testament de Pinochet
- Doc. – La blague européenne officielle
- L’Europe selon de Gaulle
- Le discours d’adieu de Juncker
- Doc. – Dixième guerre russo-turque
- Doc. – Lettre de Soliman le Magnifique (le Législateur)
- Doc. – Mehémet-Ali
- Blagues russes
- Le monde vu par Poutine en 2007
- Carte : les nouvelles routes de la soie
- Des usages de la gastronomie
- Doc. – Un soft power viticole ?
- 2016, And the Winner is... Donald
- Doc. – Amerika
- Doc. – Le président des États-Unis est le Diable
- Introduction sur la puissance
- Axe 1 – Essor et déclin des puissances
- Axe 2 – Formes indirectes de la puissance
- Travail conclusif – Les États-Unis
- QCM sur les puissances
- Conférence de l’ONU sur le cyberespace
- Le retour de la Russie au G7
- Réussir à l’oral comme Obama
- Introduction sur les frontières
- Axe 1 – Tracer les frontières
- Axe 2 – Les frontières en débat
- Travail conclusif – Les frontières de l’UE
- Carte : limes germanicus
- Carte : la zone intercoréenne
- Carte : la frontière germano-polonaise
- Carte : les frontières maritimes
- Conseil européen
- Épreuve sur les frontières
- Carte : les frontières françaises
- Introduction sur l’information
- Axe 1 – Révolutions techniques de l’information
- Axe 2 – Liberté de l’information
- Travail conclusif – L’information à l’heure d’internet
- Doc. – 1991, une photo sur une guerre
- Le complotisme en France
- Le « bordereau » de 1894
- Les Américains sur la Lune
- Faire une revue de presse
- Introduction sur États et religions
- Axe 1 – Pouvoir et religions : des liens historiques traditionnels
- Axe 2 – États et religions : une inégale sécularisation
- Objet conclusif – État et religions en Inde
- Doc. – Donald Book
- La Querelle des Investitures
- Carte – Les religions en ville
- Capacité d’analyser : l’étude critique
- Capacité d’argumenter : la composition
- Capacité de s’exprimer à l’oral
- Capacité de se documenter
- Liste de compositions pour l’HGGSP en première
- Parfois, les élèves de première participent
- Programme d’HGGSP en première
- Liste de questions problématisées pour la première
- Sur les coefs du bac
- Sur les EC (ex E3C)
- Doc – Le serment du Jeu de paume
- Corrigé – Le serment du Jeu de paume
- Doc. – Roland et la fuite du roi
- Doc. – Déclaration de Vérone
- Doc. – « Quel roman que ma vie ! »
- Doc. – 1812 : victoire en Russie
- Doc. – Comment Bonaparte se juge en 1816
- Doc. – Le bulletin d’Austerlitz
- Doc. – Sa Majesté impériale
- Doc. – Bonaparte jugé au XXIe siècle
- Doc. – La charte de 1814
- Doc. – Le massacre de Chios
- Doc. – La Liberté guidant le peuple
- Cours – La Révolution et l’Empire
- Cours – Restauration et révolution (1814-1848)
- QCM révolutionnaire et impérial
- La Révolution est un bloc
- Les femmes doivent-elles exercer les droits politiques ?
- Sur le suffrage censitaire
- La motion Curée
- QCM sur le film Napoléon de Ridley Scott
- Cours – La métropolisation
- Carte – Les mégapoles
- Croquis – Le poids croissant des métropoles
- Doc. – La croissance urbaine
- Doc. – Shanghai
- Doc. – Des métropoles photogéniques
- Carte – Les métropoles en France
- Croquis – La métropolisation de la France
- Croquis – Paris : la métropolisation et ses effets
- Doc. – Le système urbain français
- Doc. – Ségrégation spatiale
- Carte – Exemples sur les métropoles
- Cours – Deuxième République et Second Empire
- Cours – Changements économiques et sociaux
- Cours – Unifications italienne et allemande
- Doc. – Le manifeste à l’Europe de Lamartine
- Doc. – Les élections de 1848 à Tocqueville
- Doc. – Un problème pour Bonaparte
- Doc. – Combat de barricades en 1851
- Doc. – Discours d’entrée en guerre
- Doc. – Peintures de la guerre de 1870-1871
- La dictée de Mérimée
- Le Manifeste des Soixante
- Cours – Les espaces productifs
- Tourisme industriel en France
- Carte – Exemples d’espaces productifs
- Carte – L’exemple de l’A380
- Carte – Production agricole en France
- Carte – Production industrielle en France
- Cours – La mise en œuvre du projet républicain
- Cours – Société française de 1871 à 1914
- Cours – Métropole et colonies
- Carte – Les fortifications du second XIX e siècle
- Le début de la Commune
- Doc. – Un fief capitaliste : Le Creusot
- Carte – Saïgon, ville coloniale
- Corrigé – Ferry vs Clemenceau
- Doc. – 1885, Ferry vs Clemenceau
- L’ambiance entre députés
- Cours – Les espaces ruraux
- Ballade rurale en Toscane
- Cours – Phases et formes de la Grande Guerre
- Cours – Sociétés en guerre
- Cours – Sortir de la guerre
- 700 000 disparus
- Quelle connerie la guerre !
- Doc. – L’information en temps de guerre
- Doc. – Le traité de Versailles
- Reconstitutions de séance parlementaire
- Partis politiques
- Élections européennes de 2014
- Élections présidentielles de 2017
- Vidéo : Voteman
- Élections européennes de 2019
- Élections régionales 2021
- Élections présidentielles 2022
- Élections législatives 2022
- Élections européennes de 2024
- Monopoly inégalitaire
- Axe 1 – Le lien social fragilisé ?
- Axe 2 – Recompositions du lien social
- Les « grands récits » selon Johann Chapoutot
- Lettre concernant l’instruction morale et civique
- Uchronie sur les programmes scolaires
- Méthode : la prise de notes
- Fonds de carte
- Méthode : s’exprimer à l’oral
- Carte : bases des forces armées françaises
- L’opération Serval, l’exemple d’une OPEX
- Les OPEX en perspective historique
- Sujets de recherche
- Carte : les régions françaises
- Carte : liaison Seine - Escaut
- Cours : comprendre les territoires de proximité
- Croquis : l’Île-de-France
- Le Grand Paris Express
- Croquis : l’estuaire de la Seine
- Croquis : le plateau de Saclay
- Croquis : les connexions avec les États voisins
- Croquis : les espaces agricoles
- Croquis : les espaces productifs français dans la mondialisation
- Croquis : les mouvements de population et la croissance urbaine
- Croquis : Roissy
- Schéma : les relocalisations de la sidérurgie
- Schéma : potentialités et contraintes du territoire français
- Carte : les climats en France
- Carte : les métropoles en France
- Carte : les reliefs en France
- Cours : aménager et développer le territoire français
- Doc. : la hiérarchie urbaine en France
- Doc. : les gares de la LGV Est
- Doc. : les unités urbaines françaises
- Doc. : les villes moyennes face à la métropolisation
- Doc. : politique de la ville à Vaulx-en-Velin
- Carte : l’espace Schengen
- Carte : l’Union européenne
- Carte : la zone euro
- Cours : l’Union européenne
- Croquis : le référendum néo-calédonien de 2018
- Croquis : les disparités dans l’Union européenne
- Doc. : développement à La Réunion
- Carte : le développement du port de Rotterdam
- Carte : les DOM-COM
- Carte : Paris ville globale
- Cours : France et Europe dans le monde
- Croquis : la Northern Range
- Corrigé : croissance et crises
- Corrigé : la soif de pétrole
- Corrigé : Londres en 1860
- Cours : croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés
- Doc. : croissance et crises
- Doc. : l’économie-monde britannique
- Doc. : l’immigration polonaise
- Doc. : l’interview de Schneider
- Doc. : la soif de pétrole
- Doc. : les producteurs de charbon
- Doc. : Londres en 1860
- Doc. : Manchester au XIX e siècle
- Doc. : pour ou contre la croissance
- Doc. : pourquoi ont-il tué Jaurès ?
- Last Night of the Proms
- Clemenceau jusqu’auboutiste
- Corrigé : un village d’Alsace
- Doc. : conséquences des pertes
- Doc. : de l’emploi des artistes en temps de guerre
- Doc. : la presse fait sa propagande
- Doc. : le traité de Versailles
- Doc. : un village d’Alsace
- Doc. : Verdun, lieu de mémoire ?
- The poppies
- Carte : les camps de la mort
- Doc. : appel radiodiffusé de Goebbels à la guerre totale
- Doc. : discours d’Himmler à Posen
- Doc. : l’exemple d’Iwo jima
- Doc. : le front de l’Est, une guerre d’anéantissement
- Doc. : Na Berlin !
- La Grande Guerre patriotique
- Les lois de la guerre
- Doc. : le pacte Briand – Kellogg
- Compo. : les symboles de la guerre froide
- Doc. : ceux du Nord Viêt Nam
- Doc. : la correspondance de Samantha avec Andropov
- Doc. : la crise de Cuba selon Khrouchtchev
- Doc. : la guerre du Viêt Nam à travers les chansons
- Doc. : la seconde crise de Berlin
- Doc. : le discours de Jdanov
- Doc. : trois acteurs de la crise de Cuba
- Une guerre thermonucléaire globale ?
- 1947, Truman vs Jdanov
- 1989 à Berlin, vue du quai d’Orsay
- Doc. : le siège de Sarajevo
- 2017, le monde se prépare pour une guerre ?
- Cours : la guerre au XX e siècle
- Doc. : pour une propagande efficace
- Petit discours d’encouragement
- Blagues soviétiques
- Cours : le siècle des totalitarismes
- Doc : le programme nazi de 1920
- Doc. : 2009, l’UE et le totalitarisme
- Doc. : la jeunesse hitlérienne
- Doc. : Mein Kampf
- Doc. : un schéma nazi
- Musique soviétique
- 1938, liste des dictatures
- Cours : colonisation et décolonisation
- Doc. : 2005, le rôle positif de la colonisation
- Doc. : dessins de presse sur la colonisation
- Doc. : soutenez l’indépendance des colonies !
- Liste des colonies
- 1958, « Je vous ai compris ! »
- Cours : les Français et la République
- Doc. : 1944, résistance et refondation
- Doc. : l’antisémitisme sous la III e République
- Doc. : la réforme de 1962
- Doc. : le préambule de la Constitution de 1946
- Doc. : Léon Blum appelle au calme
- Doc. : propositions de collaboration
- Doc. : Simone Veil devient ministre de la Santé
- Le banquet républicain de 1900
- QCM sur les III e , IV e et V e républiques
- 1941, la démission de Jules Basdevant
- Conseils pour les TPE
- Exemples de sujets de TPE
- Les TPE en première ES 2
- Mini-TPE en seconde
- Thèmes des TPE en ES
- Programmes en première ES et L
- La course pour votre orientation
- Parfois, les élèves participent
- Programme en première (2019)
- Cours – La périodisation
- Doc. – De bons présages
- Cours – La Méditerranée antique
- Cours – la Méditerranée médiévale
- Doc. – Juvénal et les Grecs
- Doc. – La Politique d’Aristote
- Doc. – Le Siècle d’Auguste
- Doc. – Les Actes du divin Auguste
- Doc. – Les empreintes grecques et romaines
- Doc. – Thucydide, II, 34 & 37
- Pour te faire aimer la mythologie
- Doc. – Appel à la croisade
- Doc. – Dar al-islam & djihad
- Doc. – L’encyclique de croisade de 1146
- Doc. – Rappel à l’ordre par l’Église
- Doc. – Traité de conquête de Jérusalem
- Doc. – Venise & Alep
- Cours – Sociétés et environnements
- Négociations à la COP
- Reconstitutions du marché pétrolier
- Sujets de recherche environnementaux
- Doc. – L’EPR de Flamanville
- Doc. – Le débat autour du nucléaire civil
- Doc. – Les choix énergétiques des États
- Doc. – Les coûts du mix énergétique
- Doc. – Enjeux de l’empreinte carbone
- Pratchett et les centrales nucléaires
- Carte – L’énergie en France
- Cours – L’ouverture atlantique
- Cours – Renaissance, Humanisme et réformes
- Doc. – L’Armada da Índia de 1500
- Doc. – Landing of Columbus
- Doc. – Le contrat de Christophe
- Doc. – Le retour de Vasco de Gama
- Doc. – Les Amérindiens ont-ils des droits ?
- Doc. – Un bilan de la découverte des Amériques
- Les voyages de découverte portugais
- Magellan part à l’ouest
- Doc. – Les 95 thèses de Luther
- Doc. – « À tous ceux qui liront ce livre, salut. »
- Le plafond de la Sixtine
- Voyage au pays des incunables
- QCM sur les découvertes
- Cours – Populations et développement
- Croquis – Des régions brésiliennes caricaturales
- Doc. – Transition démographique en Ukraine
- QCM sur le développement
- Cours – L’affirmation de l’État dans le royaume de France
- Cours – Le modèle britannique et son influence
- Cours – Des mobilités généralisées
- Migrant c’est mon choix
- Cours – Les Lumières et le développement des sciences
- Cours – Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres
- Judith & Holopherne
- Axe 1 : des libertés pour la liberté
- Les libertés collectives (exposés en S01)
- Les libertés collectives (exposés en S05)
- La protection des libertés
- Axe 2 : les libertés en débat
- À boire !
- Doc. : la xénophobie en France
- Du harcèlement à l’école ?
- Exemple de relation individu/État
- Lutte contre les discriminations
- Pourquoi nous détestent-ils ?
- Vidéo : un jeu de société
- California vs Baja California
- Cours : un développement inégal
- Faire un croquis sur les inégalités d’internet
- Faire un croquis sur les inégalités de richesse
- Quelles activités émettent des gaz à effet de serre ?
- Une « vraie interro »
- Ce que mange l’Humanité
- Cours : gérer les ressources
- Croquis : l’assainissement
- Doc. : quelles centrales électriques construire ?
- La journée de Manisa Ranarijaona
- Les animaux d’élevage
- Carte : les 40 principales agglomérations
- Circuler à Tokyo
- Cours : aménager la ville
- Et les dieux créèrent Mexico
- La carte topographique
- Cours : les Européens dans le peuplement de la Terre
- Doc. : l’évolution de la population
- Doc. : American people
- Corrigé : American people
- Doc. : la répartition de la population
- Doc. : Dear Old Skibbereen
- Cours : citoyenneté dans l’Antiquité
- Doc. : l’héliaste
- Doc. : Thucydide l’historien
- Doc. : Thucydide, II, 37
- L’édit de Caracalla
- La Table claudienne
- Le discours de Calgacus
- Cours : sociétés et cultures de l’Europe médiévale
- Doc. : l’antisémitisme médiéval
- Doc. : l’appel à la croisade
- Doc. : l’inquisition médiévale
- Doc. : la Querelle des Investitures
- QCM : le Moyen Âge
- Cours : les nouveaux horizons à l’époque moderne
- Le sac de Rome en 1527
- Cours : révolutions, libertés et nations
- Doc. : Assassin’s Creed Unity
- Doc. : mars 1848 à Berlin
- Du racisme dans la marine
- Instructions pour une révolution
- Je refuse cette couronne !
- Le calendrier républicain
- Les pamphlets de la fin du XVIII e
- Révisez votre Marseillaise
- Bienvenue en Enfer
- Programmes en seconde
- Choisissez votre spé !
- Programme en seconde (2019)
- Brevet 2017 métropole
- Brevet 2018 Amérique du Nord
- Brevet 2018 métropole
- Brevet 2018 Pondichéry
- Limitations des sujets du brevet en EMC
- Repères chronologiques et spatiaux du brevet
- Programme en troisième
- Géo 1 : l’urbanisation du monde
- Géo. 2 : les mobilités humaines transnationales
- Géo. 3 : des espaces transformés par la mondialisation
- Vues du port de Bordeaux par Joseph Vernet
- L’Europe et le monde au XIXe siècle
- Histoire 3 : société, culture et politique dans la France du XIXe (...)
- Programme en quatrième
- Géo. 1 : la question démographique et l’inégal développement
- Géo. 2 : des ressources limitées, à gérer
- Géo. 3 : prévenir les risques, s’adapter au changement global
- Chapitre 1 : L’empire byzantin
- L’Occident féodal au XIe - XVe siècle
- Programme en cinquième
- Géo. 1 : habiter une métropole
- Géo. 2 : habiter un espace de faible densité
- Géo. 3 : habiter les littoraux
- Cours - Le monde habité
- Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et...
- La lamentation d’Ur
- La stèle des vautours
- Le banquet d’Assurnazirpal II
- Le code de Hammurabi
- Histoire 2 : récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée (...)
- Histoire 3 : l’empire romain dans le monde antique
- Programme en sixième
Statistiques
Dernière mise à jour, publication, sous-rubriques.

Intégrer Sciences Po
Sujets d’entraînements sur le thème de la Démocratie
Si vous souhaitez vous entraîner, nous vous offrons une sélection de sujets blancs sur le thème de la Démocratie.
Nous vous conseillons, comme pour les autres sujets d’entraînement , de bâtir un plan détaillé pour autant de sujets que vous pourrez parmi la liste suivante.
Un plan détaillé, cela comprend si on veut faire les choses en grand et en bien : l’introduction avec problématique et plan, puis le titre de vos grandes parties, le titre de vos sous-parties, et des tirets à l’intérieur de chaque sous-partie qui indiquent vos idées à développer, et enfin une conclusion.
Oui on vous en demande beaucoup, et oui c’est la meilleure façon de faire et la plus complète ! Nous n’oublions pas pour autant d’être pragmatiques et nous savons que le temps est précieux ou tout simplement, de façon bien moins avouable, que vous avez la flemme. Dans ce cas, vous pouvez vous contenter de réfléchir aux grands axes que comporteront votre devoir, quelle sera la problématique.
Churchill déclare en 1947 : « it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time »
Par exemple, voici notre sujet préféré : L’État est-il l’ennemi de la démocratie ? . Quels sont vos plans ? Vos idées ? Ecrivez-les en commentaires de cet article pour voir ce que les autres en pensent. Demain, revenez-ici, lisez votre commentaire, et réfléchissez : comment pourriez-vous améliorer votre travail de la veille ?
- La démocratie va-t-elle de soi ?
- De tous les régimes imparfaits qui ont existé, la démocratie est-elle le meilleur d’entre eux ?
- La démocratie peut-elle évoluer ?
- Comment la démocratie s’accomode-t-elle d’être dirigée par quelques hommes ?
- La démocratie est-elle le pouvoir du peuple pour le peuple ?
- Dans certains cas, la société peut-elle se passer de la démocratie ?
- L’État est-il l’ennemi de la démocratie ?
- Existe-t-il une réelle démocratie ?
Sujets d’entraînements mixtes : Démocratie / École
- L’État est-il l’école de la démocratie ?
- L’école contribue-t-elle à la démocratie ?
- L’école est-elle démocratique ?
- La démocratie s’apprend-elle à l’école ?
En 3 étapes vous pouvez aider les autres et vous-mêmes. C’est très simple, ça s’appelle l’enrichissement mutuel :
1. POSTEZ vos plans en commentaires 2. COMPAREZ vos idées 3. AMELIOREZ votre copie
Consultez également :
→ Sujets d’entraînement de Culture générale → Culture générale : la Démocratie
20 réflexions sur « Sujets d’entraînements sur le thème de la Démocratie »
La suite 🙂 Sujet 4: Comment la démocratie s’accomode-t-elle d’être dirigée par quelques hommes ?. Problématique: La démocratie a-elle dérivé tellement de son sens pur que nous aurons la permission de l’appeler une oligarchie? Pourquoi? Plan: – 1) La démocratie en elle même – 2) pourquoi une oligarchie ? : — a) pour — b) contre — Sujet 6: Dans certains cas, la société peut-elle se passer de la démocratie ? Problématique: La démocratie, est-elle nécessaire pour nous aujourd’hui? En avons-nous vraiment le besoin? Peut-être nous sommes assez grands pour la laisser â côté de la plaque et nous débrouiller tout seul? 🙂 Plan: – 1) qu’est ce que fait la démocratie pour nous – 2) sans elle, nous serions nous maintenant — Sujet 8: Existe-t-il une réelle démocratie? Problématique et plan: on reprend ceux du sujet 1. — Qu’est ce que vous en pensez? Toute critique est acceptée :).
Donc pour le premier sujet, à savoir: La démocratie va-t-elle de soi?. Voici la problématique que j’ai évoquée: – Quelle est la vocation de la démocratie pure et, est-ce qu’à nos jours, elle détient son essence encore, ou ce n’est plus la démocratie de l’époque, et si oui, quelles en sont les causes? Le plan comportera 2 parties suivantes: – 1) La démocratie en Athènes; quelque principe de la démocratie pure (en se basant sur la philosophie politique) – 2) La démocratie d’aujourd’hui: formes, transformations, causes… Le deuxième sujet: de tous les régimes imparfaits qui ont existé, le démocratie est-elle le meilleur d’entre eux? La problématique est la suivante: – Est-ce que aujourd’hui la démocratie mérite d’être nommée le meilleur régime, le régime parfait? Quelles sont les arguments pour et contre ceci? Le plan: – 1) les arguments pour – 2) les arguments contre Je les ai fait en 20-25 minutes, ce n’est pas parfait, mais qu’est-ce que vous en penser? Et qu’est-ce que vous pourriez y ajouter / peut être modifier ?
Lilith, Je trouve ton plan très intéressant ! Pour ta troisième partie, il me semble que tu peux parler des anarchistes, et notamment de Bakounine qui prônait la fin de l’état en tant que tel. Il prône également le fait que sur des sociétés démocratiques avec une population faible (villages, quartiers…) l’Etat n’a pas lieu d’être car les décisions peuvent être prises par les citoyens eux même. Tu peux également parler de Marx, qui pensait l’Etat comme provisoire, éphémère, comme une entité qui sert a réguler les comportements humains (légiférer) et aussi a réguler la production dans son idée de société socialiste. Une fois que tout est en marche l’état n’a plus lieu d’être pour lui. Enfin, je ferais allusion au Contrat Social de Rousseau et à son principe d’intérêt commun;, il faut un Etat pour garantir le fait que les gouvernants agissent dans l’intérêt commun (et non dans leur intérêt personnel) et qu’il sera leur seule préoccupation. J’espère que cela t’aidera et que ce n’est pas trop connoté politiquement pour toi ! 🙂
Lilith, jolie prénom 🙂
Bonjour, pour le sujet l’Etat est-il l’ennemi de la démocratie?, j’ai pensé comme problématique à L’autorité d’un Etat est-elle compatible avec le fonctionnement d’une société démocratique, dans laquelle le pouvoir appartient au peuple ? avec comme plan : 1. L’Etat peut être le cadre de la démocratie (institutions, garantit les droits et les principes démocratiques par des lois) 2. L’Etat peut aussi se révéler contraire à la démocratie (Etat autoritaire; mais aussi dans des sociétés dites démocratiques, le pouvoir de l’Etat supplée parfois à la volonté du peuple + surveillance) 3. Une démocratie sans Etat est-elle possible ? (Internet, réseaux sociaux… = possibilité d’une participation directe…) (je suis un peu moins sûre pour le contenu de cette partie…) Des conseils/critiques ? Merci 🙂
@Mellie Merci bcp pr tes éclairages je v essayer de retravailler tout ça !
@Brutusse , J’ai l’impression que ta problématique n’englobe pas assez ton sujet à sa voir la notion de pour le peuple qui est manquante. Sinon le plan suit le fil rouge de la problématique parfaitement , seulement il vote et choisit ses représentant et peut renverser , le cas échéant les régimes non démocratiques oui et non car ce sont les représentants du peuple qui peuvent renverser un gouvernement et un régime . Je dépose ça là , et j ‘espère que ce sera utile sinon corrigez moi 🙂
Pour le sujet La démocratie est elle le pouvoir du peuple pour le peuple je pensais à une problématique du type Le peuple détient il réellement le pouvoir dans une démocratie ? I- Oui car il vote et choisit ses représentants et peut renverser, le cas échéant les régimes non démocratique. II- Non car le pouvoir finit par se concentrer ds les mains de quelques uns. Perte de confiance du peuple envers politiques. III- Le pouvoir du peuple reste fragile et la démocratie peut rapidement se transformer en un régime anti-démocratique. D’où la nécessité pour le peuple de rester vigilant et de veiller à conserver son pouvoir sur ses dirigeants. Le tout saupoudré de quelques citations de quelques penseurs et hommes politiques. 😉 Voilà désolé si j’ai un peu tartiné mais j’ai pas réussi faire plus concis dans mes intitulés. Je suis preneur de toutes vos critiques, conseils et avis. Bon weekend et bonnes fin de révisions ! 😉
@Laura: Si tous tes messages portent sur le même sujet, penses à tout inclure en un seul commentaire la prochaine fois, le fil de la conversation n’en sera que plus lisible ! De même, à l’attention de tous les usagers, un effort quant à la langue et une relecture rapide pour limiter les fautes d’inattention motiveront davantage vos lecteurs à échanger avec vous à propos de vos idées ! Merci 🙂
@Fanny : Ton plan me semble pertinent et, à mon sens, une première partie sur l’aspect historique est un cadrage nécessaire, qui compléterait ton introduction (le risque serait par contre de ne plus avoir matière à nourrir l’introduction, ou à être redondant alors il faudra doser). La forme oui,non, oui mais est cohérente et balaie par conséquent l’ensemble du sujet. Toutefois après relecture de la problématique je me demande si les parties I et II ne vont pas dans le sens du oui, abandonnant au final l’idée d’une démocratie achevée, qu’il faudrait peut-être prendre en considération alors dans une sous-partie (parce que qui dit réformes, dit évolution et la démocratie figée, qui ne pourrait évoluer ne semble pas apparaître dans ta réflexion). La dernière partie reste également dans cette idée d’une recherche des différentes évolutions possibles de la démocratie. Au final, je crois que c’est la façon dont tu as axé ta problématique qui éloigne progressivement la réflexion du sujet initial (selon ma propre sensibilité, peut-être n’est-ce qu’une impression). Tu t’es focalisée sur la démocratie parvient-elle à s’adapter […], or le sujet portait sur peut-elle le faire, je ne sais pas si la nuance est très claire mais après re-relecture (oui, j’aurai peut-être du lire 4 fois ton commentaire AVANT de commencer à te répondre…!) la divergence est subtile mais perceptible. Voilà, j’espère avoir pu t’éclairer pour que tu puisses t’améliorer !
Bonjour, Pour la démocratie peut-elle évoluer ? , j’ai pensé à la problématique suivante : faceaux changement s de la société actuelle , nous pouvons penser que nous sommes en pleine crise démocratique peut-on la résoudre ? Qu’est ce que vous en pensez ? j’ai le plan si vous voulez
Fanny, moi j’aurais plutôt demanderer en quelle mesure la democratie, lorqu’elle tente d’évoluer perd/gagne en democracité (ça ce dit?) avec democratie directe, indirecte, libérale républicaine, et la variation dans la liberté et l’égalité, qu’en pensez-vous?
Bonjour, Pr le premier sujet je pensais à: La démocratie est elle ds la nature des hommes ? Ca m’est venu comme ca j’avoue que cela peu paraître farfelu et je ne trouve pas spécialement de plans appropriés…(c’est donc possiblement à côté de la plaque) Mais cela me semble être un axe de réflexion possible, aussi si vs avez des idées, remarques ou suggestions n’hésitez pas ! 😉
+ l’Etat n’a pas le monopole de la forme démocratique haha voilà c’est tout pour moi! (UE, Mercosur…)
même uniquement sur le fait d’inculquer la démocratie en fait, c’est léger. Plutôt L’Etat acteur de la démocratie? 🙂 on pourrait inclure plus de choses, le fait par exemple que l’Etat a une certaine responsabilité certes vis-à-vis de la transmission de la pensée démocratique et de la formation du citoyen mais aussi au niveau du respect de la loi, au niveau de la protection des citoyens contre les effets nocifs dee la mondialisation…
j’ai du mal avec votre sujet l’Etat est-il l’école de la démocratie… ça me semble tiré par les cheveux tout de même, une disserte entière sur le rôle de l’Etat en démocratie? come on
Bonjour pour le sujet: La démocratie peut elle évoluer ?, je pensais mettre en problématique: bien que la démocratie soit un régime ayant pour vocation de s’adapter aux différentes mutations de la société pour s’améliorer continuellement, y parvient-elle pour autant ? avec comme plan: I- Depuis son origine, la démocratie à changer de visage, ce qui montre qu’elle est capable de changements (une partie historique mettant en relation les anciennes formes de la démocratie et la démocratie représentative du monde occidental actuel); II- Mais elle semble aujourd’hui en panne et, sous certains aspects,en crise, malgré des tentatives de réformes (je n’arrive pas à rendre la formulation plus explicite); III- Néanmoins il existe des nouvelles formes et moyens de la démocratie qui poussent à repenser la démocratie pour continuer de la faire avancer (j’ai beaucoup hésité à consacrer toute une partie sur l’aspect historique de la question, est ce trop ?) Des avis/conseils ?
@Alice : C’est très bien de mener la réflexion vers le concept de l’« universel ». Tu touches en plein le véritable problème qui est posé là. C’est exactement ce qu’il faut faire : derrière la question « La Démocratie va-t-elle de soi ? », à quoi l’auteur de la problématique a-t-il vraiment pensé ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette question ? Qu’est-ce que le correcteur ou le professeur a en tête ? La remarque de Gaël est tout à fait pertinente. Pour le plan, n’hésite pas à indiquer les titres de tes parties. Un plan 2×2 ou un plan 3×2/3×3 conviennent sur la forme : tout dépend du fond, et de la logique que tu veux y mettre.
Bonjour, la problématique me semble bien mais peut être au lieu de le meilleur des régimes j’aurais plutôt mis un régime efficace ou quelque chose comme ça. Cela permet d’ouvrir d’autres pistes de reflexion je trouve.
Bonjour, pour le premier sujet la démocratie va-t-elle de soi que pensez vous de la problématique La démocratie est elle le meilleur des régimes, et à ce titre universelle? avec un plan 2×2? Merci!
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.


Thème 1 – Comprendre un régime politique : la démocratie
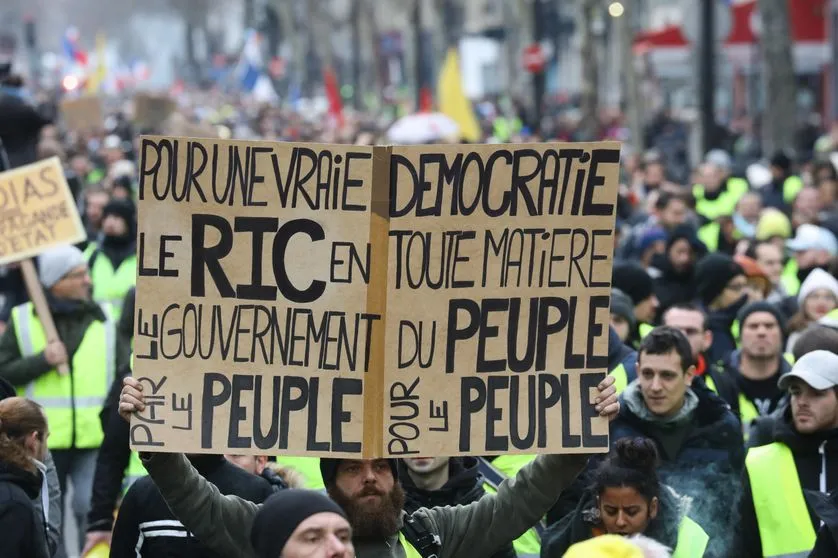
MODULE D ‘ INTRODUCTION : DÉMOCRATIE(S)
Quelles sont les caractéristiques des démocraties contemporaines ?
QUESTIONNER
Il s’agit ici de questionner ce qu’est une démocratie à partir de vos représentations. Quelle image représente pour vous le mieux la démocratie ?
L’approfondissement doit permettre d’apporter des éléments de définition incontournables pour aborder la thématique des démocraties.
L’exploration vise à identifier les caractéristiques communes aux démocraties et à les comparer avec quelques régimes autoritaires contemporains.
Ces exercices autocorrectifs peuvent être utilisés pour réactiver les éléments travaillés en classe, travailler leur mémorisation
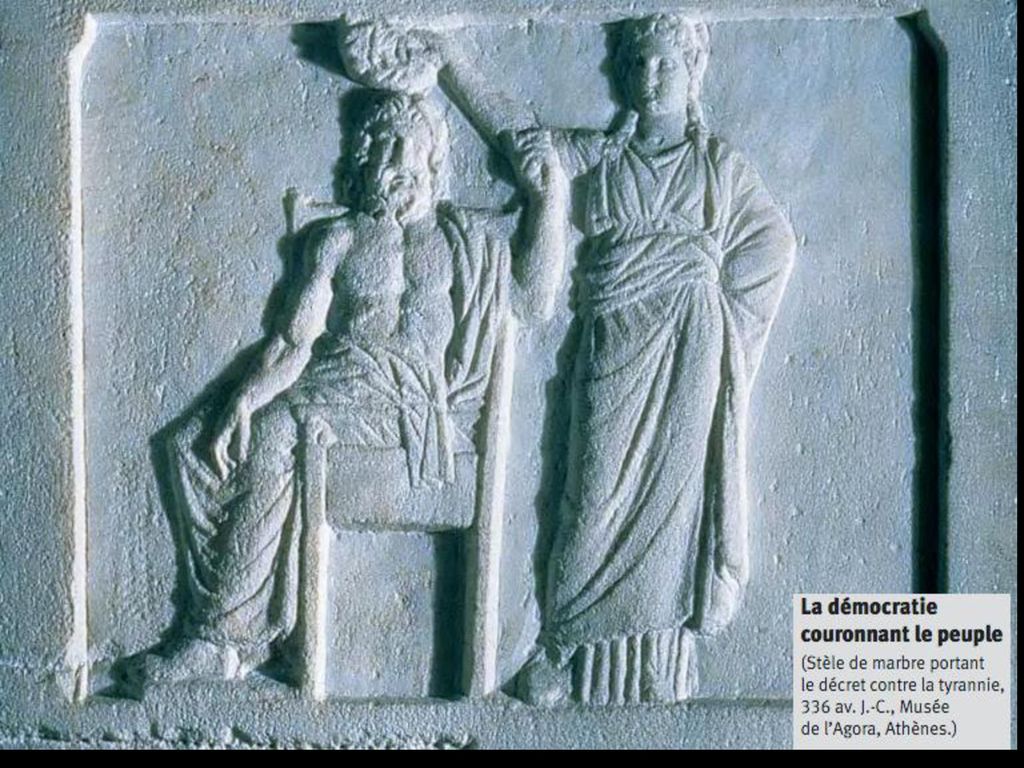
MODULE 1 : PENSER LA DÉMOCRATIE
Comment la démocratie a-t-elle évolué d’une démocratie directe à un régime représentatif qui est aujourd;hui la norme ?
Vous avez travaillé sur la démocratie athénienne au tout début de l’année de Seconde. Prenons le temps de réactiver les principales caractéristiques de son fonctionnement
JALON 1 : ATHÈNES
Quelles sont les caractéristiques de la démocratie athénienne au Vème siècle AEC ?
JALON 2 : BENJAMIN CONSTANT
Comment le philosophe Benjamin Constant imagine-t-il d’organiser la souveraineté du peuple dans les societés modernes ?
S’ENTRAÎNER
Révisons ensemble quelques pistes pour analyser un sujet et construire un plan. En bonus, exprimez vous à l’oral sur un sujet parmi ceux proposés.
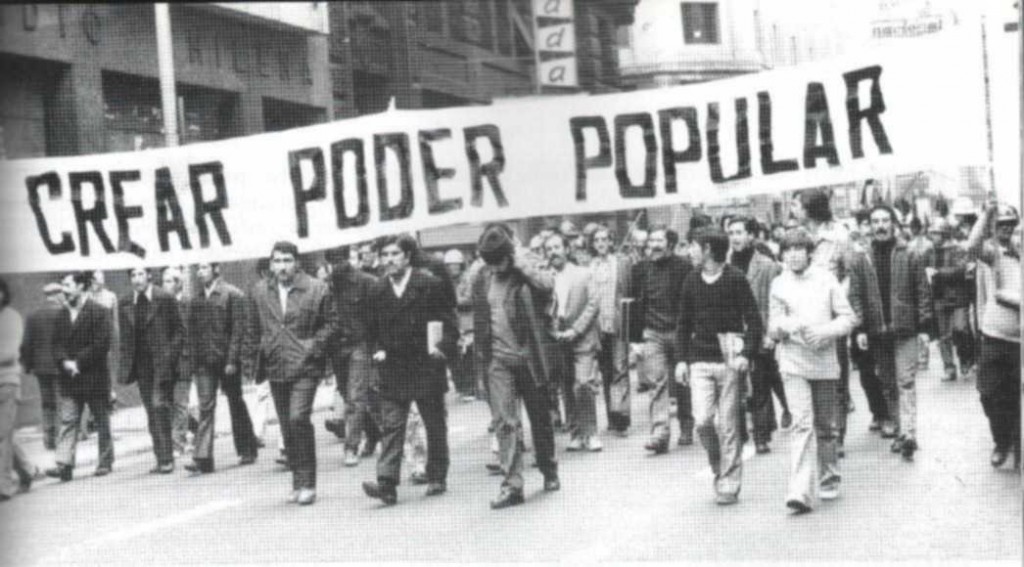
MODULE 2 : AVANCÉES ET RECULS DES DÉMOCRATIES
En quoi les avancées et reculs de la démocratie dans l’histoire témoignent-ils de ses forces et de ses faiblesses ?
JALON 3 : ALEXIS DE TOCQUEVILLE
D’après Alexis de Tocqueville, quels dangers menacent la démocratie ?
La démocratie est un régime fragile et de nombreux reculs démocratiques ont eu lieu au cours de l’histoire. A l’inverse, des avancées majeures sont à souligner. Comment ces évolutions témoignent-elles des forces et faiblesses de ce régime ?
JALON 4 ET 5 : DÉMOCRATIES ET RÉGIME AUTORITAIRE
Partons à la découverte de plusieurs pays d’Europe et d’Amérique pour y étudier les reculs et les avancées de la démocratie au XXème siècle.
S’ENTRAINER
Des exercices facultatifs pour travailler les grands exercices de la spécialité

MODULE DE CONCLUSION : L’UE ET LA DÉMOCRATIE
Quel modèle de démocratie l’Union Européenne expérimente-t-elle et quelles difficultés rencontre-t-elle ?
Qu’est ce que l’Union Européenne? Qui la compose? Comment fonctionne-t-elle? Revenons sur ce que vous avez déjà étudié les années précédentes.
JALON 6 : LE FONCTIONNEMENT DE L’UE
Comment les institutions européennes permettent-elles de combiner différents systèmes démocratiques ?
JALON 7 : L’UE FACE AUX CITOYENS ET AUX ÉTATS
Quelles difficultés le système démocratique de l’UE rencontre-t-il depuis les années 1990 ?
Un cours pour synthétiser les grands éléments de ce module conclusif autour des caractéristiques du modèle démocratique européen et les difficultés auquel il fait face.
Des exercices pour travailler les grands exercices de la spécialité.
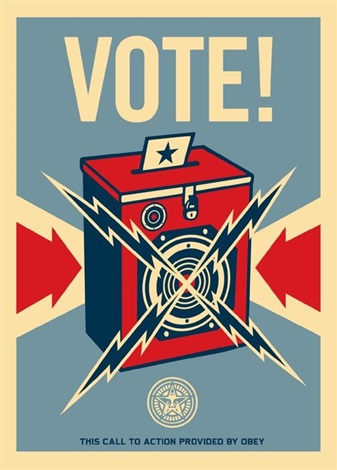
OUTILS POUR LA MÉMORISATION
- Archives du BAC (43 534)
- Art (11 061)
- Biographies (6 177)
- Divers (47 455)
- Histoire et Géographie (17 971)
- Littérature (30 273)
- Loisirs et Sports (3 295)
- Monde du Travail (32 158)
- Philosophie (9 544)
- Politique et International (18 653)
- Psychologie (2 956)
- Rapports de Stage (6 975)
- Religion et Spiritualité (1 441)
- Sante et Culture (6 436)
- Sciences Economiques et Sociales (23 576)
- Sciences et Technologies (11 297)
- Société (10 929)
- Page d'accueil
- / Politique et International
La séparation des pouvoirs ( plan détaillé)
Par Diana Cristina • 24 Octobre 2019 • Dissertation • 949 Mots (4 Pages) • 8 623 Vues
DISSERTATION
LA SEPARATION DE POUVOIRS
PHRASHE D’ACCROCHE : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » a dit Montesquieu pour mettre en évidence la nécessite de la séparation de pouvoir dans l’état.
DEFINITIONS :
Division verticale de la pouvoir – consiste à repartir le pouvoir entre les différents organes de l’état afin d’éviter sa concentration au profit d’un seul.
Division horizontale de la pouvoir – concerne quant à elle la répartition entre l’état central et les collectivités qui le composent.
PROBLEMATIQUE :
La question qui se pose est de savoir si l’application de la théorie de la séparation de pouvoirs assure un bon fonctionnement de l’état démocratique
Pour répondre à cette question, on va s’intéresse d’une cote sur « La division du pouvoir » (I) et sur d’autre cote sur « L’importance de la théorie » (II).
- LA MANIERE PLURIELLE DE LA THEORIE
- Le principe du partage du pouvoir étatique est admis comme une condition essentielle de la réalisation de l’état de droit
- Donc, on doit détailler sur les deux perspectives à partir desquelles cette phrase « séparation de pouvoirs » peut être vue
- Division horizontale de la pouvoir
L’état démocratique se caractérise par l’existence d’une pluralité d’organes et l’organisation en pouvoirs distincts. Donc, la théorie de la séparation de pouvoirs, en manière horizontale, représente la distinction entre 3 fonctions :
- Législative – qui fait les lois
- exécutive – qui applique la loi de manière générale
- juridictionnelle – qui applique la loi de manière particulière
Il existe 2 modelés de séparation des pouvoirs :
- le modelé américain
- il est un peu déséquilibre parce que :
- il y a des périodes durant lesquelles le président est puissant et on a le gouvernement présidentiel ;
- et il y a des périodes quand le congrès est fort et puissant et on a le gouvernement congestionnelle
- le modelé européen
- ici, nous avons la conception des divisions bipartites de pouvoirs
- la constitution consacre les 3 pouvoirs, le pouvoir judiciaire d’être autonome
- le modelé américaine présent une séparation rigide, pendent que le modelé européenne a une séparation souple.
- Rigide – parce que il n’existe pas de droit de dissolution
- Division verticale de la pouvoir
La division verticale du pouvoir représente le problème de l’organisation des formes d’état.
Donc, on va parler sur :
- L’état fédéral
- L’état régional
- L’état unitaire décentralisé
Il y a des états fédéraux dans lesquels il existe un ensemble de pouvoirs au niveau central (niveaux exécutif, législatif et judiciaire, chacun avec ses propres institutions) et un ensemble de pouvoirs au niveau local (représentés par chaque état fédéral)
Tout cela avec son propre parlement, son propre exécutif;
Tous les parlements fédéraux, les tribunaux des États fédéraux et les gouvernements des États fédéraux sont subordonnés aux autorités fédérales, par exemple le Parlement fédéral
- L’IMPORTANCE DE LA THEORIE DANS L’ETAT DEMOCRATIQUE
- On va parler sur la vision de la théorie dans le 18eme siècle et dans l’époque contemporaine
- Compte tenu des différentes périodes, on doit soulager les aspects d’actualité comme : l’apparition de parties politiques et la Cour Constitutionnel
- La perspective de Montesquieu
Montesquieu décrite cette théorie comme
- une théorie libéral ; qui est au service de la liberté
- elle signifie la modération entre les pouvoirs dans un état
Il explique que dans un état, les pouvoirs doivent être distingués pour permettre « un gouvernement modéré » c.à.d. un régime politique libéral.
Ce gouvernement est au service de la garantie de la liberté, de protéger la liberté d’individus. Toutes constitutions et tout juge constitutionnel se réfèrent à cette théorie.
Il marche sur l’idée centrale de « checks and balances » de pouvoirs. C’est-à-dire l’existence de procédures de contrôles et de contrepoids entre les pouvoirs. Donc, il ne parle pas d’une séparation trop stricte parce que, dans ce cas, elle peut aboutir à la paralysie des institutions.

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
4 exemples de dissertation sur le thème de la Démocratie et susceptibles de tomber aux concours de français philo en 2020. Nous vous proposons ici 4 sujets de dissertations sur le thème de la démocratie, au programme 2020 des épreuves de français-philo en prépa scientifique. Le sujet 3 est entièrement corrigé.
Contents show 1 Introduction : 2 I. Les origines de la démocratie 2.1 A. La démocratie athénienne : un modèle fondateur 2.2 B. Les influences antiques sur la pensée démocratique moderne 3 II. Les caractéristiques de la démocratie 3.1 A. Le principe de souveraineté populaire 3.2 B. La protection des droits et libertés individuels 3.3 […]
galliez florian dissertation sur la notion de démocratie de quoi lorsque parle de démocratie de ce terme remonte quelques siècles avant jésus christ notamment. ... Dissertation sur les origines de la Ve République; responsabilité politique du gouvernement sous la 4e république; TD8 Regime américain;
Le plan d'une dissertation dialectique suit le modèle suivant : I. Exposé argumenté d'une thèse. II. Exposé argumenté de la thèse adverse. II. Synthèse (dépassement de la contradiction) 2. Le plan de dissertation analytique. Le plan analytique permet d'analyser un problème qui mérite une réflexion approfondie.
1789). Pour Hannah Arendt d'ailleurs la démocratie contemporaine diffère de la démocratie antique parce qu'elle se définit d'abord comme une protection des individus. Cette protection s'est fortement renforcée après 1945 (CEDH, Cours constitutionnelles etc.) etau plan international , elle constitue l'un des critères
HGGSP 1 COMPRENDRE UN REGIME POLITIQUE LA DEMOCRATIE AXE 2 AVANCEES ET RECULS DE LA DEMOCRATIE. Introduction : Issue des idées des Lumières et de l'Enlightment anglais du XVIIIe s, le régime de démocratie moderne entre avec fracas sur la scène internationale avec la constitution américaine de 1787 et la Révolution Française.
La démocratie Sciences-Po 2013. Laurence Hansen-Love. « La démocratie est le pire des régimes − à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » (Democracy is the worst form of government − except of all those other forms who have been tried from time to time). Cette fameuse boutade de Churchill est d'autant plus ...
Sélection par la professeur-documentaliste d'ouvrages disponibles au CDI du lycée Alain : Benjamin Constant, Œuvres : texte présenté et annoté par Alfred Roulin, Paris, Gallimard, 1964. Claude Polin, De la démocratie en Amérique, Tocqueville : analyse critique, Paris, Hatier, 1985 (1973 ?). Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1987.
Dissertation de TD sur la représentation en démocratie la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. cette citation célèbre lincoln ... L'evolution du lien entre le droit de vote et la citoyenneté PFD; Dissertation constit; ... il s'agit encore de vérifier s'il en est de même sur le plan théorique.
elles le font toutes à des degrés différents, selon leur histoire ou leur culture. Au singulier, la démocratie est avant tout un idéal politique, mais ce modèle est appliqué différemment par différents États. Ainsi, la démocratie a fait et continue de faire l'objet de nombreux débats sur la meilleure façon de la mettre en œuvre.
les enfants de la démocratie. Ils en seront, aussi, un support essentiel. 2 - Les partis politiques : un support logistique de la démocratie Les partis politiques jouent un rôle fondamental pou la démocatie en ce u'ils constituent un support indispensable à l'expession de la volonté des citoyens. e sont, en effet, à eux que revient la
Aussi, la compensation des lacunes de la démocratie représentative par la démocratie participative nous pousse à nous interroger sur le devenir même de la démocratie. *** Bibliographie *** Les ouvrages : Lexique des termes juridiques, Dalloz, édition 2018; Les textes législatifs :
TD : Plan détaillé démocratie. Recherche parmi 298 000+ dissertations. Par pas_did • 2 Décembre 2015 • TD • 410 Mots (2 Pages) • 5 772 Vues. Page 1 sur 2. La démocratie du grec ( « Démos » pour le peuple et « Kratos » pour le pouvoir ); sous entendue le pouvoir du peuple. Ce principe se retrouve d'ailleurs dans une citation ...
Sujets d'entraînements sur le thème de la Démocratie. 13 octobre 2020. Si vous souhaitez vous entraîner, nous vous offrons une sélection de sujets blancs sur le thème de la Démocratie. Nous vous conseillons, comme pour les autres sujets d'entraînement, de bâtir un plan détaillé pour autant de sujets que vous pourrez parmi la ...
Thème 1 - L'humanité sur la Terre: hier et aujourd'hui. CHAP 1 - Me repérer dans le temps et dans l'espace; CHAP 2 - Les premiers humains sur la Terre; CHAP 3 - La répartition de la population mondiale; CHAP 4 - Les premières civilisations: premiers états et écritures; CHAP 5 - Habiter les métropoles d'aujourd'hui ...
Dissertation "La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité." Albert Camus. Le droit constitutionnel constitue l'ensemble des règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement, du pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs ayant comme objectif la création, l'exercice ...
1° - Un processus fragile. On a pu constater dans la deuxième moitié du XXe siècle des reculs des démocraties : plusieurs gouvernements ont été renversés par des coups d'état ; au Chili, en 1973, Allende a été renversé par le général Pinochet soutenu par les États-Unis. De nombreux dictateurs ont d'ailleurs été soutenus ...
Professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 1 -L'Etat de droit est la garantie de la démocratie et des droits de l'Homme. En première approche, on peut tenir que cette affirmation est une des évidences les mieux partagées du discours politique contemporain, pour lequel elle semble présenter au moins quater traits ...
Dissertation : Introduction de dissertation sur la Démocratie. Recherche parmi 298 000+ dissertations. Par emiratg • 27 Octobre 2017 • Dissertation • 385 Mots (2 Pages) • 7 271 Vues. « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » disait Abraham Lincoln, président des Etats-Unis de 1861 à 1865.
Ainsi nous verrons de quelle manière le parlementarisme offre une solution effective au maintien de la démocratie (I) mais que néanmoins, le parlementarisme est une illusion de la représentativité du peuple et donc une atteinte à la démocratie (II) Plan détaillé : I : Le parlementarisme : une solution pour la démocratie : A : une ...
L'état démocratique se caractérise par l'existence d'une pluralité d'organes et l'organisation en pouvoirs distincts. Donc, la théorie de la séparation de pouvoirs, en manière horizontale, représente la distinction entre 3 fonctions : Législative - qui fait les lois. exécutive - qui applique la loi de manière générale.
A- La critique et la remise en cause du système de démocratie représentative La France suit un modèle de démocratie représentative, comme l'établit l'article 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ».
Dissertation referendum dissertation référendum la démocratie besoin du référendum? le référendum du 29 mai 2005, le président de la république décide de ... Il s'agira dans cette étude de se concentrer sur la pertinence du référendum en démocratie. ... Plan detaille droit consitutitone disser; Case Law - EU law; TD N°3 en ...