Peut-on douter de tout ? Tweeter !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
- Corrigés de philosophie
- Corrigés de dissertations
- Peut-on douter de tout ?

INTRODUCTION
I-LA POSSIBILITE A LA FOIS MORALE ET RATIONNELLE DE DOUTER DE TOUT. A-SOCRATE ET LES VERTUS DU DOUTE (DEFINI COMME ATTITUDE CRITIQUE). B- LA POSSIBILITE RATIONNELLE DU DOUTE RADICAL IMPLIQUE QU'AUCUNE CONNAISSANCE HUMAINE N'EST FONDEE (CERTAINE).
1) Les connaissances immédiates/perceptives
2) Mais peut-on pour autant douter de toutes les autres connaissances humaines, telles que celles qui me sont transmises par des livres, donc, par la société à laquelle j'appartiens? Ne passent-elles pas pour les plus assurées?
CONCLUSION I :
II- DESCARTES ET LES LIMITES DU DOUTE A-Le doute hyperbolique cartésien. 1)Ne faut-il pas, pour parvenir à douter de tout, même de ce qui est le plus évident (comme les mathématiques et l'existence d'un monde extérieur) recourir à des artifices sans cesse plus monstrueux que les autres?
2) De plus, Descartes, quand il emploie le doute méthodique, échoue lui-même, sans le savoir vraiment, à douter de tout.
3) et finalement, on sait que Descartes en arrive à quelque chose de certain : le cogito. Le doute s'arrête bien quelque part…
B- La morale par provision (Discours de la méthode, III) : rapports doute-vie quotidienne.
III- LES LIMITES MORALES ET POLITIQUES DU DOUTE A- LE DOUTE ET LE CRIME DE LESE-MAJESTE. B-KANT : LE DOUTE COMME NECESSAIRE AU PROGRES DE L'HUMANITE.
1) Dans un petit essai intitulé Qu'est-ce que les lumières? (1784), Kant répond pour ainsi dire définitivement à cette grave objection.
2) Mais cette liberté est-elle si totale? N'y a-t-il pas de nouveau des limites dans ce droit absolu de douter même des choses "publiques"?
On peut considérer le doute comme inséparable, et même constitutif, de toute véritable entreprise philosophique. De Socrate à Descartes, en passant par les sceptiques, en effet, on retrouve ce doute.
Chez Socrate, le doute est synonyme de critique et de remise en cause de tout ce qui présente comme savoir (définitif).
Chez les sceptiques, le doute est une attitude de suspens : on dit que, étant donné la nature (précaire) de l'homme, on ne peut rien affirmer avec certitude, mais qu'on doit au contraire douter de tout.
Chez Descartes, on retrouve le même doute radical que chez les sceptiques, mais, avec un mélange du doute socratique : le doute radical sert à ne pas être dupe des opinions ou des faux savoirs; c'est une méthode qui sert à nous purger de nos illusions, et à atteindre la vérité, sans se précipiter.
Mais si le doute nous est présenté comme attitude philosophique par excellence, est-il quelque chose de si positif? La question même de savoir si on peut douter de tout semble entraîner un doute quant à la valeur même du doute. La question semble en effet présupposer qu'il est peut-être exagéré de douter de tout : peut-être une vie humaine n'est-elle pas possible si on se met réellement, dans la vie quotidienne, à douter de tout, car ce serait rester en suspens (cf. étymologie du mot) et donc à la limite se laisser mourir.
En tout cas, se demander si "on peut" douter de tout, c'est sous-entendre que douter de tout est quelque chose qui ne va pas de soi, qui pose problème : que, si ce n'est pas impossible, ce sera au moins difficile.
Il faut donc se demander s'il y a des limites au doute, et cela, au sens à la fois théorique, moral, et politique.
Ce qui reviendra à se demander jusqu'où va la liberté de penser (d'abord au sens théorique, ie, au sens où elle n'entraîne aucune conséquence pratique sur la vie des gens), et aussi, au sens pratique, ie, au sens où cette fois notre doute a des conséquences sur notre conduite et peut-être la société toute entière.
Bref le doute : attitude positive, ou négative? Est-il seulement une attitude théorique, n'ayant de conséquences que pour la cohérence de la pensée avec elle-même, ou bien est-ce une attitude qui a des conséquences pratiques? (selon réponse, on répond à première question différemment)
Bref : le problème posé par le sujet est double. D'abord, il pose le problème de savoir s'il existe des connaissances indubitables. Ensuite, il pose le problème de la liberté, à la fois intellectuelle et politique, de l'homme.
I-LA POSSIBILITE A LA FOIS MORALE ET RATIONNELLE DE DOUTER DE TOUT.
A-socrate et les vertus du doute (defini comme attitude critique)..
Pourquoi ne pourrait-on pas douter de tout? En effet, comme nous l'a montré Socrate, le doute est cette attitude critique vis-à-vis de tout ce qui passe pour certain, ou de ce qui se donne comme un savoir. Ne pas se remettre en question est l'attitude dogmatique que combat la philosophie. Le doute a plus de vertu que l'assurance des dogmatiques. (développer, à l'aide d'un texte)
Pour Socrate, douter de tout, ne rien prendre comme allant de soi, pour acquis, est un devoir pour l'homme.
Il va donc de soi que l'homme peut douter de tout, à la fois au sens de la capacité (l'homme ne serait pas ainsi fait qu'il lui serait impossible de remplir ce qui par définition fait qu'il deviendrait vraiment un homme) mais aussi au sens de droit à (si c'est un devoir moral, alors, ce n'est pas immoral et donc aucun droit ne saurait aller contre).
Le doute, c'est ce qui permet le progrès de l'humanité, à la fois au sens moral mais aussi au sens historique, scientifique, etc. Car douter ce n'est rien d'autre que faire preuve d'esprit critique.
B-LA POSSIBILITE RATIONNELLE DU DOUTE RADICAL IMPLIQUE QU'AUCUNE CONNAISSANCE HUMAINE N'EST FONDEE (CERTAINE).
Mais si douter c'est faire preuve d'esprit critique, et se caractérise comme une attitude anti-dogmatique, peut-on pour autant douter de tout, à l'infini? N'y a-t-il rien d'assuré en ce monde, n'y a-t-il pas pourtant des connaissances dont il paraît être humainement ou rationnellement impossible de douter? Bref : n'y a-t-il aucune connaissance indubitable?
Peut-on douter des connaissances qui passent pour être les plus assurées?
1) Les connaissances immédiates/perceptives
Pour le savoir, partons de la connaissance la plus immédiate (la perception), donc, la moins complexe, et qui bénéficie au premier abord d'une telle évidence, qu'il paraît absurde de la remettre en cause. Par exemple : je suis assis à ma table, en train d'écrire ces lignes sur mon ordinateur, etc. Peut-on douter de cette connaissance perceptive? Ie, existe-t-il de (bonnes) raisons pour dire que peut-être il n'est pas vrai que je suis en ce moment assis à ma table, en train d'écrire ces lignes? Que peut-être il n'y a même pas de table, ie, de monde extérieur? Ici, peut-on aller jusqu'à dire qu'il faut faire preuve d'esprit critique et ne pas se précipiter, ie, ne pas considérer mon inclination immédiate (qui me pousse à croire que cette perception est certaine) comme certaine, comme indubitable? Ie : le doute ne rencontre-t-il pas ici ses limites, et ne deviendrait-il pas négatif, pour ne pas dire incongru? (C'est bien ce que veut dire Woody Allen à travers cette formule ironique : "si le monde extérieur n'existe pas, alors, j'ai payé ma moquette beaucoup trop chère").
On peut pourtant répondre qu'ici, le doute est de rigueur : non seulement, il est possible, mais on peut encore parler d'un devoir à le faire. En effet, si je réfléchis bien sur cette connaissance immédiate, je me rends compte que je ne peux, dans le domaine des sensations, être certain d'être dans le vrai. Par exemple, peut-être y a-t-il un savant fou qui est en train de simuler mes organes récepteurs et m'envoie la perception : "en ce moment je suis (je sens que…) à ma table en train d'écrire des mots sur mon ordinateur". Or, comment puis-je le savoir? Comment puis-je vérifier que ce n'est pas le cas? Je ne peux en effet par définition sortir de moi-même, de mes organes récepteurs, qui sont la seule chose dont je dispose pour avoir affaire au monde extérieur, afin de vérifier si ma perception correspond au monde extérieur, et s'il y a même un monde extérieur -comme l'a bien montré Berkeley, je ne peux avoir accès à quelque chose non perçu; or, si tout ce que je peux connaître, n'est connaissable qu'à travers mes facultés de connaître, je peux toujours douter du fait que mes perceptions correspondent bien au monde tel qu'il est vraiment, et même, qu'un monde extérieur existe.
Dans ce domaine de la connaissance immédiate, le doute est donc rationnel, possible, puisque nous ne pouvons jamais être certain d'être dans le vrai. Puisque je ne peux donner de bonnes raisons pour établir que nous avons une réelle connaissance, alors, non seulement, je peux en douter, mais aussi, je dois en douter (puisqu'elle peut être fausse).
2) Mais peut-on pour autant douter de toutes les autres connaissances humaines, telles que celles qui me sont transmises par des livres, donc, par la société à laquelle j'appartiens? Ne passent-elles pas pour les plus assurées?
Ces connaissances sont diverses : on a l'histoire, la religion, la science, etc. On nous les enseigne comme étant certaines, ou, du moins, on ne nous apprend pas à en douter. Comme le dit Wittgenstein, dans De la certitude , §310 à 312, si l'élève se mettait à interrompre sans cesse le maître en exprimant des doutes, par exemple quant à l'histoire (genre : comment savez-vous que Louis XIV a réellement existé?), alors, il se mettrait en position de non-apprentissage. "Un tel doute, dit Wittgenstein, est comme creux". Ie : il n'a aucun sens.
Pourtant, ne peut-on penser que cet élève n'a pas si tort que cela? N'est-il pas possible de douter même de ce genre de connaissances? L'histoire ne repose-t-elle pas après tout, tout autant que l'enseignement de la Bible, sur le témoignage des autres? N'est-elle pas dès lors de l'ordre de la croyance? Peut-être après tout nous a-t-on menti! Cf. journalistes qui peuvent nous faire croire n'importe quoi.
En fait, comme l'a bien montré Hume, dans l' Enquête sur l'entendement humain (Section IV, 1), toute connaissance en tant que telle, ie, toute connaissance à caractère informatif, qui porte sur le monde, est révocable, est incertaine. En effet, contrairement aux vérités mathématiques, la plupart des connaissances humaines portent sur le monde, sur des "choses de fait" ("matters of fact"). On ne peut douter des vérités mathématiques, car elles portent seulement sur des "relations d'idées" (relations of ideas). Par exemple : même s'il n'existait aucun triangle dans la nature, le théorème de Pythagore serait toujours vrai. Il s'agit de vérités éternelles, qui ne changent jamais et qui ne sont donc pas révisables. On ne peut sans contradiction envisager leur remise en cause, puisque l'on ne peut prouver sans contradiction leur fausseté possible. Par contre, toutes les autres connaissances portent sur le monde, et peuvent toujours changer; on peut toujours, dit Hume, démontrer le contraire. Il est donc possible, rationnellement, de douter de la majeure partie de nos connaissances, parce qu'on ne peut jamais en être certain.
Ce qu'elles nous affirment peut toujours se révéler être faux demain, etc
Ceci vaut bien évidemment même des connaissances "scientifiques", qui passent, dans le sens commun, pour être les mieux établies, et indubitables. Or, portant par définition sur le monde, celles-ci ne peuvent mériter l'appellation de "vérités éternelles".
Les vérités scientifiques sont des vériéts empiriques, portant sur des "choses de fait", donc, elles peuvent ne pas être vraies, elles peuvent même devenir fausses (cf; fait que la théorie de Galilée a été remplacée par celle de Newton, celle de Newton par celle d'Einstein, et que la théorie d'Einstein est loin d'être définitivement établie) : par conséquent, nous sommes bien en présence d'un domaine logiquement incertain. Nous pouvons donc en douter, il n'y a là rien de logiquement impossible, d'incohérent. Comme nous l'a bien montré Popper dans Conjectures et réfutations , c'est que tout ce que nous pouvons assurer, c'est qu'une théorie scientifique n'est pas encore fausse…
Nous pouvons même aller plus loin et dire qu'il est de notre devoir de douter des "vérités" scientifiques. En effet, toujours selon Popper, la science doit procéder par conjectures et réfutations successives, si elle veut pouvoir progresser. Et plus elle va mettre à l'épreuve de l'expérience ses théories, plus elle va pouvoir être sûre de cette théorie. En effet, plus on aura fait d'expériences susceptibles de la réfuter, plus elle sera confirmée par les faits. Si nous avons dit ci-dessus qu'il était logiquement possible de douter des théories scientifiques, nous affirmons maintenant qu'il faut les soumettre au doute, à l'esprit critique. Une science qui ne le ferait pas serait une pseudo-science, ou un dogme, mais certainement pas une vraie science. Ainsi peut-on reprocher à la psychanalyse de tout faire pour que son hypothèse de l'inconscient soit infalsifiable, hors d'atteinte, ie, indubitable.
Rien n'est sûr, ou définitivement tenu pour acquis : croire le contraire, donc, ne pas douter, c'est aller droit vers les dogmes et vers une attitude que Nietzsche a stigmatisée comme étant celle du "troupeau". On croira tout ce qu'on nous dit, sans en examiner le bien-fondé, sans même le comprendre… (cf. les médias; les sectes; les pseudo-sciences; croire que la terre tourne sans comprendre la théorie héliocentrique). Douter de tout, c'est interroger le bien fondé de tout, et par là, refaire nous-mêmes le cheminement de tout ce qui se présente comme savoir. Comme le dit Kant, dans Qu'est-ce que que les lumières? , c'est là penser par soi-même, et devenir un homme libre.
Mais, si rien n'est certain, n'est-il pas exagéré d'en conclure que dès lors, on peut douter de tout, au sens où cette fois on rejetterait tout ce qui est douteux comme si c'était faux? Douter de tout en ce sens, ne serait-ce pas le propre du fou? Plus encore, ne serait-ce même pas prétentieux de croire qu'il est possible de douter de tout?
II-DESCARTES ET LES LIMITES DU DOUTE.
Descartes ne nous a-t-il pas enseigné les limites de ce doute radical? N'y a-t-il pas des limites au doute?
A-Le doute hyperbolique cartésien.
Comme Socrate, Descartes adopte, au début de ses Méditations métaphysiques , la méthode du doute. Ce que recherche Descartes, c'est la vérité. Or, il se dit que pour cela, il vaut mieux abandonner toutes les croyances qu'il a eues jusqu'alors; en effet, celles-ci ne sont autres que ce que Spinoza appellera les "connaissances par ouï-dire" ( Ethique , Livre II).
Pourtant, on peut dire que ce que Descartes nous montre, tantôt implicitement (ie : sans le vouloi), tantôt explicitement (avec le cogito), c'est que le doute radical a bien des limites. Nous sommes incapables de douter de tout.
1) Ne faut-il pas, pour parvenir à douter de tout, même de ce qui est le plus évident (comme les mathématiques et l'existence d'un monde extérieur) recourir à des artifices sans cesse plus monstrueux que les autres?
Cf. le malin génie : il est obligé d'en arriver là afin de pouvoir douter même du probable; mais c'est évidemment artificiel (je vais "feindre", nous dit Descartes, qu'il existe quelque chose de tel, car je vois bien que même si j'ai trouvé de bonnes raisons pour douter, ie, que c'est logique, cela ne me fait pas réellement douter de mes croyances spontanées).
On pourrait donc dire que le fait même que le doute cartésien soit hyperbolique, nous montre qu'on ne peut douter de tout
2) De plus, Descartes, quand il emploie le doute méthodique, échoue lui-même, sans le savoir vraiment, à douter de tout.
Cf. fait que Descartes ne doute pas vraiment de sa raison (cf. argument de la folie); de certaines notions issues de la tradition soi-disant criticable; du langage hérité de la société dans laquelle il est né; ne doute pas des mots; de la tradition philosophique; du doute lui-même; de son projet ; de soi-même finalement…
Il revient à Wittgenstein, dans De la certitude , de bien montrer pourquoi il est impossible de douter de toutes nos connaissances. Reprenons les § 310 à 312 dont nous avons parlé dans notre première partie. Si pour Wittgenstein le doute de l'élève à qui on apprend quelque chose d'historique, concernant la foi même en l'histoire, est " comme creux ", c'est parce que " il y a tant de choses qui vont de pair avec cette croyance! ". Ce que veut dire Wittgenstein, c'est que notre connaissance a un caractère holistique (ie : elle est systématique, quelque chose de complexe); toutes nos connaissances s'imbriquent les unes dans les autres, et on ne peut les envisager à part. Si bien que quand on doute d'une de ces connaissances, on peut très bien ne pas douter de quelque chose d'autre qu'elles impliquent pourtant nécessairement, et cela, inconsciemment. Il y a donc toujours des présupposés cachés, inconscients, derrière tout énoncé dont on va vouloir douter. Comme il le dit dans les § 143 et 152, dans notre savoir, beaucoup de choses sont apprises implicitement (§143 : " on me raconte par exemple que quelqu'un a fait il y a longtemps l'escalade de cette montagne. Vais-je toujours enquêter sur le degré de confiance à accorder à celui qui me le raconte, ou pour savoir si cette montagne a existé il y a longtemps? Un enfant apprend qu'il y a des gens dignes ou non dignes de foi longtemps après avoir appris les faits qui lui sont racontés. Mais que cette montagne existe depuis longtemps déjà, il ne l'apprend pas du tou; ie, cette question ne se pose pas du tout. L'enfant, pour ainsi dire, avale cette conséquence avec ce qu'il apprend "; §152 : " les propositions qui pour moi sont solidement fixées, je ne les apprend pas explicitement "). Ainsi, on ne peut douter de certaines choses sans mettre par là en doute tout notre système d'évidence, toute notre conception du monde (ainsi : que la terre tourne, que le monde extérieur existe, que les mots ont un sens, que 2 + 2 = 4, etc)
Cela peut valoir aussi des sciences, qui ont bien un tel caractère holiste. Quand on veut mettre en doute une hypothèse, sait-on, peut-on savoir que le résultat de notre mise en doute, s'il nous a révélé une erreur, porte vraiment sur ce sur quoi on voulait faire porter notre doute? En effet, la science est un ensemble d'hypothèses enchevêtrées les unes dans les autres. Par exemple : pour douter d'une hypothèse, ne vais-je pas me servir d'une autre hypothèse qui appartient à la dite théorie (on parle alors d'hypothèse "auxilliaire"), à savoir, de certains instruments qui ne sont rien d'autre que l'application de la théorie, ou qui dépendent de son bien-fondé? Or, si je me mets à douter des instruments eux-mêmes, ne vais-je pas m'empêcher de pouvoir soumettre cette hypothèse à l'examen?
3) et finalement, on sait que Descartes en arrive à quelque chose de certain : le cogito. Le doute s'arrête bien quelque part…
Conclusion a.
On n'a pas les capacités de douter de tout, car c'est quelque chose qui irait à l'infini. Pour douter, il faut que je pense, et pour que je pense, il faut bien que je m'exprime par des mots; or, ces mots sont hérités de ma société, etc.
B- La morale par provision ( Discours de la méthode , III) : rapports doute-vie quotidienne.
Descartes lui-même nous conseille de ne pas adopter la pratique du doute dans la vie quotidienne : en théorie, le doute est conseillé car il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas confondre sa croyance avec un vrai savoir, etc. Mais en pratique, ie, quand il s'agit de vivre, d'agir, il ne faut pas douter.
Il faut donc dans la vie courante s'abstenir de douter. Du moins, si on peut toujours douter, il ne faut pas remettre l'action à demain. Je dois manger, etc. Descartes va même jusqu'à prôner le conformisme en matière d'opinions politiques, morales, ou religieuses : là-dessus, on adoptera celles de notre pays.
(note : les sceptiques, contrairement à ce qu'on a pu dire d'eux, faisaient exactement la même chose que Descartes)
CONCLUSION I
Pour Descartes, autant dans le domaine de la théorie que dans le domaine de la pratique, nous ne pouvons douter de tout. Le doute est impossible à maintenir jusqu'au bout dans la théorie, même quand on a le temps et qu'il s'agit seulement de rechercher la vérité. Mais dans le domaine de la pratique, c'est encore plus impossible, car nous devons agir, et la vie est urgente. Le doute radical nous ferait ici tomber dans les affres de la folie.
Ou : même si, comme on l'a vue en I, pratiquement toutes mes connaissances sont incertaines, ne sont pas indubitables, il est impossible d'en douter au sens de les "révoquer en doute", ie, de faire comme si elles étaient fausses. Sinon, c'est notre vie même qui devient impossible.
I II- LES LIMITES MORALES ET POLITIQUES DU DOUTE.
Nous venons de voir que autant dans le domaine théorique que pratique, nous ne pouvons douter de tout : c'est impossible, l'homme n'en a pas la capacité. On en arrive donc maintenant à se demander si le doute ne serait pas dangeureux quand il porte sur les valeurs traditionnellement admises par sa société. Peut-on remettre en cause le bien-fondé des lois, des mœurs, ou des dogmes religieux, sans remettre en danger l'existence de cette société? La question ne porte plus vraiment, ici, sur la capacité qu'aurait l'homme à douter de tout; nous sommes ici à un niveau moral et même politique : il s'agit de savoir si l'homme a le droit de douter de tout.
A-LE DOUTE ET LE CRIME DE LESE-MAJESTE.
Cf.Socrate qui a été mis à mort car il était trop dangeureux pour l'ordre social. Ici, on répond à la question de savoir si on peut douter de tout, par le risque de mort (comme précédemment); seulement, cette mort n'a plus une origine biologique, ou naturelle, mais sociale/politique.
Cf. le crime de lèse-majesté; signification : il y aurait des choses sacrées, qu'aucun homme, en tant qu'individu, ne saurait remettre en question. Ces choses sont principalement les dogmes religieux, les lois de l'Etat. Les critiquer, c'est en effet entraîner un gros risque : que les hommes n'y croient plus; car alors, le lien social est détruit. Il est interdit à l'homme d'en douter car ce serait les remettre en cause, soupçonner leur bien-fondé, etc. (Ici, donc, réponse au sujet : on n'a pas le doit de douter de tout : certains domaines nous échappent, on n'a pas le droit d'y toucher)
B-KANT : LE DOUTE COMME NECESSAIRE AU PROGRES DE L'HUMANITE.
1) dans un petit essai intitulé qu'est-ce que les lumières (1784), kant répond pour ainsi dire définitivement à cette grave objection..
Répondre à cette objection, c'est bien entendu, comme on le voit dans cet essai, répondre aux prêtres et hommes politiques de l'époque obscurantiste, ie, à ceux qui ont le pouvoir et veulent maintenir le peuple dans l'ignorance afin de garder ce pouvoir. Selon eux, on vient de le voir, laisser l'homme penser par soi-même et cela, sur la place publique, (dans des livres, dans des jouranux), et à propos des choses publiques (eux diraient sacrées), entraînerait la ruine de l'ordre politique extérieur, et de la moralité intérieure.
Ainsi, à l'époque de Kant, ceux qui voulaient publier des livres dont le contenu n'était pas en accord avec la manière dont la religion était officiellement comprise et imposée, courraient le risque de la censure. Cf. Descartes qui s'est réfugié, comme d'ailleurs bon nombre d'intellectuels de cette époque, à La Haye, pour échapper à cette censure quasi-systématique. (Cf. aussi Diderot et L'Encyclopédie).
Or, que leur répond Kant? Il oppose à l'obscurantisme l'idée-clef de "lumières", qui connote l'idée de critique, de liberté absolue du jugement, par lequel nous nous délivrons de nos préjugés, superstitions, préjugés.
Par là, Kant veut dire que la liberté d'opinion et d'expression est ce qui permet à un peuple de progresser vers le bien. Ie : il doit y avoir une libre critique de l'Eglise comme de la législation. Kant va même jusqu'à dire que de toutes les libertés que les hommes ont à conquérir et que le gouvernement doit leur laisser prendre, la première est la liberté de l'usage public de sa raison. Contre les obsucrantistes, il dit donc que la religion et le droit concernent tout homme en tant qu'homme, et que rien ne saurait lui interdire, par conséquent, d'en douter, et de communiquer ce doute à tout autre homme.
2) Mais cette liberté est-elle si totale? N'y a-t-il pas de nouveau des limites dans ce droit absolu de douter même des choses "publiques"?
C'est bien ce que semble après tout soutenir Kant. En effet, de quelle liberté nous parle Kant? Cette liberté concerne, comme nous l'avons dit, l"usage public de sa raison". Pour bien comprendre la signification de cette formule, voyons ce qu'est, pour Kant, l'usage privé de la raison, celui qui est néfaste et en conséquence interdit, illégal.
L'usage privé de la raison, c'est par exemple l'usage que ferait un fonctionnaire de cette liberté radicale de tout soumettre à l'examen (critique) de sa raison. Il ne saurait s'étendre, nous dit Kant, au-delà de l'exécution, et par exemple, aller jusqu'à discuter de l'ordre ou de la tâche à accomplir. Ici, nous sommes bien en présence des limites (morales et/ou politiques) du doute : en effet, si on le limite, c'est justement pour que la société continue à fonctionner, même si on doute du bien-fondé des lois ou ordres à appliquer. Le doute, ici, a des conséquences pratiques très graves, qui peuvent troubler, l'ordre public.
Qu'est-ce alors que l'usage public de la raison? Kant veut dire par là que cet homme qui, en tant que fonctionnaire de l'Etat ne peut douter de l'ordre qu'on lui donne et faire comme s'il était faux, donc nul et non avenu, tant qu'il en doute. Par contre, il peut, et même il en a le devoir, mettre en cause la stratégie du général, mais cette fois, en adoptant le point de vue d'un citoyen, ou d'un homme raisonnable (bref : de tout "homme en tant qu'homme"). Car par là, il se met dans la position d'un homme véritablement capable de juger et de savoir.
On ne doutera donc pas des affaires publiques en tant qu'homme privé, mais en tant qu'homme public : ainsi, notre fonctionnaire ne le fera pas quand le général lui donnera un ordre, mais il le fera dans un article de journal.
Ainsi, pour Kant, si la constitution de l'Etat reste inviolable, il n'en conclut pas vraiment au crime de lèse-majesté quand on la remet en question : au contraire, son caractère sacré n'exclut pas que nous ayions le droit et même le devoir (cf. affaire Papon) de la critiquer quand quelque chose ne va pas ou se révèle être injuste. Que les hommes aient le droit de raisonner sur tout et d'exprimer publiquement leurs pensées, non seulement ne ruine pas l'Etat et l'Eglise, mais c'est le seul moyen d'assurer un ordre politique qui repose sur la liberté fondamentale de l'homme, et ne soit pa à la merci de la moindre épreuve de force.
D'un point de vue théorique, ou plus précisément épistémologique, il nous est apparu impossible de douter de tout. L'homme n'en a pas les capacités, car il lui faut toujours partir de quelque part, et/ ou, s'arrêter quelque part. Il y a toujours des choses qui, dans l'entreprise du doute, restent indubitables, ou du moins, qu'on continue de prendre comme allant de soi.
De même, du point de vue de la vie quotidienne, nous en sommes arrivés à la conclusion selon laquelle on ne peut douter de tout, sous peine de mort ou de folie. Ici, l'incapacité est plus totale encore que ci-dessus, car les risques étaient seulement alors logiques.
Mais, en nous interrogeant sur la légitimité du doute dans le domaine politique, nous avons réussi à retrouver la connotation positive du doute, de la critique, telle qu'on la trouvait chez les philosophes depuis Socrate. En effet, nous avons conclu, avec Kant, que le doute sur les choses dites sacrées n'est pas illégal mais au contraire une sorte de devoir. Seul il peut permettre à l'humanité un progrès véritable, et à la liberté d'être effective.
Bref : notre conclusion est que le doute signifie bien la liberté de l'homme, peut-être pas intellectuelle, certes, mais au moins politique et morale. Son exercice constant peut permettre l'émancipation de l'homme et empêcher qu'il soit sous le joug d'un Etat totalitaire.
Copyright © Philocours.com 2021

Ce blog est consacré à la philosophie et à la littérature dans la mesure où elle a une dimension philosophique. Il est destiné à mes élèves de terminales et de classes préparatoires. Copier ne sert à rien et se remarque facilement.
mardi 3 décembre 2019
Corrigé d'une dissertation : le doute est-il une force ou une faiblesse , aucun commentaire:, enregistrer un commentaire.
Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Douter, est-ce désespérer de la vérité ?

I. L’essence du doute : entre recherche de vérité et scepticisme
Le doute est une attitude intellectuelle qui consiste à suspendre son jugement, à ne pas accepter comme vrai ce qui n’est pas suffisamment démontré. Il est donc une forme de scepticisme, une remise en question de ce que l’on tient pour acquis. Le philosophe grec Pyrrhon d’Élis est l’un des premiers à avoir théorisé le doute systématique comme une méthode de recherche de la vérité. Pour lui, le doute est une suspension du jugement qui permet d’éviter l’erreur.
Cependant, le doute n’est pas seulement une attitude sceptique. Il est aussi une démarche active de recherche de la vérité. En effet, douter, c’est remettre en question les évidences, c’est chercher à vérifier ce que l’on croit savoir. C’est dans ce sens que René Descartes , dans ses « Méditations métaphysiques », fait du doute la première étape de sa méthode pour atteindre la vérité. Pour lui, le doute est une « déconstruction » nécessaire pour reconstruire sur des bases solides.
Néanmoins, le doute peut aussi être perçu comme une menace pour la vérité. En effet, si l’on doute de tout, on peut finir par douter de la possibilité même de connaître la vérité. C’est le risque du scepticisme radical, qui conduit à une forme de relativisme où toutes les opinions se valent. C’est ce que dénonce Platon dans « La République », où il critique les sophistes qui, en faisant du doute une fin en soi, désespèrent de la vérité.
II. Le doute comme moteur de la quête de vérité
Le doute, loin d’être un obstacle à la vérité, peut être un puissant moteur de sa recherche. En effet, c’est en doutant de ce que l’on croit savoir que l’on peut progresser vers une connaissance plus profonde et plus précise. C’est ce que montre Socrate dans les dialogues de Platon , où il utilise la maïeutique, une méthode de questionnement qui vise à faire accoucher l’interlocuteur de sa vérité en le poussant à douter de ses préjugés.
De plus, le doute est une attitude de vigilance intellectuelle qui permet de se prémunir contre l’erreur. En effet, en refusant d’accepter comme vrai ce qui n’est pas suffisamment démontré, on évite de se laisser tromper par des apparences trompeuses. C’est ce que souligne Descartes dans le « Discours de la méthode », où il fait du doute une « règle de prudence » pour éviter l’erreur.
Enfin, le doute est une forme d’humilité intellectuelle qui permet de reconnaître les limites de notre connaissance. En effet, en doutant, on admet que l’on ne sait pas tout, que l’on peut se tromper. C’est ce que montre Montaigne dans les « Essais », où il fait de la conscience de notre ignorance la première étape de la sagesse.
III. Désespérer de la vérité : le risque du doute excessif
Cependant, le doute peut aussi conduire à désespérer de la vérité. En effet, si l’on doute de tout, on peut finir par douter de la possibilité même de connaître la vérité. C’est le risque du scepticisme radical, qui conduit à une forme de relativisme où toutes les opinions se valent.
Ce risque est bien illustré par le mythe de la caverne de Platon . Les prisonniers de la caverne, qui ne voient que des ombres projetées sur le mur, peuvent douter de l’existence du monde extérieur et désespérer de jamais connaître la vérité. C’est le danger du doute excessif, qui conduit à l’immobilisme intellectuel et à la résignation.
De plus, le doute peut aussi conduire à une forme de nihilisme, où l’on nie l’existence de toute vérité. C’est ce que dénonce Nietzsche dans « Ainsi parlait Zarathoustra », où il critique le « dernier homme » qui, en doutant de tout, finit par nier la valeur de la vie.
IV. Le doute constructif : un espoir pour la vérité
Néanmoins, le doute n’est pas nécessairement un désespoir de la vérité. Au contraire, il peut être un espoir pour la vérité, à condition d’être utilisé de manière constructive. C’est ce que montre Descartes dans ses « Méditations métaphysiques », où il fait du doute la première étape de sa méthode pour atteindre la vérité.
En effet, le doute constructif est un doute méthodique, qui ne remet pas en question la possibilité de connaître la vérité, mais seulement la validité de nos connaissances actuelles. Il est une invitation à la recherche, à l’expérimentation, à la vérification. C’est ce que souligne Popper dans « La logique de la découverte scientifique », où il fait du doute la base de la méthode scientifique.
De plus, le doute constructif est un doute critique, qui permet de distinguer le vrai du faux, le certain de l’incertain. Il est une forme de discernement, qui permet de trier les informations, de les évaluer, de les hiérarchiser. C’est ce que montre Kant dans la « Critique de la raison pure », où il fait du doute l’outil de la critique de la connaissance.
Enfin, le doute constructif est un doute créatif, qui stimule l’imagination, qui ouvre de nouvelles perspectives, qui permet de voir les choses sous un angle différent. C’est ce que montre Bergson dans « L’évolution créatrice », où il fait du doute la source de l’innovation et de la créativité.
En conclusion, loin d’être un désespoir de la vérité, le doute peut être un espoir pour la vérité, à condition d’être utilisé de manière constructive. C’est en doutant que l’on peut progresser vers une connaissance plus profonde et plus précise, que l’on peut éviter l’erreur, que l’on peut reconnaître les limites de notre connaissance. C’est en doutant que l’on peut rester vigilant, critique, créatif. C’est en doutant que l’on peut rester en quête de vérité.
Autres dissertations à découvrir :
- Dissertations
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
La recherche de la vérité peut-elle se passer de doute ?
Problématisation/ Introduction.
On ressent un doute quand on n’est sûr de rien, quand on ne peut pas produire un jugement définitif, dire « c’est vrai » ou « c’est faux ». Etre dans le doute signifie soit suspendre totalement son jugement, soit affirmer quelque chose tout en étant conscient de la possibilité de se tromper. Le jugement est alors provisoire. Posséder une vérité, à l’inverse, exclut le doute. Mais, comme l’indique le sujet, rechercher la vérité n’est pas encore la posséder. Et, bien souvent, pour obtenir la vérité, il faut commencer par mettre en doute ce que l’on croyait savoir car nos préjugés, nos opinions, nos idées reçues renferment souvent des jugements sans fondement ou faux. Autrement dit, le doute serait le moteur de la recherche de la vérité : c’est parce que je doute que je suis en quête de la vérité.
Mais, dans le même temps, la recherche de la vérité exige la possession de certitudes comme sur des marches qui nous permettent d’atteindre la connaissance. En effet, pour progresser dans cette recherche, nous avons besoin de nous appuyer sur des certitudes. On ne peut donc pas toujours douter ou douter de tout si nous voulons progresser dans la voie de la science et du savoir.
Première partie. Douter est la première étape de la connaissance.
Celui qui ne doute pas ne risque pas de progresser vers la connaissance et la vérité. En effet, si je ne doute pas, je ne risque pas de me rendre compte de mon ignorance. Le doute permet de prendre conscience de mon ignorance. Avec le doute, je sais au moins que je ne sais pas. Ou que ce que je crois savoir n’est pas bien assuré, ni prouvé ; donc que cela peut être faux. En ce sens, le doute m’offre une première vérité, certes pauvre en connaissance, mais fondamentale pour me mettre en route vers la vérité. Le doute est donc le moteur de la recherche de la connaissance et de la vérité. Il me révèle que ce que je pense est un préjugé, c’est-à-dire une opinion toute faite qui s’est imposée à moi sans que je l’aie moi-même fondée ni analysée.
Deuxième partie. La recherche de la vérité exige de posséder des certitudes.
Si le doute est inséparable d’une recherche de vérité, celle-ci peut et doit savoir aussi se passer du doute. En effet, si j’entreprends par exemple une démonstration mathématique, je suis bien obligé de faire reposer mon argumentation sur des premiers principes que j’accepte sans les démontrer et sans douter de leur vérité. En ce sens, la recherche de la vérité peut se passer du doute, au moins à certaines étapes de son déroulement. Si, au moment où j’utilise le théorème de Pythagore pour déterminer la superficie d’un triangle, il me fallait revenir en arrière pour m’assurer de la vérité de ce théorème, je n’avancerais jamais dans la résolution de mon problème ! La recherche de la vérité correspondrait à une régression sans fin et l’on reculerait au lieu d’avancer. On le voit bien : savoir douter, c’est aussi savoir quand ne pas ou ne plus douter pour progresser vers la vérité.
Troisième partie. La certitude n’est jamais absolue, il faut toujours envisager que l’on se trompe.
Pour autant, les remarques précédentes n’autorisent pas à affirmer qu’ils existent des vérités absolues échappant à toute forme de doute. En effet, une théorie physique est vraie par exemple tant qu’il n’existe pas une preuve (un événement naturel ou une expérience de laboratoire) venant contredire les prédictions que l’on peut établir à partir d’elle. Autrement dit, une théorie est vraie jusqu’à ce que l’on ait démontré…qu’elle est fausse. Ce qui implique que l’on conserve l’idée qu’elle puisse être fausse même si aucun fait, aucune preuve n’a, pour l’instant, établi la possibilité de sa fausseté. Considérer que la vérité est, en quelque sorte, provisoire, reste le meilleur moyen de faire avancer sa recherche en général. Le doute a donc une fonction de découverte.
Conclusion.
La recherche de la vérité ne peut donc pas se passer du doute. Il est moteur pour cette recherche au double sens du terme : il la déclenche, puis il entretient son mouvement. Même si, parfois, la recherche de la vérité doit se passer du doute, faire comme s ’il n’y avait pas lieu de douter, si elle veut progresser.
LES NOTIONS :
- La vérité
- La démonstration
- L'interprétation
- Théorie et expérience
- Dénicher le bon plan
- Un kit pour affronter la dissert'
- Problématique: à la conquête du sens
- Le conseil des correcteurs
LES RÉFÉRENCES:
- Descartes
Expresso : les parcours interactifs

Hobbes et la violence
Sur le même sujet.
La quête de la vérité est le but même de la philosophie. Le Vrai constitue pour Platon, avec le Beau et le Bien, une valeur absolue. Mais qu’est-ce que la vérité et comment y accéder puisqu’on ne peut la confondre avec la réalité ? On…
La démonstration
La démonstration est un raisonnement qui permet d’établir une vérité. Systématiquement utilisée en mathématiques, elle procède par enchaînement logique en respectant des règles rigoureuses, sans quoi elle n’est pas valide. Elle…
Denis Kambouchner : “Les complotistes sont tout sauf cartésiens”
Douter radicalement de la réalité du monde pour établir de nouvelles certitudes : la méthode déployée par Descartes dans ses Méditations…

Y a-t-il d'autres moyens que la démonstration pour établir une vérité ?
Il y a de nombreux moyens pour découvrir une vérité : en prendre connaissance tout en faisant confiance aux sources de transmission, avoir une intuition intellectuelle, une expérience indubitable, voire une révélation esthétique ou…
Théorie et expérience
On peut définir la théorie comme le produit d’une activité de l’esprit, d’une spéculation abstraite et désintéressée. La théorie s’oppose alors à la pratique. Une théorie scientifique est un système de lois, fondé sur des hypothèses,…
Raphaël Enthoven : Proust et Descartes
Descartes comme une étape dans le chemin de pensée qui va du vain désir de vérité à l’exaltante connaissance du singulier, but ultime de la Recherche.
Faut-il préférer le bonheur à la vérité ?
Analyse des termes du sujet « Faut-il » Synonymes : est-ce un devoir, une obligation, une contrainte, une nécessité ? « préférer » Synonymes : choisir (choix exclusif ou inclusif), privilégier, favoriser… « bonheur » Termes…
Le temps des incrédules
Des déclarations de Donald Trump aux messages complotistes relayés sur les réseaux sociaux, tout se passe comme si un usage déréglé du doute s’était mis en place, qui ruine la possibilité de se référer à une vérité commune. Et la…

Peut-on douter de tout ? Corrigé dissertation

Présentation du document :
Exemple de corrigé d'une dissertation de philosophie sur les thème du doute, du savoir et de la vérité. Corrigé à télécharger, proposé par un professeur de philosophie et entièrement rédigé.
Description du document :
Extraits de la dissertation :, auteur : faustine f. (1 note).
Faustine est diplômée de la Sorbonne et possède un master 2 en philosophie. Elle possède également une maîtrise de Lettres modernes. Très pédagogue, elle propose également des cours particuliers et stages en Français et philosophie.
Sommaire du document :
I) il est possible et légitime de douter de tout, car le doute est libérateur, ii) mais il est impossible de renoncer complètement à connaître : il existe des limites au doute, iii. à quelles conditions douter de tout peut-il être légitime , liste des avis.
Aucun avis client pour le moment
Derniers documents dans la catégorie

N’exprime-t-on que ce dont on a conscience ? Corrigé dissertation
Corrigé d'une dissertation de philosophie de plus de 5 pages sur le thème de l'Inconscient et de l'expression. Corrigé entièrement rédigé avec un plan en ...

Faut-il se méfier de ceux qui pensent détenir la vérité ? Corrigé dissertation
Dissertation de philosophie entièrement rédigée dont le sujet est Faut-il se méfier de ceux qui pensent détenir la vérité ? Corrigé avec un plan en 3 pa ...

Peut-on rire de tout ? Corrigé dissertation
Dissertation de philosophie avec un plan en 3 partie qui répond au sujet suivant : Peut-on rire de tout ? Dissertation entièrement rédigée à télécharger ...

Travailler moins est-ce vivre mieux ? Corriger dissertation
Exemple de corrigé d'une dissertation de philo dont le sujet Travailler moins est-ce vivre mieux ? Dissertation à télécharger au format pdf, word et odt. ...

Les machines nous libèrent-elles du travail ? Corrigé dissertation
Corrigé de dissertation entièrement rédigée dont le sujet est : les machines nous libèrent-elles du travail ? Dissertation à télécharger en pdf, word et ...

Le savoir exclut-il toute forme de croyance ? Corrigé dissertation
Corrigé d'une dissertation de philo dont la problématique est Le savoir exclut-il toute forme de croyance ? Dissertation avec plan en 3 parties à télécharg ...

Rechercher dans 505201 documents

Dissertation: Le doute est-il une force ou une faiblesse ?
Publié le 04/05/2023

Extrait du document
« Le doute est-il une force ou une faiblesse ? Le doute peut apparaître comme une faiblesse, spécialement au plan pratique : agir, oser, entreprendre requiert qu'on croit en soi, en la valeur de ce qu'on fait et en ses chances de succès. Dans cette perspective, le doute apparaît comme une faiblesse, c'est-à-dire comme un amoindrissement de notre capacité à agir et à réaliser nos désirs. Il peut cependant être envisagé aussi comme une force capable de nous libérer de nos fausses certitudes, comme un remède puissant contre la naïveté, la crédulité et l'aveuglement, comme un outil critique indispensable à la pensée comme à l'action. On peut donc se demander s'il faut voir le doute comme la faiblesse d'un esprit incapable d'arrêter un jugement, de décider et d'agir ou, au contraire, comme la force d'un esprit critique et lucide, armé contre la fausse évidence des apparences et des a priori. En premier lieu le doute peut en effet sembler être une force s'il nous mène, à l'issue de son activité, à la vérité. Descartes en a fait l'expérience, le doute, quand on cherche à l'étendre à toutes choses, se heurte au moins à une certitude, celle de l'existence de l'esprit qui doute, la certitude du cogito : « je pense donc je suis », je doute donc je suis. Le doute ne saurait donc aller jusqu'au bout de lui-même sans se changer en son contraire, sans se changer en certitude. Le doute cartésien n'est que provisoire, il n'est pas une fin en soi (comme chez les sceptiques) mais un moyen, un outil, une méthode pour atteindre une vérité certaine. C'est la raison pour laquelle le doute cartésien est aussi délibérément exagéré, « hyperbolique » comme dit Descartes. Le doute permet en effet d'écarter l'incertitude, ce qui lui résiste, ce dont on ne peut en rien douter peut être tenu pour assurément vrai. Le doute cartésien est une arme redoutable contre l'erreur, l'illusion, le préjugé, contre la fausse évidence des apparences et des idées toutes faites ou mal faites.
Le doute apparaît donc comme la force d'un esprit armé contre l'erreur. Le doute semble donc inséparable de la démarche philosophique elle-même. Il fait sa force, son intérêt et sa valeur. Bertrand Russell souligne ainsi que la philosophie vaut par le doute qu'elle éveille dans l'esprit de celui qui la découvre. Celui qui n'a jamais fait de philosophie traverse la vie sans jamais douter des habitudes de pensée de l'époque et du pays dans lequel il vit. La philosophie vaut avant tout par son incertitude, écrit Russell. La formule éclaire rétrospectivement le célèbre jugement de Kant : on ne peut pas apprendre la philosophie. Si on ne peut apprendre la philosophie, c'est qu'elle n'est pas une science, mais primordialement un questionnement. C'est ce qui en fait, estime du moins Kant, une activité réservée à l'adulte : l'enfant, l'écolier sont capables d'apprendre et de réciter, mais l'adulte seul peut s'interroger, doute et penser par lui-même. Le doute apparaît dès lors comme le propre d'un esprit adulte, critique et autonome, assez fort pour oser la liberté de penser. Il est l'arme de ceux qu'on a appelés les « libres penseurs » parce qu'ils osaient douter de l'existence Divine et des Écritures comme de toute autorité morale ou intellectuelle. Mais le doute peut également être une faiblesse s'il devient un point de stagnation, et finalement une limite à l'action. Pratiquement si douter signifie de rester dans une indécision permanente, alors il devient impossible d'avancer, de progresser, voire de pouvoir répondre à des besoins urgents. En effet, si Descartes doute de toutes choses, c'est seulement au plan théorique. Il se donne d'ailleurs une morale provisoire dans le Discours de la méthode : trois ou quatre maximes qui guideront sa conduite en attendant de pouvoir fonder une morale définitive sur des principes métaphysiques indubitables. Une de ces maximes prescrit d'être aussi ferme et résolu que possible dans l'action..... »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
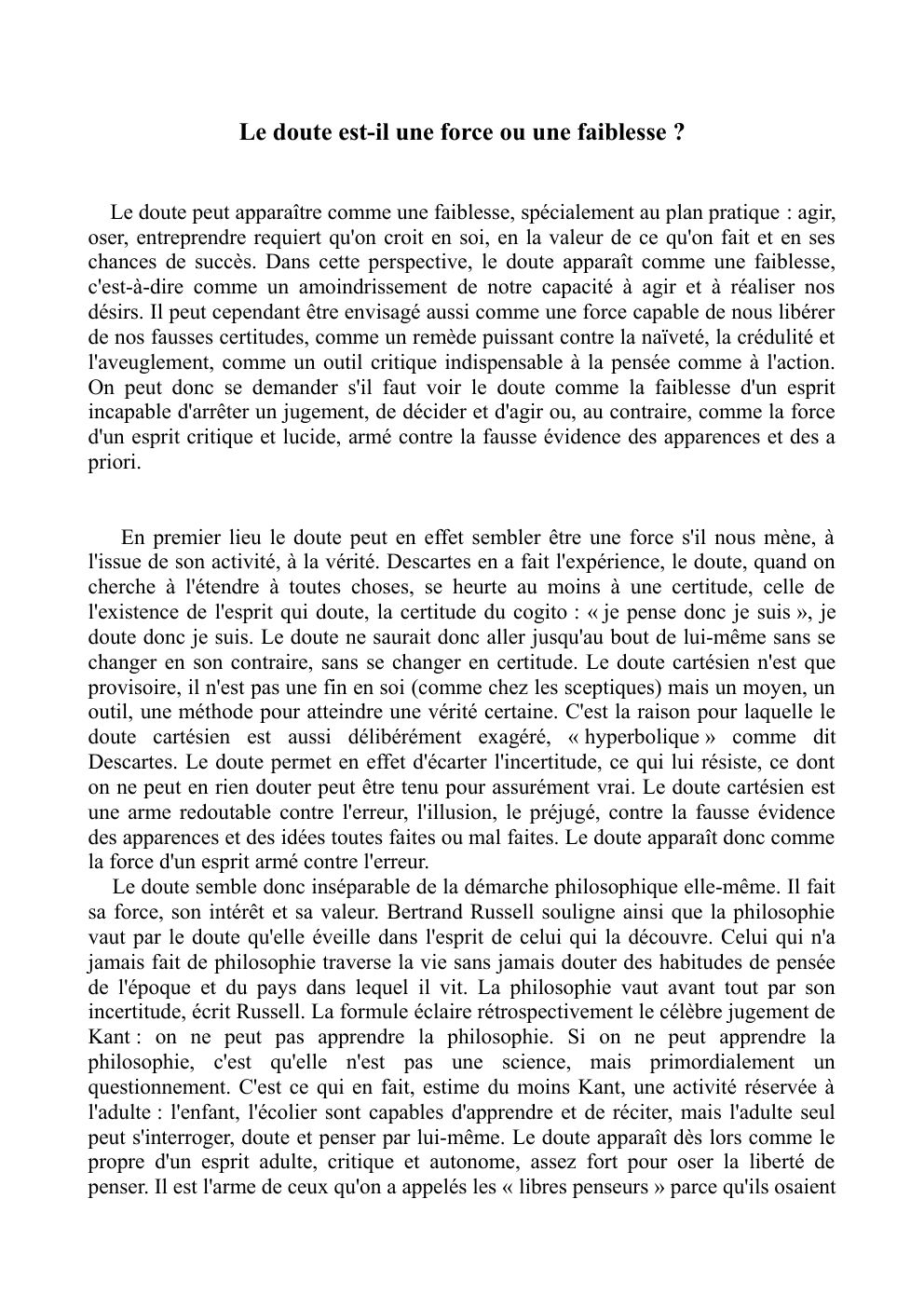
Télécharger gratuitement ce document
Liens utiles.
- Le doute: force ou faiblesse ?
- Le doute est-il une faiblesse ou une force ?
- Le doute est-il une force ou une faiblesse de l'esprit ?
- Le doute est-il une force ou une faiblesse ?
- Le doute est il une faiblesse?
Obtenir ce document
Le document : " Dissertation: Le doute est-il une force ou une faiblesse ? " compte 1133 mots (soit 3 pages). Pour le télécharger en entier, envoyez-nous l’un de vos travaux scolaires grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques ou achetez-le pour la somme symbolique d’un euro.
Le paiement a été reçu avec succès, nous vous avons envoyé le document par email à .
Le paiement a été refusé, veuillez réessayer. Si l'erreur persiste, il se peut que le service de paiement soit indisponible pour le moment.
Payer par Allopass
Bac Philo 2015, 2ème session (1/4) : Dissertation : "Faut-il toujours chercher la certitude ?"
Toute la semaine, des professeurs de terminale corrigent sujets de dissertation et explications de texte en compagnie d'adèle van reeth. aujourd'hui, "faut-il toujours chercher la certitude " un sujet proposé par ligeia saint-jean, professeur au lycée paul bert, à paris., dissertation : faut-il toujours chercher la certitude .
Analyse du sujet
Avoir des certitudes c'est tenir pour vrai quelque chose sans remettre en question ceque l'on affirme parce qu'on y adhère entièrement, pleinement. Toute la question est de savoir de quelle nature est cette adhésion : cette adhésion d'un sujet à ce qu'il affirme et tient pour assuré est-elle immédiate, crédule et trop subjective ou bien est-elle objectivement fondée ? Quand on dit « j'en ai la certitude » on veut bien dire qu'on n'en doute pas, on tient pour assuré ce que l'on dit ou ce que l'on sait. La certitude renvoie au domaine de la vérité, des connaissances assurées, c'est-à-dire fondées et prouvées. Quand on parle de la « certitude d'un fait » on parle d'un fait avéré, validé par l'expérience, un fait que l'on ne pourrait nier. Chercher la certitude peut renvoyer à une exigence rationnelle, celle de tout esprit qui a soif de connaissances véritables et solides, rejetant toute opinion empruntée et mal fondée, toute connaissance reçue naïvement sans qu'on ait pris la peine ou qu'on ait fait l'effort de la remettre en question.
Seulement, il peut y avoir différents degrés ou types de certitude : de la certitude la plus rationnellement prouvée et établie à celle qui est reçue de manière aveugle et crédule et qui peut renvoyer à tout ce que l'on tient pour vrai sur fond d'une ignorance, à tout ce que l'on croit savoir sur un mode assuré et dogmatique. Si on se réfère au langage courant : quand on dit de quelqu'un qu'il « a trop de certitudes » on indique par là un défaut, le défaut d'un esprit non pas qui recherche la certitude au sens d'une vérité définitive et indubitable, mais qui porte des jugements trop hâtifs et qui est le plus souvent dans le préjugé, des préjugés qu'il ne remet jamais en question et auxquels il accorde un caractère certain de manière présomptueuse et dogmatique. Dans ce sens là, la certitude ne doit pas faire l'objet d'une recherche, mais d'un doute ou d'une remise en question.
La question posée peut être interprétée en deux sens :- « Faut-il toujours chercher la certitude ? » semble sous-entendre (implicite du sujet)qu'on pourrait avoir des raisons de se méfier de nos certitudes, indiquant par là qu'il ne faudrait pas toujours les chercher mais bien plutôt qu'il faudrait mettre en doute leur contenu de vérité.- Mais en même temps on pourrait s'étonner d'une telle question puisqu'une certitude n'est jamais véritablement l'objet d'une recherche puisqu'elle est toujours tenue pour évidente sur un mode immédiat et intuitif, avec pour seul fondement l'assentiment d'un sujet qui a la conviction que ce qu'il tient pour certain est bien vrai. L'expression « chercher la certitude » serait alors confondue avec la quête d'une certitude absolue et définitive confondue alors avec la vérité, une vérité à laquelle on n'accède jamais ou simplement sur un mode illusoire, une vérité vers laquelle on tend seulement.- On peut aussi remarquer à ce niveau de l'analyse que « la » certitude n'est pas équivalente à toutes « nos certitudes », l'une étant l'objet d'une véritable quête ou enquête, alors que les autres devraient faire l'objet d'une remise en question nécessaire car toujours insuffisantes du point de vue de leur fondement.
C'est bien la valeur de nos certitudes qu'il nous faut ici interroger et discuter : Le « faut-il » renvoyant au « est-il possible » ou « souhaitable » ou encore à un « doit-il » .(question de nature épistémologique ** qui interroge les capacités de notre esprit à établir la vérité ou bien **morale ** qui interroge le besoin et la nécessité qu'ont les hommes d'avoir des certitudes pour vivre et agir).
Toute la question étant de savoir qui pose une telle question et de quelle nature sont sesexigences :- Exigences d'un esprit sceptique, enquêteur qui ne voit dans la certitude qu'une formede vérité toujours imparfaite et mal fondée, un esprit qui a soif de vérité, mais une vérité dontil doute bien qu'on puisse jamais l'atteindre, au sens où il serait toujours préférable demaintenir le doute à chaque fois que l'on croit savoir quelque chose et que l'on a la prétentionde le tenir pour assuré.Un esprit qui ne confondra jamais **vérité ** et certitude : la **certitude ** étant toujoursobjectivement insuffisante, même si elle apparaît toujours suffisante pour le sujet qui la tientpour assurée ; la **vérité ** elle étant objectivement fondée et établie.- Ou bien l'exigence d'un esprit qui voit dans toute certitude tenue l'occasion pour unsujet d'affirmer ses convictions les plus fortes, convictions toujours subjectivement suffisantespour celui qui s'y tient et les défend.
Il revient alors de mieux relire le sujet et d'y repérer que le « toujours » semble bienapporter une nuance : « faut-il toujours chercher la certitude ? » semble aussi indiquer qu'il y ades circonstances où on aurait besoin de certitudes et d'autres où il serait nécessaire de lesrejeter pour les refonder ou les discuter. Mais lesquelles ? Et comment établir cette nuance ?Cette nuance peut être établie à partir d'une distinction entre le domaine théorique ouépistémologique et le domaine pratique et moral.Ainsi, on peut facilement comprendre que si on peut maintenir un doute durable dupoint de vue de nos connaissances théoriques, pour agir et prendre des décisions, avoir descertitudes est indispensable voire bénéfique. On préfère toujours un caractère assuré à uncaractère irrésolu. Celui qui reste indécis finit toujours par se laisser faire ou se laisser malmener.Mais en même temps trop d'assurance peut être la marque d'un caractère qui manquede réflexion et de prudence qui par irréflexion se hâte dans ses décisions et dans sesjugements.Il nous serait donc autant bénéfique d'avoir des certitudes que de les rejeter ou de s'enméfier.Toute la question revient alors à interroger le bienfondé de nos certitudes et le rapportque nous entretenons avec celles-ci : de quelle manière adhérons-nous à nos certitudes ? Demanière purement crédrule et naïve ou bien de manière objective et rationnellement fondée ? La difficulté revient alors à lever l'ambiguïté inhérente à la nature même de noscertitudes :
Enoncé du problème : Si la certitude marque l'assurance d'un esprit qui ne doute pas et ne craint pas l'erreur, cette assurance peut très bien n'être que le fruit d'une intuition et d'une adhésion trop crédule alors peu objective et peu justifiable, ce qui revient alors à se demander s'il faut toujours chercher la certitude et dans quelle mesure ? Car toute certitude est-elle bonne à rechercher ?
Proposition de plan
Partie 1 On montrera que toujours chercher la certitude relève d'une exigence rationnelle, celle d'établir une vérité dont on n'a plus aucune raison de douter - une vérité indubitable. Mais une telle exigence nécessite alors que l'on se défasse de toutes sortes de certitudes trop immédiatement tenues pour assurées pour les fonder en vérité.
2ème partie Toujours chercher la certitude c'est ne jamais s'y tenir, car c'est mettre en question lanature de l'assentiment par lequel toute certitude est tenue pour vraie.(On peut douter qu'on puisse atteindre une certitude absolue pour s'installer dans undoute permanent. Toujours chercher la certitude revient à ne jamais s'accommoder de sescertitudes et à mettre en question toute prétention qu'aurait un sujet de tenir pour vraiquelque chose sur le seul mode de l'évidence qui n'est jamais alors qu'une croyance.)
3ème partie Pourtant des certitudes nous sont indispensables pour agir et nous engager dansl'existence. Mais avoir des certitudes n'est bénéfique qu'à celui qui les tient pourobjectivement insuffisantes alors qu'elles lui sont subjectivement suffisantes. Et s'il nous fautavoir des certitudes, il nous faut également pratiquer une vigilance critique à leur égard.
1ère partie : Toujours rechercher la certitude répond à une exigence derationalité et de vérité.
a) Les critères d'une connaissance certaine et objective : Cette exigence est celle d'un esprit qui refuse l'erreur et l'approximation, un esprit quiconsidère qu'une connaissance n'est solide que si elle est certaine, c'est-à-direrationnellement fondée de sorte qu'on ne puisse plus en douter, ni la remettre en question.Est certaine une connaissance à laquelle on n'apportera pas d'objection, quiemporte une adhésion pleine et entière, parce qu'elle est rationnellement fondée. Maisqu'est-ce qu'une connaissance rationnellement fondée et sur quel critère peut-onétablir qu'elle est certaine ?- Les sciences ne font des progrès que lorsqu'elles parviennent à éliminer les doutes et àétablir des certitudes.- « Toute science est une connaissance certaine » écrit Descartes dans* Les Règles pour ladirection de l'esprit* , début de la Règle II .
Dans la Règle II , Descartes explique en quel sens on appelle science une connaissancecertaine et indubitable, une connaissance qui a rejeté tout savoir seulement probable oudouteux. Ainsi, analysant les actes par lesquels la raison ou l'entendement peut parvenir àl'établissement d'une connaissance indubitable et prenant pour cela l'exemple desmathématiques, avec l'arithmétique et la géométrie, il va montrer que ce qui peut fonder lacertitude d'une connaissance scientifique, c'est :- son objet d'étude, « pur et simple » non dérivé de l'expérience mais seulement conçuclairement et directement par l'entendement ;- une méthode démonstrative qui permet à partir de principes clairs et distincts d'enchaînerdes propositions de manière logique et déductive sans que l'erreur ne puisse s'y insérer.
A partir de cette analyse, il va montrer que la certitude d'une connaissance peutprovenir de deux sources : l'**intuition ** et la déduction . Ainsi, écrit Descartes, (Règle IV)« aucune science ne peut s'acquérir autrement que par l'intuition intellectuelle ou par ladéduction ».
Par intuition , il désigne la capacité qu'a l'esprit d'être attentif à des idées simples etpures qui sont des premières semences de pensées déposées en notre esprit, appelées aussiprincipes innés et que nous étouffons en nous en écoutant toutes sortes d'erreurs.Il désigne par intuition non pas une intuition sensible, simple témoigage des sens, ni lejugement trompeur de l'imagination, mais une intuition intellectuelle à savoir « unereprésentation qui est le fait de l'intelligence pure et attentive, qui naît de la seule lumière dela raison ». Par cette intuition on peut par exemple se représenter qu'un triangle est délimitépar trois lignes seulement.
A l'intuition se joint la déduction , acte par lequel peut se conclure nécessairement despropositions à partir d'autres choses connues avec certitude.Par exemple de l'intuition que 2 et 2 font 4 et que 3 et 1 font 4 on en déduitnécessairement que 2 et 2 font autant que 3 et 1.Ainsi, explique Descartes, « parce que la plupart des choses sont l'objet d'uneconnaissance certaine, tout en n'étant pas par elles-mêmes évidentes ; il suffit qu'elles soientdéduites à partir de principes vrais et déjà connus, par un mouvement continu etininterrompu de la pensée, qui prend de chaque terme une intuition claire ».Par la déduction, chaque terme est relié au précédant, et même si nous n'avons pas unevue synoptique sur l'ensemble des enchainements opérés, l'examen de chaque enchainementsuffit à considérer que l'ensemble est certain. La déduction s'exerce dans la discursivité, lasuccession, et emprunte alors sa certitude à la mémoire que l'on a des enchainements opérés.A partir de la réflexion des actes mentaux à l'oeuvre dans les sciences mathématiques,Descartes faire émerger l'idée d'une « mathésis universalis » c'est-à-dire d'une méthodeuniverselle et de formes logiques originaires dont les mathématiques ordinaires ne sont queles dérivées. Cette méthode universelle ne correspond pas à des règles ou des outils qu'ilsuffirait d'appliquer pour penser vrai, mais est l'oeuvre d'un esprit inventif qui en découvrantréflexivement ses pouvoirs se découvre lui-même.
Conclusion : Ainsi, seules ces deux voies, rejetant l'expérience comme source possibled'erreurs, permettent d'atteindre la certitude scientifique, une certitude scientifique quimême si elle repose sur l'évidence de principes clairs et distincts à partir desquels seront déduites toutes les autres connaissances, doit faire l'objet d'une recherche : d'un effort deméthode et d'attention. Car s'il est clair qu'il nous faut toujours chercher la certitude, il n'estpas évident que toutes nos certitudes soient rationnellement fondées et nous donnenttoujours la garantie que ce que l'on tient pour assuré est bien vrai.Ce dont il faut alors s'étonner à ce moment de la réflexion c'est bien que la certitudealors même qu'elle est le fruit d'une évidence fasse l'objet d'une recherche. De quelle natureest cette recherche ? Et qu'est-ce qui fonde véritablement une certitude en vérité ?
b) Ce qui fonde nos certitudes en vérité, c'est la volonté d'un esprit qui refuse dedonner son assentiment à des idées confuses et incertaines et qui cherche à s'en remettreà des principes clairs et distincts, principes intuitivement conçus, mais auxquelsl'entendement ne peut parvenir qu'au terme d'un effort et d'une attention, celui de rejeter toutce qui est incertain en le considérant comme faux. Est alors certain ce qui fait l'objet d'unassentiment éclairé par une raison convertie à l'ordre de nos intuitions et non aveuglé par lessens ou l'imagination. Ainsi, rechercher la certitude au sens d'une certitude absolue implique qu'on nes'accommode pas de n'importe quelle certitude : il y a des degrés de certitudes, de lacertitude la plus immédiatement reçue et la plus crédule à la certitude la plus rationnellementfondée.Mais, qu'est-ce qui fonde véritablement nos certitudes ? Et qu'est-ce qui fait del'évidence un critère de vérité ?
Dans les Méditations Métaphysiques , Descartes entreprend de récuser nos certitudessensibles pour les fonder rationnellement. Pour cela, il va montrer que toute quête decertitude absolue et évidente passe par l'expérience d'un doute méthodique par lequel l'espritva se dépouiller de toutes les idées acquises passivement pour ne retenir que celles qui luisont innées et qu'il ne pourrait nier sans se nier lui-même.Le doute est bien le fruit d'une libre décision celle d'une volonté qui prend la résolutionde ne jamais recevoir aucune chose pour vraie sans la connaître évidemment pour telle, et quiprend pour règle de tenir pour faux tout ce qui est incertain et de ne s'occuper que d'objetsdont l'esprit paraît pouvoir atteindre une connaissance certaine et indubitable.Ainsi, pour Descartes, si la certitude est le fruit d'une évidence par laquelle l'espritperçoit des idées claires qui s'imposent à lui, idées innées ou premiers principes desquels ilpeut ensuite concevoir toutes les propositions qui s'en déduisent, il ne suffit pas de penser parintuition pour penser en vérité.Penser en vérité dépend aussi de l' exercice du jugement, dans lequel est impliquée lavolonté. Trouver la certitude suppose qu'on ne soit pas inattentif, ni négligent ou paresseux. Ildépend alors de nous de ne pas nous tromper en nous précipitant dans nos affirmations et enprenant pour cetain ce qui n'est que préjugé ou opinion.Ainsi, l'attention est requise pour délimiter la compréhension de l'objet conçu parl'entendement, le définir et en obtenir une conception distincte. Par exemple, on peutconfondre par inattention un carré et un rectangle, tous les deux étant des quadrialtères dontles angles sont droits.Mais l'attention peut être aussi requise pour refuser toutes les idées confuses carcomposées, comme les idées des choses matérielles ou du coprs (idée complexe). Ou encorenous rendre indifférents à l'ordre de l'action, c'est-à-dire à tout ce qui nous unit à notre corpsque l'attention nous soustrait. Mais si nous avons à être attentifs, c'est bien parce qu'il est denotre nature que notre esprit soit uni au corps.
Deuxième partie
Mise en question de toute prétention à prendre noscertitudes même les plus rationnellement fondées pour des vérités. a) Critique de l'entreprise cartésienne : Il y a derrière toute recherche de certitude, la position d'un sujet qui tient pour assuréqu'il suffit d'avoir des certitudes rationnellement fondées pour établir la vérité.Seulement, nos certitudes ne sont-elles pas toujours en deçà de ce que sont réellementles choses et le monde ?Et qu'est-ce qui fonde nos certitudes en vérité (où la vérité désigne l'accord de cequ'on énonce et affirme avec ce qui existe de fait, et pas simplement la cohérence del'esprit avec lui-même) sinon le postulat d'un accord entre nos actes cognitifs et la réalitédu monde, et tout ce qui existe, accord qui est justifié par Descartes à partir de l'intuitionfondamentale de l'infinie puissance divine qui donne un fondement ontologique à noscertitudes. ?De cette parfaite simplicité de Dieu s'ensuit l'identité de ce qu'il conçoit et de ce qu'ilcrée, l'ordre des existences se trouvant alors originairement conforme à l'ordre des essences.Dès lors les idées innées ne sont en nous comme les vérités et les choses ne sont horsde nous, que parce qu 'elles ont été crées telles par Dieu. De la simplicité de Dieu s'ensuit alorsque les idées innées expriment originairement en nous les lois qu'il a instituées dans la nature(Cf. Lettre à Mersenne de 1639 : dans laquelle il affirme que la conformité de l'ordre des chosesà l'ordre des idées s'ensuit de l'unité et de la simplicité de leur créateur.)Qu'il nous suffit de déduire nos idées avec ordre pour que nous retrouvions l'ordremême de la nature. Cf. Critique de Merleau-Ponty à l'égard de Descartes dans Le Visible et l'invisible ,(p.60-62,Tel.Gallimard) : montre que ce prétendu accord n'est pas de nature réflexive etlogique mais bien en-deçà de toute logique, qu'il est pré-réflexif.- caratcère artificiel du doute cartésien (un doute en robe de chambre) qui suppose unsujet autoconstitué et autoconstituant et qui oublie que le sujet est toujours pris dans l'espacequ'il perçoit et que ce lien d'appartenance préalable est antérieur à toute reprise réflexive. Celien ne se réduit pas à un acte intellectuel de liaison et n'appartient pas aux opérationsconstitutives des objets de la connaissance.- rapport supposé évident et frontal du sujet avec le monde : redéfinition de« l'époché » et de sa méthode. Le sujet qui entreprend de douter n'est pas au monde commeun spectateur et le lien qu'il entretient avec le monde est ombilical, organique et pré-logique.- La mise en question de nos certitudes les plus infondées : celle de l'existence dumonde extérieur parce que nous en avons la perception sensible immédiate, ne doit pas nousconduire à mettre en évidence nos structures logiques et cognitives originaires mais bien aucontraire en en réinterroger les soubassements ; que ces structures logiques et toutes lesopérations de la conscience ont comme prélable un lien d'appartenance au monde qui est préréflexifet qui va rendre possible les opérations de la conscience sans qu'elles ne s'y réduisentpourtant.- La mise à nue de notre lien originaire avec le monde (travail de l'épochè) ne révèle pasune parfaite coïncidence entre ce que je suis et les choses perçues, mais une quasicoincidence : le monde que je perçois n'est pas réductible à ce que je suis (cf. « le chiasme » : lamais sentante et la main sentie). Il n'existe pas au titre d'un mode de ma pensée (cf.Descartes : « la perception est une inspection de l'esprit ») ; il y est irréductible.Ce que le doute doit alors remettre en question c'est cette évidence que parce que jeconçois clairement un objet, je peux imédiatement en déduire son existence, une existence quidemeure irréductible à la connaissance que j'en ai. L'expérience du doute au lieu d'être uneexpérience de réflexivité par laquelle le sujet fait retour sur lui-même est à l'inverse uneexpérience d'une certaine facticité : celle d'appartenir à un monde déjà donné, un monde quinous précède toujours - un monde fait de la même chair que moi , mais un monde opaque queje ne peux entièrement faire entrer dans l'espace de ma conscience.L'expérience du doute au lieu de faire apparaître la certitude de nos actes mentaux, doitmettre en question nos habitudes perceptives toujours traversées par des catégories logiquesqui nous empêchent d'appréhender le monde dans sa réelle opacité et matérialité.Il s'agit alors de sortir d'une logique de la représentation pour retrouver le véritablesens de toute perception ne réduisant jamais le visible à ce qui est vu. ; et de prendre acte del'origine non réflexive de notre rapport au monde et de l'altération que notre activité réflexivefait subir au lien perceptif.Ce n'est pas la science elle-même que critique Merleau-Ponty mais son oubli de cerapport fondamental et pré-reflexif de toute conscience et du monde. Les certitudes qu'établitla science ne rendront jamais compte du « il y a » du monde. (Cf. dans L'Oeil et l'Esprit , leprivilège de l'art sur la science).
b) Que toute recherche de certitude révèlerait l'évitement d'une question : celledu rapport réel et véritable que nous entretenons avec le monde. Il y a derrière toute recherche de certitude la position d'un sujet qui cherche à évaluer,et à trouver des repères et un ancrage dans un monde qu'il préfère illusoirement sereprésenter comme nécessairement ordonné et l'oeuvre d'un principe ordonnateur. Cetteévaluation qui est alors un moyen d'exprimer une volonté de vivre et d'affirmer sa sujectivitéet ses préférences affectives, mais que l'on dissimule hypochritement derrière une croyanceen des principes métaphysiques que l'on tient pour universels. Cf. Nietzsche, *Aurore * : « La vérité n'est jamais que la recherche de la sûreté ».Les certitudes des hommes ont toujours pour fond des arrières-penséesmétaphysiques dont il est difficile de se débarrasser. Chercher la certitude reviendrait àtrouver un réconfort illusoire derrière des croyances que l'on considère comme détentrices devérité et de valeurs universelles.
Conclusion de la 2e partie : Il ne faut pas toujours chercher la certitude mais bien plûtôt considérer que noscertitudes sont toujours insuffisantes et en deçà de la vérité, c'est-à-dire du rapport véritableque nous entretenons avec le monde.Plûtôt que de toujours chercher la certitude, faut-il préférer un doute permanent, douteépistémique autant qu'ontologique et métaphysique ? Et considérer que chercher la certitude,c'est décider de ne jamais s'y tenir.
3ème partie : Faut-il faire l'éloge de l'ignorance, préférer un doute absolu ? Ou bien faut-il s'accommoder de nos certitudes tout en connaissant leur insuffisance ?
a) Douter de tout et ne jamais se satisfaire d'aucune certitude est-il une positiontenable ? Cf. Montaigne, Les Essais ., fait l'éloge de l'ignorance, une « ignorance forte et généreusequi ne doit rien en honneur et en courage à la science. Ignorance pour laquelle concevoir il n'ya pas moins de science que pour concevoir la science ». Cette ignorance est une ignoranceavouée et confessée. Elle consiste en une remise en question de tout ce que l'on croit savoir etde tout ce que l'on tient pour assuré pour la seule raison qu'on craint de manièreprésompteuse « de faire profession de son ignorance ».Si l'ignorance est pour Montaigne le terme de l'enquête philosophique, c'est parce quela remise en question de nos certitudes conduit inévitablement à la remise en question d'uncritère possible de vérité, (cf. Les Essais , chap.12, livre II, Apologie de Raymond Sebon : « Lapeste de l'homme, c'est l'opinion de savoir », « l'homme n'a rien proprement sien que l'usagede ses opinions. Nous n'avons que du vent et de la fumée en partage ») ou plus exactementque la seule vérité à laquelle nous puissions accéder est que tout est instable et enmouvement, et que notre être lui même est pris dans ce mouvement perpétuel, à l'inverse dudoute cartésien qui ramène le sujet à lui-même, à son caractère auto-positionnel.Ce doute est vertigineux puis qu'il porte sur nos jugements, nos manières de parler,mais plus encore sur notre être et le statut de notre identité, la constitution de notresujectivité : une subjectivité toujours mise à l'épreuve des expériences, du monde, de l'altéritéet qui ne ne constitue que par elles.Mais si tout est incertain, y compris notre être même, comment vivre et parvenir à nousengager dans l'existence ? Sommes-nous condamnés à n'être que le réceptacle passif de tousles événements du monde, et à suivre passivement l'ordre des conventions et traditions dontnous sommes les héritiers, qui participent à la construction de notre identité et qui sont desguides utiles pour nos existences, mais pour des existences toujours mises à l'épreuve et nonmaîtrisées et librement orientées par nous-mêmes ?
b) Si des certitudes nous sont indispensables pour agir et nous engager dansl'existence , il ne nous faut pas nous contenter de nous en remettre passivement à desconventions déjà établies pour rendre possible et pensable notre engagement dansl'existence . Mais considérer que si certaines certitudes nous sont indispensables, ilimporte de garder une certaine vigilance à leur égard. Un doute épistémique ou métaphysique qu'elle que soit l'issue de ce doute ne doit pasnous empêcher d'agir et ni de prendre des décisions. Et la mise en question de nos certitudesinfondées au nom de la recherche d'un critère universel de la vérité ne doit pas pour autantnous rendre irrésolus dans l'action.Seulement, comment décider sur fond d'une incertitude fondamentale, celle de ne paspouvoir anticiper le cours des événements et de l'avenir ?Nos certitudes nous sont bénéfiques et même si elles n'ont aucun fondement objectif,elles valent pour autant qu'à tavers elles on peut exprimer ses convictions et les valeursauxquelles on tient et dans lesquelles on s'engage.La distinction entre certitude morale et certitude plus que morale qu'établitDescartes aux art.205 et 206 des Principes de la philosophie : la certitude morale, certitudenon démontrée comme les vérités mathématiques, mais étant suffisante pour « régler nosmoeurs et aussi grande que celle des choses dont nous n'avons point coutume de doutertouchant la conduite de la vie, bien que nous sachions qu'il se peut faire, absolument parlant,qu'elles soient fausses ».Ainsi, explique Descartes, il n'y aurait pas de sens à mettre en question l'ordre deslettres de l'alphabet, ni de décider qu'à la place du « B » on y lirait un « A », et de modifier ainsiune convention établie que par habitude on ne discute pas parce qu'elle nous est utile à établirun ordre de significations et à permettre un espace d'échange et de communication.Seulement, quelle est la réelle valeur de ces certitudes ? Sont-elles le seul produit d'unconditionnement social ? De quelle manière, nous fions-nous à elles ? Par simple utilité etpragmatisme ou bien parce qu'à travers elles nous y formons et engageons et nos convictionset notre véritable personnalité ?Une certitude peut tenir son importance du fait qu'un sujet paraît y engager sa personnalité, ses préférences et cela sur seul fond d'un engagement sujectif qui n'a de raisonde s'y tenir que les siennes. Ainsi, la certitude peut être définie au titre d'une croyance morale qui même si ellereste toujours objectivement insuffisante n'en demeure pas moins sujectivement suffisante. Elle n'est donc pas une simple opinion renvoyant à un jugement incertain ou problématique, car toujours susceptible d'être contredit, ni même à une connaissance objective car nécessairement et universellement fondée, mais bien plûtôt à une conviction par laquelle unsujet affirme et tient certain quelque chose tout en sachant que ce qu'il affirme ne pourra pasfaire l'objet d'une démonstration scientifique, ni être établi de manière irréfutable.Cf . Kant, CFJ , §91 : « De la manière de tenir quelque chose pour vrai au moyen d'une croyance pratique » : « Le fait de tenir quelque chose pour vrai dans les affaires de la croyance relève du point de vue pratique pur, c'est-à-dire est une croyance morale qui ne prouve rien pour la connaissance théorique, mais seulement pour la connaissance pratique de la raison pure dirigées vers l'accomplissement de ses devoirs » (P.452 édition Folio essais).Mais toute la question ici est de savoir si nos certitudes morales ou « croyances pratiques » sont véritablement l'expression d'un engagement de notre subjectivité au sensd'une véritable conviction à travers laquelle nous donnons sens à nos actions et par lesquellesnous pouvons espérer prendre les meilleures décisions, ou à l'inverse si elles ne sont pas simplement l'expression d'habitudes sociales et morales que nous avons appris à intégrersans véritablement pouvoir exprimer à travers elles notre véritable sujectivité, simplesrepères à partir desquels on s'identifie et qu'on respecte par imitation.
Si avoir des certitudes est utile et bénéfique, car elles donnent ancrage à notre subjectivité (que cet ancrage soit scientifique, ontologique ou moral et social),il importe de se donner les moyens de les mettre en perspective par les échanges, la discussion, les confrontations, et par cet effort de ne jamais s'y tenir pleinement ou toujours en considérant ce qu'elles sont- à savoir des points de repères limités et partiels qui n'ont de valeur que dans un contexte donné. Si les certitudes peuvent être l'expression de la pleine confiance qu'à un sujet de lui-même, elles prennent alors le sens de convictions intimement tenues. Seulement, nos certitudes peuvent aussi n'avoir été forgées que par habitude et convention. C'est pourquoi il importe de toujours tenir nos certitudes pour ce qu'elles sont, à savoir des certitudes et non des vérités indiscutables et inébranlables., face auxquelles il faut garder une distance critique et vigilante.
Lectures, par Olivier Martinaud
- Descartes , Méditations métaphysiques (1641), méditation première.
- David Hume , Enquête sur l'entendement humain , section VII, "De l'idée de connexion nécessaire", 2ème partie.
Bibliographie
- Descartes, Oeuvres philosophiques , tome 1, F.Alquié, Règles pour la direction de l'esprit , RègleII, p.84 à la fin « De la se conclut avec évidence la raison pour laquelle l'arithmétique et la géométrie sont bien plus certaines que toutes les autre disciplines »
- Descartes, Principes de la Philosophie , art. 205 et 206
- Merleau-Ponty, Le Visible et l'Invisible , p.57à60 : « Réduire la perception à la pensée de percevoir, sous prétexte que seule l'immanence est sûre, c'est prendre une assurance contre le doute … », « ne nous fait pas comprendre notre propre obscurité »
- Montaigne, Les Essais , II, 12, « Apologie de Raymond Sebon »- Kant, CFJ , §91
- Nietzsche, Aurore et Le Crépuscule des idoles .
Musiques diffusées
- Mr Scruff, Do You Hear
- Ennio Morricone , Stark System
- Alexis HK, La Rumeur
- Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life
Extraits diffusés
- Spectacle "Merci Bernard Ribes" , France 3, 16/06/1982.
- Maurice Merleau-Ponty sur Descartes, entretien donné à Georges Charbonnier à l'ENS, le 29/05/1959.
- Dr House , Saison 1, épisode 1.
Chronique "Deux minutes papillon" de Géraldine Mosna-Savoye
Cette semaine consacrée au bac, des philosophes évoquent pour nous quelle a été leur découverte de la philosophie en terminale. Aujourd’hui : Claire Marin , professeure en classes préparatoires au lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise, auteure de La Maladie, catastrophe intime paru aux PUF et Violences de la maladie, violences de la vie (Armand Colin).
> Philosophie, histoire, sciences, économie... révisez le bac avec France Culture
- Mydia Portis-Guérin Réalisation
- Nicolas Berger Réalisation
- Marianne Chassort Collaboration
- Tristan Ghrenassia Collaboration
- Antoine Ravon Collaboration
- Radio France, aller à la page d'accueil
- France Inter
- France Bleu
- France Culture
- France Musique
- La Maison de la Radio et de la Musique
- L'entreprise Radio France
- Les Editions Radio France
- Personnalités
- Nous contacter
- Comment écouter Radio France
- Questions fréquentes (FAQ)
- La Médiatrice
- Votre avis sur le site
- Accessibilité : non-conforme
- Gestion des cookies
- Mentions légales
Le doute est-il une force ou une faiblesse ?
Dissertation réalisée en L1. Note obtenue : 12/20.
Dans l’inconscient collectif, le doute est plutôt perçu comme une faiblesse notamment lorsqu’il s’agit de doute s’apparentant à une peur d’agir. À l’inverse, la recherche intellectuelle va évidemment de pair avec le doute, le travail du philosophe par exemple étant de réaliser des « pas de côtés » et de ne pas se plier à la doxa dominante, toujours se demander « pourquoi » et se demander si la réponse que le monde voudrait nous donner est nécessairement la bonne. Le doute serait donc une force dans une mesure d’analyse, une faiblesse dans le monde des actions. Le doute est en réalité une interrogation de l’esprit, l’incertitude de quelque chose, de quelqu’un, d’une conduite. Il sera dès lors intéressant de se demander s’il est bon de douter, si le doute est-il une force ou une faiblesse.
Tout d’abord, nous évoquerons le doute comme faiblesse de la connaissance, puis comme faiblesse de la volonté. Nous identifierons ensuite les mesures dans lesquelles il est une force, et enfin, nous soulèverons la question morale persistant autour du doute.
I. Le doute est une faiblesse de la connaissance et de la volonté
Le doute est un état de la conscience que nous connaissons tous, peu importe la situation dans laquelle ce doute s’est inscrit. La question n’est pas là, de quelle faiblesse témoigne le doute ? Tout d’abord, le doute peut témoigner d’une faiblesse intellectuelle ou culturelle, entre autres un révélateur d’une imperfection de l’esprit. Illustrons : face à un problème de mathématiques, il n’y a qu’une réponse qui est la bonne, qui témoigne de ce qui est la vérité, un élève incertain de la réponse à ce problème témoigne donc d’une faiblesse. Le doute est incertitude tandis que la vérité est la certitude. La raison n’atteint pas ses objectifs dans le doute, puisque celui qui doute de tout s’inscrit dans une perspective de relativisme.
De plus, le doute entraîne la paralysie de l’action. Il est fréquent que nous n’arrivions pas à faire des choix, ce qui est une faiblesse. Un militaire en mission à l’étranger ne peut pas se permettre de douter face à l’ennemi, car c’est sa vie qui est en jeu. Le doute s’oppose à l’instinct de survie de l’homme dans une certaine mesure. Le doute est une faiblesse de la volonté. Le doute est passif et négatif, car il empêche totalement la prise de décision ainsi que la mise en action de celle-ci. René Descartes exprimait l’idée selon laquelle l’indifférence (entendue ici comme absence de choix) était le plus bas degré de liberté, en ce sens le doute était donc une faiblesse selon lui. Dans les religions dogmatiques d’ailleurs, le doute est souvent perçu comme un « vice » étant donné qu’il est synonyme de remise en question des croyances. Le doute est le produit de l’ignorance, mais peut-être est-ce seulement lorsqu’on subit le doute ?
II. Mais encadré, le doute est une force
En effet, le doute peut être subi ou non, et lorsque l’homme décide de douter, il est possible que finalement cette capacité à douter, que nous ne partageons pas avec les animaux, aille de pair avec la recherche de la vérité, lorsque le doute est encadré par une méthode.
Le doute méthodique est une méthode développée par Descartes dans ses ouvrages majeurs : Les Méditations métaphysiques et le Discours de la méthode . Pour pouvoir concilier quête de la vérité et doute, Descartes a du rendre possible cette association en développant un argumentaire qui remet en cause les fondements mêmes de la connaissance humaine. Il nous explique que nos sens nous trompent, nous sommes en proie aux effets d’optiques par exemple, et que nous pourrions même être en train de rêver en ce moment, en nous rappelant à quel point les rêves paraissent réels lorsque nous les vivons. On pourrait opposer à Descartes que c’est un relativisme des plus extrêmes, que si l’on suit sa pensée nous ne sommes même plus sûrs de l’existence du monde, mais non. Descartes admet que certaines idées résistent au doute. Lorsque nous rêvons, les lois d’arithmétique et de géométrie subsistent. Pour Descartes, un malin génie pourrait également nous pousser à nous tromper sans que nous nous en rendions compte. Finalement, il n’y a qu’une certitude qui ai résisté au doute méthodique de Descartes : la locution latine « cogito ergo sum », littéralement « Je pense, donc je suis ».
De ce doute méthodique, il est, évidemment, une et un exercice judicieux de douter, car cela me permet de me détacher de l’objet de mon étude, de mettre à distance l’adhésion trop ou immédiate, les croyances non vérifiées. Je m’émancipe du monde des apparences est c’est en cela une force, car c’est le doute qui permet l’émergence d’un esprit critique. L’esprit qui est critique n’accepte aucune information sans s’interroger sur sa véracité et sa valeur.
III. La question morale persistant autour du doute
Le doute méthodique est bénéfique, mais l’extension de ce doute à la pratique paralyserait.
Il faut agir même dans l’incertitude, les imprévus font partie intégrante de la condition humaine, et Descartes en avait également conscience. L’application du doute dans le monde des actions n’a donc pas sa place, et Descartes va dresser une morale par provision.
Savoir se délaisser de ce qui n’est pas de notre ressort par exemple, fait partie des vertus pour ne plus subir le doute. Le doute doit être dompté, Descartes pousse à trancher et à agir, ce qui est valorisant du moment que l’on maintient sa fermeté dans ladite décision.
Au terme de ce raisonnement, nous nous sommes rendu compte que le problème n’était pas tellement de trancher et d’affirmer haut et fort que le doute soit une faiblesse ou une force, mais davantage de l’utiliser convenablement. Le doute, lorsqu’il est subi, peut paralyser et témoigner d’un défaut de connaissances, mais lorsque le doute est volontaire, dompté et qu’il s’inscrit dans une morale, il devient l’arme redoutable de l’homme pour s’élever intellectuellement dans sa quête vers la vérité.
Le doute peut-être défini comme un échec de la raison ou comme le moteur de la raison, le tout étant peut-être simplement une affaire de perception ?
Corrigés liés disponibles
Les corrigés similaires disponibles
- Alain, Propos sur les pouvoirs: «Le doute est le sel de l’esprit»
- Baudelaire, Le Spleen de Paris - Portait de maitresse
- L'usage de la raison est-il une garantie contre l'illusion ?
- L'avenir est-il une page blanche ?
- Autrui est-il une condition ou un obstacle à ma liberté ?
Proposez votre corrigé pour ce sujet
Revue pluridisciplinaire d’études médiévales
Accueil Numéros 23 Le doute : introduction
Le doute : introduction
Entrées d’index, mots-clés : , keywords: , texte intégral.
- 1 Sabina Flanagan , Doubt in an Age of Faith: Uncertainty in the Long Twelfth Century , Turnhout, Brepo (...)
- 2 Alexander Murray souligne à ce sujet que « les clercs qui mirent par écrit la plus grande partie de (...)
- 3 Alexander Murray compare à celle de l’âge d’or l’image que nous nous faisons de la foi médiévale, q (...)
- 4 L’« Irruption du doute » est le titre de la cinquième partie de l’ouvrage de Thierry Hentsch, Racon (...)
1 Si le doute semble une notion éminemment moderne, il est indéniable que l’attitude qu’elle conceptualise existait bien avant Montaigne. Ce que la modernité s’est attachée à définir et dont elle a fait son emblème avait ses formes propres au Moyen Âge, qu’il s’agit d’explorer à travers textes, discours, pratiques. Il ne s’agit pas de chercher les prémices d’une attitude vouée à atteindre par la suite son épanouissement. Tout en restant conscients du biais que nous impose notre regard post-moderne, il nous revient de cerner les formes que prenait alors cette posture qui nous est familière. Étudier les formes du doute dans ce qui a pu être défini comme « un âge de la foi » 1 s’avère une attitude féconde pour le chercheur : elle permet à la fois de mettre au jour des attitudes, des discours, des coutumes qu’il ne soupçonnait pas et, de ce fait, de révéler ce qui biaise habituellement notre regard sur le monde médiéval. L’un de ces facteurs est objectif et consiste dans la nature de nos sources : principalement cléricales, elles sont tributaires des conditions dans lesquelles elles ont été produites, et de l’usage qui en était prévu 2 . L’autre facteur est subjectif : bien souvent, à nos yeux, le Moyen Âge représente une parenthèse de foi entre le scepticisme antique – oublié après l’Antiquité et redécouvert au XVI e siècle – et le scepticisme moderne de la Renaissance qui conduira plus tard au doute philosophique de Descartes 3 . Ainsi, entre Pyrrhon et Montaigne, on s’est pendant longtemps limité à tenir pour acquis un silence du doute, pour ensuite constater son « irruption » avec la modernité 4 . L’image même qu’on se fait de la modernité occidentale semble en partie reposer sur la naissance de ce doute post‑médiéval, qui favorise la conceptualisation historique et le compartimentage chronologique. Ne nous sentons‑nous pas les descendants du « Que sais-je ? » de Montaigne, ou de ce François Rabelais qui, couché sur son lit de mort, mande à dire au cardinal Du Bellay « Je vais chercher un grand peut-être » ? La Renaissance serait la rupture. Avec elle, c’est l’irruption du doute. Et, par là, de la modernité.
- 5 Ces dernières années, le doute philosophique médiéval a été le sujet de plusieurs recherches. Cf. D (...)
6 « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » (Matthieu, xiv , 31).
- 7 « Celui qui met en doute que Dieu soit puissant, savant et bon, non seulement il est sans foi, mais (...)
2 Les limites de cette approche sont évidentes et, depuis des années, la critique a enquêté, avec profit, sur ce doute qui assaillait l’homme du Moyen Âge, et qui est surtout, à nos yeux, un élément intrinsèque de la pensée rationnelle 5 . Si les études scientifiques ont tardé à élucider cet aspect pour le Moyen Âge, c’est peut-être dû à la force d’un malentendu. Les siècles précédant la Renaissance ont répété avec force et sans cesse l’idée qu’un certain type de doute était interdit. Il s’agit du doute blasphématoire – prémisse de l’incrédulité – portant sur la personne du Sauveur, doute exprimé, entre autres, dans le fameux verset de l’Évangile « Modice fidei, quare dubitasti ? » 6 . Des siècles plus tard, Jean de Salisbury exprime avec fermeté la profonde aversion médiévale pour le doute concernant les vérités de la foi : « Qui vero an Deus sit deducit in quaestionem et an idem potens, sapiens sit, an bonus, non modo irreligiosus sed perfidus est » 7 .
- 8 Dante , Œuvres complètes , André Pézard (éd. et trad.), Paris, Gallimard, 1965, « Bibliothèque de la (...)
3 Mais, si l’on fait abstraction de l’incrédulité, péché sans possibilité de rémission, le doute, au Moyen Âge, est toujours admis et souvent bénéfique. Chez un grand nombre de penseurs il est considéré comme le début de la connaissance, la première impulsion vers la compréhension du vrai. Dante exprimera cette conviction avec une belle image poétique : « A guise de surgeon / Le doute alors au pied du vrai provigne ; / De puy en puy nature au som nous pousse » 8 .
- 9 « Qui hésite, qui est incertain. Comme devant une bifurcation » ( Isidore de Séville , Etimologie o o (...)
4 Le doute au Moyen Âge a aussi une résonance différente de celle qu’il a aujourd’hui. Pour essayer de la saisir, on peut recourir à la pratique médiévale de l’étymologie. Dans son encyclopédie, Isidore de Séville donne l’étymologie correcte du mot dubius : « Dubius, incertus ; quasi duarum viarum » 9 . L’adjectif dubius et le verbe dubitare dérivent en effet, comme le savait Isidore, de la racine duo , « deux » (nous retrouvons cela aussi en allemand, où le mot zweifeln garde la trace du lien avec zwei , « deux »). Par conséquent, le mot dubitare indique d’abord l’idée de l’hésitation entre deux choses, qu’il s’agisse de deux pensées ou de deux actions. Douter c’est, selon cette image, se trouver devant une bifurcation (« quasi duarum viarum »).
- 10 Cf. Französisches Etymologisches Wörterbuch , Walther von W artburg (dir.), Tübingen, J.C.B. Mohr, 19 (...)
11 Ibid ., p. 170.
- 12 Michel de Montaigne, Les Essais , Pierre Villey (éd.), Paris, PUF, 1992, 3 vol. , vol. 1, livre II, (...)
5 Déjà en latin tardif, un autre sens s’était greffé sur cette acception. Le sentiment d’insécurité et d’incertitude lié à l’hésitation aboutissent au développement du sens de « craindre » 10 . En effet, la première attestation du mot de douter en ancien français a ce sens que le mot perdra ensuite, mais qui perdure dans le verbe redouter , lequel est à l’origine un intensif de douter . Au cours du Moyen Âge, l’acception « craindre » est prédominante par rapport à celles de « hésiter », « être dans l’incertitude » et, bien souvent, il n’est pas aisé de distinguer les deux sens 11 , comme on peut le voir dans certains exemples commentés dans ce bulletin. Il est intéressant de voir que la dernière attestation du sens « craindre » date du début du XVII e siècle. Étrange coïncidence : à la même époque, Descartes invente une formule vouée à une brillante carrière, le doute philosophique , alors que, quelques années auparavant (en 1580), Montaigne avait le premier utilisé le verbe avec le sens de « n’être sûr de rien, professer le scepticisme » : « je doute » 12 .
6 Ce survol étymologique nous montre les échos que le « doute » suscitait en ancien français et nous donne la mesure du clivage qui nous sépare de l’ancienne conception. En ancien et moyen français, le mot avait une gamme de sens plus vaste qu’aujourd’hui. D’abord, il gardait le premier sens de l’étymon latin, « hésiter », qui aujourd’hui n’est plus perçu avec netteté. Mais surtout, douter avait une plus grande intensité émotionnelle en ancien français, car il était intrinsèquement lié au sentiment de la peur. Les évolutions philosophiques de la conceptualisation du doute, bien montrées par Montaigne et Descartes, ont fini par évacuer le sens inquiétant du doute, celui lié à l’affectivité, au profit d’une vision plus philosophique, qui, en fin de compte, est celle qui prévaut dans le sens actuel.
7 Les différents sens de douter au Moyen Âge se retrouvent dans la définition du mot dubitare que Pierre Bersuire donne dans le Repertorium morale (rédigé entre 1335 et 1342), qui nous explique qu’il y a trois types de doute, celui des savants, celui des faibles, celui des désespérés :
13 « Il est clair qu’il y a le doute des savants, le doute des faibles d’esprits, le doute de ceux qui (...) Constat enim quod est dubitatio Sapientum, Imbecillium, Desperantium. Sapientes nihil temere volunt afferere, sed potius volunt negocia prudenter sub quodam dubio palliare. Et de hoc dicit quod dubitare de singulis non est inutile. Imbecilles vero solent, ubi timor non est, trepidare, et nunquam securi esse, sed in omnibus dubitare […]. Desperantes etiam solent dubitare de salute aeterna, non sperare, propter quam solent ad mala omnia se laxare. (Matth 28). Quidam autem dubitaverunt. 13
Peur, hésitation
8 Un certain nombre des aspects évoqués par Bersuire seront abordés dans les différentes contributions de ce bulletin, mais le domaine relatif au doute médiéval est trop vaste pour être épuisé ici. Ainsi qu’on vient de le voir, le réseau sémantique et conceptuel lié au doute ne se superpose pas avec le nôtre. En effet, le doute, au Moyen Âge, est un état d’esprit qui est associé à d’autres sentiments, notamment la peur et l’indécision. Une analyse du doute médiéval doit, nous semble-t-il, tenir compte aussi de cette réalité.
9 Le doute n’est pas séparable de la crainte et de l’hésitation. Si on ne trouve pas d’interventions concernant spécifiquement la crainte, par contre un certain nombre d’exemples du doute-hésitation peuvent être retrouvés dans les contributions à ce bulletin. En effet, l’hésitation a une place prépondérante au théâtre (que l’on pense à l’hésitant par excellence qu’est Hamlet – une autre figure de la modernité), spécialement en relation avec l’artifice du monologue, où souvent le personnage révèle au public ses dilemmes. Mais la littérature elle aussi présente un certain nombre d’hésitations. La plus célèbre est sans doute celle de Lancelot devant la charrette infamante. Les « deux pas » qu’il « demore » sont une hésitation suffisante pour déclencher, par la suite, les remontrances de Guenièvre qui reprochera au chevalier sa peur et son hésitation (les deux sens étant ici contigus) :
14 Chrétien de Troyes , Le Chevalier de la Charrette , Alfred Foulet et Karl David Uitti (éd.), Paris, G (...) « Comant ? Dont n’eüstes vos honte De la charrete et si dotastes ? Molt a grant enviz i montastes Quant vos demorastes deus pas. » 14
15 Ovide , Métamorphoses , lib. VII, v. 719.
- 16 Des réflexions concernant le lexique de la peur dans la lyrique médiévale française se trouvent dan (...)
Si le doute-hésitation est bien attesté par les témoignages littéraires, le doute-crainte est, si l’on veut, consubstantiel à la lyrique médiévale, car l’amour est, bien entendu, l’un des hauts lieux de la peur. C’est une vérité aussi vieille que le monde, les amoureux sont craintifs et les littératures de tous les pays et de toutes les époques en gardent des témoignages. Parmi les plus belles réussites dans la représentation littéraire de cette « peur d’amour », on trouve l’une des perles de la littérature grecque, le fragment de la poétesse Sappho de l’ Ode à une femme aimée . De même, Ovide dira plus tard, dans des vers célèbres, que, quand on est amoureux, on craint toute chose : « cuncta timemus amantes » 15 . La poésie d’amour du Moyen Âge accepte, intègre et peut-être développe encore davantage cette association universelle entre l’amour et la peur. En effet, la crainte et l’hésitation sont des composantes fondamentales de l’amour courtois et l’élan mystique vers la dame est toujours contrebalancé par la peur du refus ou par l’hésitation qui paralyse 16 . Ainsi, Bernard de Ventadour pourra dire que la fin’ amor ne peut pas exister sans la « paor » et la « doptansa » :
17 « Mais vous verrez difficilement un amour parfait, sans peur ni frayeur, puisque l’on craint toujou (...) Mas greu veiretz fin’ amansa ses paor e ses doptansa c’ades tem om vas so c’ama, falhir, per qu’eu no.m aus de parlar enardir. 17
Le doute philosophique : possibilité et critique d’un scepticisme médiéval
- 18 Pour une analyse comparée des données du débat, voir Sabina Flanagan , Doubt in an Age of Faith… , op (...)
10 Un examen des discussions médiévales sur le doute révèle le biais par lequel ce dernier est toujours abordé : la tournure d’esprit des penseurs médiévaux les porte plus à expliquer le phénomène de la croyance – c’est-à-dire de la foi – qu’à adopter une perspective purement épistémologique et profane. L’épistémologie de la croyance se développe cependant avec rigueur et précision, soulevant la question de la distinction à établir entre foi et connaissance 18 .
- 19 Cf. Jean de Salisbury , Policraticus sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum , éd. cit., l (...)
- 20 Voir Charles B oyard , entrée « Medieval Skepticism », in Edward N. Zalta (éd.), The Stanford Encyclo (...)
- 21 Le possible scepticisme de Jean de Salisbury est actuellement étudié par Christophe Grellard (Unive (...)
11 Cependant une approche non-religieuse du doute prévaut chez Jean de Salisbury, dont la pensée est considérée comme la plus proche de l’attitude moderne en matière de doute 19 . Si c’est un fait que le Moyen Âge n’a pas connu de courant sceptique identifiable comme tel 20 , Jean de Salisbury reste un exemple de philosophe ayant développé des arguments de type sceptique 21 . Chez lui et chez les autres penseurs ayant interrogé les arguments hérités de l’Académie, le scepticisme n’est pas vécu ni même pensé sur un mode éthique ou comme conception du monde – à la différence du pyrrhonisme des Anciens. Les réflexions sceptiques ne visent nullement l’ épochê – la suspension du jugement chère aux philosophes antiques – ni la libération par rapport à l’inquiétude philosophique. En effet, la certitude donnée par la foi domine attitudes et modes de pensée, de sorte que le doute n’apparaît que comme un outil épistémologique.
- 22 Le courant pyrrhonien du scepticisme fut pratiquement ignoré jusqu’à la fin du XIII e siècle : les œ (...)
- 23 La Faculté de Théologie de Paris, sous l’autorité d’Étienne Tempier et du conseil de l’Université, (...)
- 24 Il s’agit d’une théorie qui soutient que la raison peut démontrer des vérités contradictoires avec (...)
- 25 Cf. L’Individu au Moyen Âge. Individualisation et individuation avant la modernité , Brigitte Bedos- (...)
- 26 « Once the new material had been sufficiently domesticated such questions were allowed to be debate (...)
12 Les représentants du scepticisme médiéval ont en commun une mise en question de la confiance aristotélicienne en la raison, laquelle, dans la plupart de leurs conclusions, est reconnue incapable de correspondre par ses propres moyens à l’incommensurabilité des vérités éternelles révélées par Dieu. Leur utilisation des arguments sceptiques est difficile à rattacher à la tradition pyrrhonienne, peu connue à l’époque médiévale et surtout biaisée par la présentation qu’en donne Augustin, principale source pour la connaissance de la philosophie antique mais adversaire farouche du scepticisme 22 . Les développements médiévaux sur l’argumentation sceptique sont surtout connus grâce à leur condamnation par la Sorbonne en 1277 23 . À partir du XIV e siècle, les théories s’apparentant à des positions sceptiques, comme celle de la double vérité 24 ou, plus largement, le doute porté sur la garantie divine de la connaissance, s’inscrivent dans le mouvement qui, à la fin du Moyen Âge, voit un recentrement de la pensée sur la perspective individuelle et une promotion de la subjectivité 25 . La réflexion épistémologique prend ses distances par rapport à la caution surnaturelle de la foi et s’autonomise à l’égard de la théologie. Cependant, que ce soit prudence face à l’autorité ecclésiastique ou réaffirmation de la foi personnelle, les penseurs qui développent les arguments sceptiques posent au seuil de toute réflexion philosophique la distinction entre la certitude propre à la foi – non soumise au doute – et la certitude issue de l’évidence naturelle, seul objet de la rationalité naturelle. Par ailleurs – ironie de l’histoire – le doute est à ce point formalisé comme une méthode heuristique qu’il ne portera sur les questions de fond que lorsque les réponses à celles-ci auront été formulées. Comme le souligne Sabina Flanagan, c’est seulement « une fois que le nouveau matériel [aristotélicien] eut été suffisamment domestiqué que de telles questions furent autorisées à être débattues » 26 .
27 Naturel doit ici s’entendre en opposition avec surnaturel , « guidé par une révélation divine ».
- 28 C’est ce paradoxe que développe Lambertus Marie de Rijk, La Philosophie au Moyen Âge , Leyde, E. J. (...)
- 29 Duns Scot (1266-1308) est un frère mineur de l’ordre franciscain, défenseur notamment de l’immaculé (...)
13 Étant sauve la vérité de la Révélation divine, sur laquelle ne porte pas le doute, le questionnement vise les possibilités proprement humaines de la connaissance naturelle 27 . Demeure cependant l’héritage augustinien, qui réfute le scepticisme absolu tout en reprenant le doute comme point de départ épistémologique. La portée du doute est donc d’emblée réduite, chez les penseurs médiévaux, au domaine propre de la connaissance naturelle. Sous la plume des plus exigeants et rigoureux des philosophes, un scepticisme absolu, qui s’étendrait à toute forme de connaissance et de relation au monde, est à rejeter comme signe d’un manque de réflexion critique 28 . L’exigence de rationalité que manifeste un Duns Scot 29 , par exemple, se traduit par le doute épistémologique : mettant en question les prétentions de la raison, il renonce à élaborer une théorie de la connaissance et cherche plutôt à établir fermement les conditions de possibilité de la certitude épistémologique. Son analyse métaphysique des structures de la connaissance humaine le conduit ainsi à réduire d’abord la certitude proprement rationnelle à quelques principes logiques évidents. Son rejet, cependant, d’un scepticisme absolu, qui nierait la possibilité même de toute connaissance, reste une posture a priori . La réflexion de Duns Scot est caractéristique de cette auto-limitation de la pensée médiévale au doute épistémologique, sans préjudice des certitudes d’une autre nature – comme celle apportée par l’expérience. De manière générale, l’usage que les penseurs médiévaux font du doute rationnel ne leur fait pas emprunter les mêmes voies que leurs prédécesseurs antiques. Le scepticisme médiéval est constitué d’une série de préoccupations et de réponses apportées aux problèmes sceptiques. Plutôt que de scepticisme, Lambertus Marie de Rijk propose donc de parler d’un « criticisme radical », qui limite toutes les certitudes apparentes pour donner plus de poids aux certitudes réelles – celles garanties par la Révélation d’un Dieu dont la rationalité est plus fiable que celle de l’esprit humain. Les théories critiques les plus extrêmes constituent une opposition entre vérité et probabilité, entre vérité et évidence naturelle. La Révélation divine, d’emblée reçue comme vraie et, partant, non soumise au doute, bouleverse la raison naturelle qui se voit alors poser des limites. Le doute porte alors non pas sur la possibilité de la connaissance mais sur les conditions de possibilités de cette connaissance – ou mieux, sur la mesure de cette connaissance humaine, eu égard à l’inaccessibilité des vérités suprêmes à la raison naturelle.
Théâtre et théologie : le doute intégré
- 30 L’œuvre de Mikhaïl Bakhtine à ce sujet reste décisive (Mikhaïl Bakhtine , L’ œ uvre de François Rabela (...)
- 31 Voir à ce sujet Jean-Marie Fritz , Le Discours du Fou au Moyen Âge , Grenoble, Presses Universitaires (...)
14 Le théâtre, forme libre s’il en est au Moyen Âge, offre un terrain privilégié à l’expression littéraire et populaire du doute. À l’intérieur du vaste champ étudié sous l’image englobante du carnaval 30 , les figures de la folie 31 , de l’étrange, de l’autre, offrent au chercheur moderne des formes originales d’expression du doute à l’intérieur d’une société d’ordre et d’une culture fondée sur la foi. Le Jeu de la Feuillée d’Adam de la Halle est à cet égard l’une des œuvres les plus étranges et insaisissables que le Moyen Âge oppose à notre regard moderne, au rationalisme qui prévaut jusque dans les études littéraires. Antérieures à l’âge des règles et de la bienséance, les pièces médiévales ouvrent à l’expression populaire – parfois jusque dans les sanctuaires – un champ de liberté qui, même sous le contrôle du clergé, atteste de l’acceptation du doute dans l’espace public et sacré.
- 32 Cf. Ludus Coventriae, or The plaie called Corpus Christi , Katherine Salter Block (éd.) Londres, Oxf (...)
- 33 Alexander Murray , Doubting Thomas in Medieval Exegesis and Art , Rome, Unione Internazionale degli i (...)
15 Les mystères – étudiés dans deux des communications de ce bulletin – illustrent les paradoxes d’une foi qui se proclame et se met en question dans la double énonciation de la scène théâtrale. La figure de l’apôtre Thomas pourrait résumer à elle seule les attitudes contrastées qu’adopte l’homme médiéval en proie au doute. Férus d’étymologie, les théologiens médiévaux (Bède le Vénérable, Théophylacte d’Odred) ont parfois interprété la personnalité de Thomas à partir de son nom – qui en araméen signifie « le double », ou « le jumeau » – pour expliquer son hésitation, son oscillation entre un doute qui fait de lui un personnage dur et une foi aussi soudaine que sublime qui l’élève au dessus des autres apôtres. Le théâtre devait donner à ces spéculations une incarnation saisissante, à en croire les pièces anglaises qui nous sont conservées 32 : elles font monter sur la scène un personnage solitaire et tourmenté, préfiguration d’Hamlet qui donne à entendre, dans un long monologue introspectif, les doutes qui l’assaillent et l’isolent du groupe des apôtres. À travers l’apôtre du doute, le Moyen Âge s’offre sous plusieurs visages. Iconographie, théologie, art dramatique laissent planer sur lui une ombre – « the ghost », selon le mot d’Alexander Murray 33 – qui semble être ce « péché originel » du doute. Les fluctuations de fortune qu’a connu le personnage de Thomas au cours du Moyen Âge soulignent la méfiance fondamentale que nourrit « l’âge de la foi » envers tout ce qui ébranle les fondements de sa pensée et de sa conception du monde. Cependant, les justifications théologiques du doute de Thomas témoignent d’un effort de rationalisation qui a poussé les théologiens à justifier une attitude que leur foi, notamment celle enseignée par les Pères de l’Église, ces autorités indépassables, considérait comme inacceptable. C’est enfin l’évolution ultime de la piété chrétienne aux XIV e et XV e siècles qui a redonné au doute une valeur, en en faisant l’une des formes du désir de Dieu.
1 Sabina Flanagan , Doubt in an Age of Faith: Uncertainty in the Long Twelfth Century , Turnhout, Brepols, « Disputatio », 17, 2008, p. 2‑3. Voir également, du même auteur, « Lexicographic and Syntactic Explorations of Doubt in Twelfth-Century Latin Texts », Journal of Medieval History , 27 (2001), p. 219‑240.
2 Alexander Murray souligne à ce sujet que « les clercs qui mirent par écrit la plus grande partie de cette masse de [preuves] étaient loin d’avoir pour tâche de consigner scrupuleusement les croyances religieuses de leur monde pour notre profit : il existe un élément de propagande dans une grande partie de ce qu’ils ont écrit. Si l’on se représente, en même temps, qu’il existe très peu de preuves, même à l’intérieur de ces sources, des croyances religieuses en vigueur dans la population, il faut reconnaître que l’expression “âge de la foi” repose sur de bien faibles bases » (Alexander Murray , Reason and Society in the Middle Ages , Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 6. Nous traduisons).
3 Alexander Murray compare à celle de l’âge d’or l’image que nous nous faisons de la foi médiévale, qui « remplit une fonction psychologique pour nous : elle est ou bien la base d’une critique nostalgique de l’irréligion actuelle, ou, en sens opposé, un moyen de désavouer du même coup le passé et la religion » (Alexander Murray , Reason and Society in the Middle Ages , op. cit. , p. 6. Nous traduisons).
4 L’« Irruption du doute » est le titre de la cinquième partie de l’ouvrage de Thierry Hentsch, Raconter et mourir. L’Occident et ses grands récits , Rosny-sous-Bois, Bréal, 2002, p. 327‑415. On y trouve des chapitres consacrés à Rabelais, Cervantès, Shakespeare et Descartes.
5 Ces dernières années, le doute philosophique médiéval a été le sujet de plusieurs recherches. Cf. Dominik Perler , Zweifel und Gewissheit. Skeptische Debatten im Mittelalter , Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 2006 ; Sabina Flanagan , « Lexicographic and Syntactic Explorations of Doubt… », art. cit. ; Peter Dinzelbacher , Unglaube im « Zeitalter des Glaubens ». Atheismus und Skeptizismus im Mittelalter , Badenweiler, Wissenschaftlicher Verlag Bachmann, 2009; Rethinking the History of Skepticism. The Missing Medieval Background , Henrik Lagerlund (dir.), Leyde/Boston, E. J. Brill, 2010.
7 « Celui qui met en doute que Dieu soit puissant, savant et bon, non seulement il est sans foi, mais il est aussi perfide » ( Jean de Salisbury , Policraticus sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum , Clemens C. I. Webb (éd.) , Oxford, 1909, livre VII, ch. 8. Nous traduisons).
8 Dante , Œuvres complètes , André Pézard (éd. et trad.), Paris, Gallimard, 1965, « Bibliothèque de la Pléiade », 182, p. 1393, v. 130‑132. Dans la note relative au v. 131, André Pézard glose : « Le doute : entendre ici “le besoin de savoir des vérités nouvelles” ». Le mot italien est, bien entendu, « dubbio ».
9 « Qui hésite, qui est incertain. Comme devant une bifurcation » ( Isidore de Séville , Etimologie o origini , Angelo Valastro Canale (éd.), Turin, Utet, 2004, l, X, 77, p. 810. Nous traduisons).
10 Cf. Französisches Etymologisches Wörterbuch , Walther von W artburg (dir.), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1949, III, entrée « douter », p. 169‑170.
12 Michel de Montaigne, Les Essais , Pierre Villey (éd.), Paris, PUF, 1992, 3 vol. , vol. 1, livre II, chap. XII « Apologie de Raimond Sebond », p. 502 et 527.
13 « Il est clair qu’il y a le doute des savants, le doute des faibles d’esprits, le doute de ceux qui désespèrent. Les savants ne veulent pas argumenter au hasard, ils veulent plutôt prudemment envelopper leurs pensées par un certain doute. Et pour cela, on dit qu’il n’est pas inutile de douter de chaque chose. Les faibles d’esprit ont coutume de trembler là où la crainte n’a pas raison d’être, de ne jamais être sûrs et de douter de toute chose. […] Ceux qui désespèrent doutent du salut éternel et pour cette raison ils s’abandonnent à tous les maux. Matthieu, xxviii , “quelques-uns eurent des doutes” » (Pierre Bersuire , Dictionarii seu Repertorii moralis Petri Berchorii Pictaviensis Pars prima (-Pars tertia) , Venetis, Apud Haeredem Hyeronymi Scoti, 1583, 3 tomes, t. I, p. 512. Nous traduisons).
14 Chrétien de Troyes , Le Chevalier de la Charrette , Alfred Foulet et Karl David Uitti (éd.), Paris, Garnier, 2010, v. 347‑368 et v. 4502‑4503. Ces deux derniers vers ne se retrouvent pas dans la copie de Guiot, et par conséquent on ne peut pas les lire – malgré leur importance pour la compréhension du passage – dans plusieurs éditions modernes du texte. Ils ont été le prétexte d’une controverse, qui a porté sur la manière d’éditer Chrétien de Troyes : cf. Eugène Vinaver , « Les Deux Pas de Lancelot », in Mélanges Jean Fourquet , Paul V ALENTIN et Georges Z ink (éd.), Munich/Paris, Hüber/Klincksieck, 1969, p. 335‑351 ; Karl David Uitti , « On editing Chrétien de Troyes : Lancelot’s Two Steps and their Context », Speculum , LXIII (1988), p. 271‑292 ; David F. Hult , « Steps Forward and Their Context : More on Chrétien’s Lancelot », Speculum , LXIV (1989), p. 307‑316.
16 Des réflexions concernant le lexique de la peur dans la lyrique médiévale française se trouvent dans Georges Lavis , L’Expression de l’affectivité dans la poésie lyrique française du Moyen Âge (XII e -XIII e siècles). Étude sémantique et stylistique du réseau lexical joie-dolor, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 94‑113 et dans Glynnis M. Cropp , Le Vocabulaire courtois des troubadours de l’époque classique , Genève, Droz, 1975, « PRF », 135, p. 200‑203.
17 « Mais vous verrez difficilement un amour parfait, sans peur ni frayeur, puisque l’on craint toujours de commettre une faute à l’égard de celle que l’on aime ; je n’ai donc pas le courage d’oser parler » ( Bernard de Ventadour , Ab joi mou lo vers e·l comens , v. 13‑16, cité et traduit par Glynnis M. Cropp , Le Vocabulaire courtois…, op. cit. , p. 200). On peut lire ce poème dans plusieurs éditions et anthologies. Nous signalons Los trovadores. Historia literaria y textos , Martín de Riquer (éd.), Barcelona, Ariel, 1992, 3 vol. , vol. 1, p. 392.
18 Pour une analyse comparée des données du débat, voir Sabina Flanagan , Doubt in an Age of Faith… , op. cit. , ch. 4, p. 91‑155. Elle expose les réflexions de Baldwin de Forde ( De Commendatione Fidei ), selon qui la foi peut être définie comme une connaissance, d’Abélard ( Theologia ‘scholarium’ ) et d’Hugues de Saint-Victor ( De Sacramentis ) – chez lequel elle discerne une forme d’analyse du langage ordinaire (« “common language” methodology »). Le point commun de ces penseurs est la position suivante : puisque la foi est un type de certitude – quelle que soit sa relation avec la connaissance – alors le doute n’y a pas sa place. De plus, là où le doute peut admettre plusieurs degrés, la foi ne le peut pas. Foi et doute ne sont donc pas des contraires – ce que montre, commente Sabina Flanagan, leur situation respective sur le continuum du doute.
19 Cf. Jean de Salisbury , Policraticus sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum , éd. cit., lib. VII, ch. 2, II, 98-99 : « sunt autem dubitabilia sapienti quae nec fidei nec sensus aut rationis manifestae persuadet auctoritas et quae suis in utramque nituntur firmamentis » (« Il existe cependant des objets de doute pour le sage, que ne résout l’autorité ni de la foi, ni des sens ou de la raison manifeste et dont chacune des deux explications possibles s’appuie sur une preuve solide ». Nous traduisons). Parmi ces questions se trouvent celles « que l’on peut poser en toute piété au sujet de Dieu lui-même qui dépasse la capacité d’investigation de toute nature rationnelle » (« quae pie quaeruntur de ipso Deo qui totius naturae rationalis excedit inuestigationem ». Nous traduisons). Cependant, mettre en doute l’existence de Dieu reste irréligieux, et même « perfidus » (ch. 3).
20 Voir Charles B oyard , entrée « Medieval Skepticism », in Edward N. Zalta (éd.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition) , http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/skepticism-medieval/ . Une abondante bibliographie donne les sources médiévales et les travaux critiques les plus récents.
21 Le possible scepticisme de Jean de Salisbury est actuellement étudié par Christophe Grellard (Université de Paris I), qui prépare un ouvrage sur Le Problème sceptique au Moyen Âge, de saint Augustin à Jean Buridan ; il entend y montrer – à la suite de ses articles déjà parus – comment Jean de Salisbury ne se contente pas d’un doute épistémologique mais étend le scepticisme au domaine éthique, considérant la philosophie comme un mode de vie et faisant ouvertement profession de scepticisme. Voir aussi Christophe Grellard « Comment peut-on se fier à l’expérience ? Esquisse d’une typologie des réponses médiévales au scepticisme », Quaestio , 4 (2004), p. 113‑135 et « Jean de Salisbury. Un cas médiéval de scepticisme », Freiburg Zeitschrift für Theologie und Philosophie , 54 (2007), p. 16‑40.
22 Le courant pyrrhonien du scepticisme fut pratiquement ignoré jusqu’à la fin du XIII e siècle : les œuvres de Sextus Empiricus, comme celles de Diogène Laërce, connaissaient une très faible diffusion. On relève une connaissance partielle de la philosophie sceptique grecque chez Bède, Raban Maure et dans l’Orient byzantin et musulman. En revanche, le scepticisme académique avait été transmis, notamment par le commentaire d’Augustin aux Académiques de Cicéron (le Contra Academicos en est une réfutation).
23 La Faculté de Théologie de Paris, sous l’autorité d’Étienne Tempier et du conseil de l’Université, condamna alors 219 thèses jugées inacceptables en philosophie et théologie et donc exclues de l’enseignement universitaire. Voir Roland Hissette , Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277 , Louvain/Paris, Publications universitaires/Vander-Oyez, « Philosophes médiévaux », 22, 1977.
24 Il s’agit d’une théorie qui soutient que la raison peut démontrer des vérités contradictoires avec celles établies par la Révélation. Cependant, sa plus complète élaboration est celle présentée par la censure de 1277 et par les réfutations de Thomas d’Aquin. De la sorte, il est difficile de savoir si cette théorie a réellement été professée ou si elle a été constituée comme théorie seulement par les censeurs de la Sorbonne. Elle pourrait être illustrée par des philosophes comme Nicolas d’Autrecourt ou Jean Buridan, au XIV e siècle, qui admettent la possibilité de soutenir des thèses « probables » – de probabilis , « démontrable » – en désaccord avec les vérités de la foi.
25 Cf. L’Individu au Moyen Âge. Individualisation et individuation avant la modernité , Brigitte Bedos-Rezak et Dominique Iogna-Prat (dir.), Paris, Aubier, 2005.
26 « Once the new material had been sufficiently domesticated such questions were allowed to be debated » (Sabina Flanagan, Doubt in an Age of Faith… , op. cit. , p. 155).
28 C’est ce paradoxe que développe Lambertus Marie de Rijk, La Philosophie au Moyen Âge , Leyde, E. J. Brill, 1985, p. 215.
29 Duns Scot (1266-1308) est un frère mineur de l’ordre franciscain, défenseur notamment de l’immaculée conception de Marie. Sa béatification par l’Église catholique est le signe d’une reconnaissance par l’institution religieuse d’une pensée dont les exigences proprement rationnelles ne mettent pas en danger la foi.
30 L’œuvre de Mikhaïl Bakhtine à ce sujet reste décisive (Mikhaïl Bakhtine , L’ œ uvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance , Andrée Robel (trad .), Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 68, 1970 [1 ère éd. russe 1965]).
31 Voir à ce sujet Jean-Marie Fritz , Le Discours du Fou au Moyen Âge , Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1992 (en particulier le chapitre XV sur la théâtralité).
32 Cf. Ludus Coventriae, or The plaie called Corpus Christi , Katherine Salter Block (éd.) Londres, Oxford University Press, « Early English Texts Society », 120, 1922; Thomas of India , in The Wakefield mystery plays , Martial Rose (éd.), New York, Doubleday, 1962.
33 Alexander Murray , Doubting Thomas in Medieval Exegesis and Art , Rome, Unione Internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in Roma, 2006, p. 45 et sqq .
Pour citer cet article
Référence papier.
Servane Michel et Francesco Montorsi , « Le doute : introduction » , Questes , 23 | 2012, 8-21.
Référence électronique
Servane Michel et Francesco Montorsi , « Le doute : introduction » , Questes [En ligne], 23 | 2012, mis en ligne le 01 janvier 2014 , consulté le 26 mai 2024 . URL : http://journals.openedition.org/questes/898 ; DOI : https://doi.org/10.4000/questes.898
Servane Michel
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Articles du même auteur
- Le doute : éléments bibliographiques [Texte intégral] Paru dans Questes , 23 | 2012
- Le doute : conclusion [Texte intégral] Paru dans Questes , 23 | 2012
- L’impossible identité narrative de Claudas, l’admirable méchant du Lancelot en prose [Texte intégral] Paru dans Questes , 24 | 2012
Francesco Montorsi
Université Paris-Sorbonne (Paris IV) / Université de Göttingen
- Quelques pistes de réflexion pour une étude scatologique [Texte intégral] Paru dans Questes , 21 | 2011
Droits d’auteur
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
- Index géographique
Numéros en texte intégral
- 2023 44 | 45 | 46 | Journée d'études - Visible, invisible | 47
- 2022 Journée d'étude 1 - Trier, classer, organiser
- 2021 42 | 43
- 2019 40 | 41
- 2018 37 | 38 | 39
- 2017 35 | 36
- 2016 32 | 33 | Numéro spécial | 34
- 2015 29 | 30 | 31
- 2014 27 | 28
- 2013 25 | 26
- 2012 23 | 24
- 2011 20 | 21 | 22
- 2010 18 | 19
- 2009 16 | 17
- 2008 13 | 14 | 15
- 2007 11 | 12
- 2006 8 | 9 | 10
- 2004 6 | 7
- 2003 3 | 5 | 4
- 2002 1 | 2
Tous les numéros
- À propos de la revue / About the journal
- Comité scientifique
- Comité de lecture
- Soumettre un article
- Adhérer à l'association
Informations
- Contacts et crédits
- Politiques de publication
Suivez-nous
Lettres d’information
- La Lettre d’OpenEdition
Affiliations/partenaires

ISSN électronique 2109-9472
Voir la notice dans le catalogue OpenEdition
Plan du site – Contacts et crédits – Flux de syndication
Politique de confidentialité – Gestion des cookies – Signaler un problème
Nous adhérons à OpenEdition Journals – Édité avec Lodel – Accès réservé
Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search
- Archives du BAC (43 531)
- Art (11 061)
- Biographies (6 177)
- Divers (47 455)
- Histoire et Géographie (17 971)
- Littérature (30 273)
- Loisirs et Sports (3 295)
- Monde du Travail (32 158)
- Philosophie (9 544)
- Politique et International (18 653)
- Psychologie (2 956)
- Rapports de Stage (6 975)
- Religion et Spiritualité (1 441)
- Sante et Culture (6 435)
- Sciences Economiques et Sociales (23 576)
- Sciences et Technologies (11 297)
- Société (10 929)
- Page d'accueil
- / Fiche de Cours
Le doute en philosophie
Par Helia Karimi • 9 Février 2022 • Cours • 1 826 Mots (8 Pages) • 2 952 Vues
Peut-on douter de tout ?
Dans nos jours, douter dans n’importe quel sujet est devenue une action normale, Douter veut dire qu’en raison de l’incertitude et manque de confiance, on commence à remettre en question une vérité ou un savoir ou quoi qu’il en soit, même au quotidien, notre question par rapport aux nouvelles qu’on a acquis, commence toujours par la phrase est-il vrai, est-ce que c’est vrai, c’est à ce moment qu’on se demande une justification pour ce que l’on vient d’acquérir ou d’entendre.
Dans la nature de l’être humaine c’est toujours normal de ne pas avoir confiance en quelque chose immédiatement. En plus la doute est l’un des pouvoirs à la fois morale et rationnelle de l’homme, en revanche cette question vient à l’esprit : est-il raisonnable de douter de tout ?
On peut douter de tout et de tout. Votre existence même peut être mise en doute ainsi que votre mort. Certains scientifiques pensent que toute l'existence est une simulation menée par une société beaucoup plus avancée. Le fait que tout dans notre univers, y compris le temps, soit divisé en très petits morceaux, conduisent certains à croire que notre existence peut être rendue irréellement, ce qui signifie que vous n'êtes pas vraiment vivant et que vous ne pouvez pas vraiment mourir par ce que vous faites en fait partie d’une simulation par ordinateur. Tout peut être mis en doute.
Il y a des gens qui doutent que la terre soit ronde. Il y a des gens qui doutent que nous ayons atterri sur la lune. Il y a des gens qui doutent que la grande barrière de corail soit en danger. Il y a des gens qui doutent que les émissions de carbone de l'industrie moderne soient nocives pour l'environnement. Ce sont tous des faits scientifiquement vérifiables avec beaucoup de données et de preuves à l'appui, et les gens en doutent encore .
Le doute est un sujet célèbre qui a été observé par la majorité de philosophes telles que Descartes, Kant, Socrate, etc.
Dans un premier temps nous inspecterons l’idée de doute dans des opinions communes, ensuite nous étudierons le point de vue des différentes philosophes, pour enfin nous verrons que le doute n’est pas une chose infinie.
- L’idée du doute dans l’opinion commune
Pour l’opinion commune, douter c’est le doute en tous ce qu’on sait, quand on parle du savoir notre but c’est savoir par exemple la façon de construction un objet, etc. en plus le savoir est égal croire. On peut avoir la croyance qu’on sait tandis que on ne sait rien comme le dit Socrate qu’il sait qu’il ne sait rien mais il se trouve des personnes qui ne sont pas conscience dans leur ignorance c’est à ce moment-là que Socrate précise que c’est mieux d’avoir le doute de notre savoir afin d’arriver à une certitude et douter est un devoir pour l’homme qui ne cause que le progrès. En réalité c’est en ayant le doute et en remettant en question que la science d’aujourd’hui a fait beaucoup de progrès. On doute afin d’aller plus loin et chercher plus loin dans le but de trouver la vérité.
D’autre part si on n’essaye pas de douter, et de croire tout ce qui est autour de nous et d’accepter tous les opinions sans être certain et sûr comme accepter que ce soit impossible de trouver un vaccin pour lutter contre le coronavirus, nous mets dans une situation dans laquelle on ne profite d’aucune liberté de pensée. Il y a donc cette possibilité qu'on se demande si l'on doute d'un avis et ne l'accepte pas, on serait rejeté par la société, si l'on doute du fait de l'impossibilité d'inventer un vaccin pour lutter contre le coronavirus, on serait rejetés par société qui n'accepte pas ce doute ? dans plusieurs cas on ne sera pas rejeté mais si on était rejeté par notre société, il serait mieux de douter qu’agir et penser comme les autres et mettre un obstacle contre la liberté de notre pensée.
Les philosophes ont différentes thèses par rapport à l’idée du doute.
- L’idée du doute chez différentes philosophes
- L’idée cartésien de Descartes
Descartes est l’un des philosophes qui commence à douter en tous ce qui est autour de lui, même dans son existence . Pour atteindre certaines connaissances, Descartes s'est d'abord demandé : Y va-t-il un principe fondamental sur lequel nous pouvons fonder toutes les connaissances et la philosophie et ne peut être mis en doute ? La manière que Descartes semblait faire à cet effet était de douter de tout. Il voulait tout recommencer, alors il avait besoin de reconsidérer tout ce qu'il savait y compris les 5 sens (la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher.) c’est le point de départ de Descartes afin de commencer son doute qui a été nommé dans un peu de temps le doute cartésien. Il répandit ce doute sur tout ; Dans la mesure où il doutait aussi de l'existence du monde extérieur et disait : Comment savoir que je ne dors pas ? Ce n'est peut-être pas ce que je ressens, ce que je pense ou ce qu'on m'a dit, et tout cela n'est que pure fantaisie, comme ce qui m'arrive dans le monde des rêves. Peut-être que le diable maléfique me trompe et me montre le monde de cette manière ?
En réalité dans le doute cartésien toute croyance dont on n'est pas complètement certain est considérée comme une erreur. Cette méthode du doute exige que nous supposions que toutes nos anciennes croyances étaient fausses. Nous devons simplement croire en quelque chose dont nous sommes absolument sûrs et le moindre doute sur son exactitude suffit à le mettre de côté.
En un mot la doute de Descartes est un doute qui invite les gens à remettre en question tous les chose que l’on connaît déjà et en doutant on a tenté à chercher la certitude.

« Tous les Évènements
- Cet évènement est passé
L’ART DU DOUTE – l’importance du doute en philosophie
Conférence par eric lowen, directeur de l'upp, 25 avril 2021 de 18:00 à 20:00.

Conférence de soutien à l’UPP en visioconférence sur Zoom, vous recevrez le lien de participation après le règlement.
Inscription à l’unité : 10€
- Google Agenda
- Outlook 365
- Outlook Live
Organisateur
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
Exemple de dissertation de philosophie
Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.
Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac).
Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d’une dissertation de philosophie , ainsi que la méthode utilisée.
Conseil Avant de rendre votre dissertation de philosophie, relisez et corrigez les fautes. Elles comptent dans votre note finale.
Table des matières
Exemple de dissertation de philosophie sur le travail (1), exemple de dissertation de philosophie sur le concept de liberté (2), exemple de dissertation de philosophie sur l’art (3).
Sujet de la dissertation de philosophie : « Le travail n’est-il qu’une contrainte ? ».
Il s’agit d’une dissertation de philosophie qui porte sur le concept de « travail » et qui le questionne avec la problématique « est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? ».
Télécharger l’exemple de dissertation de philosophie
Reformuler des textes efficacement
Reformulez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre outil de paraphrase gratuit.
Reformuler un texte gratuitement
Sujet de la dissertation de philosophie : « Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ? ».
Cette dissertation de philosophie sur la liberté interroge la nature de l’Homme. La problématique de la dissertation est « l’’Homme est-il un être libre capable de faire des choix rationnels ou est-il esclave de lui-même et de ses désirs ? ».
Sujet de la dissertation de philosophie : « En quoi peut-on dire que l’objet ordinaire diffère de l’oeuvre d’art ? ».
Cette dissertation sur l’art et la technique se demande si l’on peut désigner la création artistique comme l’autre de la production technique ou si ces deux mécanismes se distinguent ?
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation de philosophie. Scribbr. Consulté le 26 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-philosophie/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation juridique, la méthode de la dissertation de philosophie , plan d'une dissertation de philosophie.
Apprendre la philosophie
Découvrir la philosophie pas à pas
Réussir l’accroche de votre dissertation de philosophie
Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂
Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂
L’objectif de l’accroche en philosophie est d’introduire non seulement le sujet, mais surtout le problème que pose le sujet. Une mauvaise façon de commencer une introduction est sans doute de commencer par une liste de définitions des termes du sujet.
Commencer à définir les termes du sujet est évidemment nécessaire dans l’introduction. Néanmoins il est beaucoup plus habile et intéressant d’utiliser ces définitions pour justifier des réponses possibles au sujet. Je vous renvoie sur cette question à la vidéo où j’ai expliqué comment analyser le sujet et formuler la problématique dans l’introduction de votre dissertation. Le lien apparaît en haut à droite. Par ailleurs si vous voulez une méthode complète pour réussir votre dissertation, vous pouvez réclamer ma méthode en suivant le lien ci-dessous dans la description.
Ceci étant dit : Une autre erreur courante consiste à faire une accroche qui introduit la notion générale du sujet mais pas ce sujet en particulier. Par exemple, si vous avez un sujet tel que « Le bonheur dépend-il de nous ? », si vous faites une accroche qui parle simplement du bonheur ou qui définit le bonheur sans répondre au sujet précisément alors vous n’introduisez pas vraiment ce sujet mais la notion de bonheur en général.
Pour que votre accroche introduise vraiment le sujet qui vous est donné, il faut qu’elle permette d’entrevoir une première réponse au sujet . Si on prend le sujet « le bonheur dépend il de nous ? », votre accroche peut consister en un exemple qui vous permet de faire une première hypothèse. Par exemple que le bonheur dépend de nous.
C’est encore mieux si après cette première réponse rapide vous pouvez commencer à montrer le problème et en émettant un doute sur cette première réponse. Par exemple en posant une question qui suggère que la thèse adverse pourrait également être défendue.
Deux manières différentes de faire une bonne accroche pour votre introduction de philosophie.
Une 1er façon : consiste à Utiliser une citation : Il est déconseillé d’utiliser des auteurs dans l’introduction car l’introduction est plutôt le moment où vous devez définir les termes et montrer le problème du sujet de manière générale. Néanmoins, il y a une exception à cette règle, vous pouvez utiliser un auteur en accroche en le citant puis en expliquant la citation afin de montrer comment elle pourrait répondre au sujet.
Cette façon de faire est la plus difficile car il est assez rare surtout quand le programme est très varié d’avoir exactement la citation qui va coller au sujet. Cela implique d’avoir appris des citations par coeur et le risque va être de vouloir absolument utiliser une des citations connues même si elle ne correspond pas exactement au sujet. Il est donc préférable de vraiment s’assurer que votre citation peut être une réponse au sujet et si tel n’est pas le cas, envisagez plutôt d’utiliser un exemple. Commencer son devoir par une citation hors sujet est plutôt contreproductif.
Pour que cela soit bien clair, je vais vous donner un exemple d’accroche avec une citation sur le sujet « Le bonheur dépend-il de nous ? » :
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu’ils portent sur les choses ». Epictète,stoïcien né en 50 après J-C, défend ici que ce qui affecte les hommes et peut les rendre malheureux, ce ne sont finalement pas les événements eux-mêmes, mais la manière dont ils jugent ces événements. Ce faisant, il semble défendre que le bonheur est bien quelque chose qui dépend de nous, puisqu’il dépend de nos jugements. Mais peut-on réellement défendre que notre bonheur dépend seulement de nos jugements sur les événements et sur notre vie ?
L’accroche permet ici de donner une première réponse au sujet et elle introduit le problème en esquissant une objection dans un deuxième temps. A la suite de cela, vous pouvez rappeler le sujet et formuler la problématique puis énoncer votre plan.
– La 2e façon de faire une accroche consiste à Utiliser un exemple et à montrer en quoi il permet de donner une première réponse au sujet. Cet exemple peut être un exemple de la vie quotidienne mais évidement des exemples plus recherchés seront valorisés. Vous pouvez par exemple prendre des exemples littéraires si le sujet porte sur la liberté, la morale, le bonheur… ou des exemples plus politiques sur les sujets portant sur l’Etat ou la justice et le droit. Des exemples plus scientifiques seront valorisés si le sujet porte sur la Vérité ou sur les sciences.
Si on compare l’accroche citation et l’accroche exemple, l’accroche exemple est sans doute une manière plus simple de procéder, car si vous n’avez pas d’exemple il est toujours possible d’en inventer un. L’essentiel est de prendre un exemple qui vous permet de donner une première réponse au sujet puis d’envisager une objection afin de montrer que le sujet va faire débat. En d’autres termes qu’il pose un problème qu’il vous faudra discuter pendant tout votre devoir.
Pour finir je vais vous donner un Exemple d’accroche utilisant un exemple avec le sujet « La recherche du bonheur peut-elle être un devoir ? » :
Dans la tragédie Le Cid de Corneille, le personnage principal Don Rodrigue est face à un dilemme : choisir entre son devoir de sauvegarder l’honneur de sa famille et le fait de poursuivre son bonheur. Il choisit finalement de faire son devoir en tuant le père de Chimène mais renonce alors à son bonheur. Nous pouvons remarquer que dans Cette histoire, rechercher le bonheur n’est pas un devoir et même qu’au contraire faire son devoir va être plutôt un obstacle à la recherche du bonheur. Pourtant, faut-il toujours opposer la recherche du bonheur et le devoir ?
Voilà pour cette vidéo sur l’accroche j’espère qu’elle vous aidera à bien commencer votre dissertation. Pour davantage de conseils sur la méthode de la dissertation, vous pouvez en trouver sur la page Méthode de ce blog , ou en demandant mon ebook ci-dessous.
Articles similaires
Laissez un commentaire annuler la réponse..
Tu n'as plus assez de jetons pour télécharger ce document !

Pour gagner des jetons
- Envoie-nous un document ! +20 Envoyer
- Poste un commentaire de qualité ! +5
- Test d'orientation
- Obtiens ton code de la route
- Tout savoir sur Parcoursup
- Inscription
Dissertation : La recherche de la vérité peut-elle se passer du doute ? 17.00 / 20
Corrigé bac : la recherche de la vérité peut-elle se passer du doute , plan annale : la recherche de la vérité peut-elle se passer du doute .
- le doute est nécessaire : Il permet de rechercher la vérité en se basant sur ce qui nous semble solide.
- le doute ne doit pas être constamment mobilisé : Dans le cas contraire, il viendrait à entraver notre recherche de la vérité.
- le doute doit rester à sa place : Mais il ne doit pas autant cesser d’exister.
Noter ce document

Contenu de ce document de Social > Philosophie
La recherche de la vérité peut-elle se passer du doute .

Documents similaires

Je vous propose une dissertation sur la poésie et les sentiments personnels, ce sont des thèmes qui ont de grandes chances de tomber lors d'examens, c'e ...
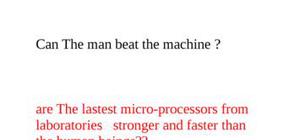
Lors des examens, le thème de la vérité est souvent abordé, tant de questions subsistent ! On vou propose donc un document vous expliquant la vérité, pourquoi ...

Extrait / Introduction : ...
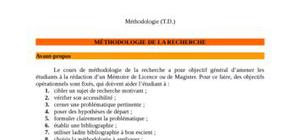
12 commentaires pour ce document
12 commentaires.
bien organisé, ce travail! bravo
tres bonne approche facilemen assimilable
BON DOCUMENT
Très intéressant
je trouve ce document intéressant Merci
bonne dissertation, bien construite.
ette dissert est vraiment intéressante ! Elle servira à beaucoup de monde à mon humble avis ;) Merci pour ce doc. Je me souviens encore quand j'avais passé le bac, pfiou ça fait tellement longtemps ! J'en avais bavé avec la philo ! Mais bon c'était très intéressant
Cette dissert est vraiment intéressante ! Elle servira à beaucoup de monde à mon humble avis ;) Merci pour ce doc. Je me souviens encore quand j'avais passé le bac, pfiou ça fait tellement longtemps ! J'en avais bavé avec la philo ! Mais bon c'était très intéressant
Il faut être inscrit pour télécharger un document
Crée un compte gratuit pour télécharger ce document
J'ai déjà un compte

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
On peut considérer le doute comme inséparable, et même constitutif, de toute véritable entreprise philosophique. De Socrate à Descartes, en passant par les sceptiques, en effet, on retrouve ce doute. Chez Socrate, le doute est synonyme de critique et de remise en cause de tout ce qui présente comme savoir (définitif).
La notion de doute en tant que suspense entre deux propositions contradictoires recouvre une liste de phénomènes: au niveau de l'esprit, elle implique le raisonnement, l'examen des faits et des preuves. Dans la théologie prémoderne, le doute était "la voix d'une conscience incertaine" et il était important de le comprendre car, en cas de ...
Le doute est non seulement l'hésitation de l'esprit lorsqu'il ne sait si une pensée est vraie ou fausse ou une action juste ou non, mais il est aussi et surtout la condition pour que l'esprit puisse rechercher ce qui est vrai ou faux, ce qui est bien ou mal. Aussi est-il une force si on le compare à la simple croyance.
Les prisonniers de la caverne, qui ne voient que des ombres projetées sur le mur, peuvent douter de l'existence du monde extérieur et désespérer de jamais connaître la vérité. C'est le danger du doute excessif, qui conduit à l'immobilisme intellectuel et à la résignation.
Les observations précédentes sur le progrès de la science grâce au doute, nous amènent à préciser que pour la science, le doute renvoie à l'idée de prudence ou de précautions et non à la fermeture totale. La science ne peut faire l'économie du doute puisque la certitude est vitale pour la connaissance. Elle a la responsabilité ...
Le doute est donc le moteur de la recherche de la connaissance et de la vérité. Il me révèle que ce que je pense est un préjugé, c'est-à-dire une opinion toute faite qui s'est imposée ...
Il ne faut pas s'arrêter aux premières difficultés pour mettre en avant ses idées, ses pensées. Une réflexion permet à la suite d'un doute , d'arriver à la pensée finale recherchée au début. Corrigé de la dissertation de philosophie, disponible gratuitement, et rédigé par l'élève tahime.
Corrigé de la dissertation de philosophie, disponible gratuitement, et rédigé par l'élève calista.
Exemple de corrigé d'une dissertation de philosophie sur les thème du doute, du savoir et de la vérité. Corrigé à télécharger, proposé par un professeur de philosophie et entièrement rédigé.
En cela, douter de la pertinence de nos idées permet de prendre conscience de ce que nous ne savons pas, et de ce qu'il nous faut en conséquence chercher à connaître. Le doute apparaît donc ici comme nécessaire au savoir9, en ce que cet acte de l'esprit10permet de déterminer ce que nous ne connaissons pas.
Le doute apparaît donc comme la force d'un esprit armé contre l'erreur. Le doute semble donc inséparable de la démarche philosophique elle-même. Il fait sa force, son intérêt et sa valeur. Bertrand Russell souligne ainsi que la philosophie vaut par le doute qu'elle éveille dans l'esprit de celui qui la découvre.
Pour avoir des exemples de sujets de dissertation voir les annales dans PhiloBac « Peut-on mettre en doute l'existence du sujet ? » Analyse du sujet. Plusieurs points du libellé devront faire l'objet d'une étude : Tout d'abord qu'est-ce que mettre en doute de manière générale ? (fig.2) Quel sens donner à la notion ...
Contacter l'émission. Toute la semaine, des professeurs de terminale corrigent sujets de dissertation et explications de texte en compagnie d'Adèle Van Reeth. Aujourd'hui, "Faut-il toujours chercher la certitude ? " Un sujet proposé par Ligeia Saint-Jean, professeur au lycée Paul Bert, à Paris.
Le doute est passif et négatif, car il empêche totalement la prise de décision ainsi que la mise en action de celle-ci. René Descartes exprimait l'idée selon laquelle l'indifférence (entendue ici comme absence de choix) était le plus bas degré de liberté, en ce sens le doute était donc une faiblesse selon lui.
Si le doute semble une notion éminemment moderne, il est indéniable que l'attitude qu'elle conceptualise existait bien avant Montaigne. Ce que la modernité s'est attachée à définir et dont elle a fait son emblème avait ses formes propres au Moyen Âge, qu'il s'agit d'explorer à travers textes, discours, pratiques. Il ne s'agit pas de chercher les prémices d'une ...
Lisez ce Divers Cours et plus de 299 000 autres dissertation. Le doute en philosophie. Peut-on douter de tout ? Dans nos jours, douter dans n'importe quel sujet est devenue une action normale, Douter veut...
"Que sais-je ?" Cette question posée par Montaigne dans ses Essais est au coeur de la démarche philosophique, le fait de douter. La philosophie peut se penser comme un art du doute. L'usage du doute est le fondement de l'esprit critique. Il n'y a pas de philosophie, ni de philosophe, sans doute. Mais que désigne précisément cette ...
Le doute méthodique est le signe de la plus grande exigence de vérité, de celle qui ne se satisfait jamais du probable ou du vraisemblable. Provisoire, le doute constitue ainsi pour Descartes un moment fondateur en ce qu'il permet de distinguer le vrai du faux.
Cette réflexion permet de mieux apprécier la définition que donne Alain du doute : "Le doute est le sel de l'esprit, sans lui toutes les connaissances sont bientôt pourries", car comme le sel, le doute conserve et donne du goût, cependant pas assez de doute et les vérités pourrissent, trop de doute et
Mis à jour le 7 décembre 2020. Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac). Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d'une dissertation de philosophie, ainsi que la méthode utilisée.
Vous passez l'épreuve de philosophie au baccalauréat cette année, et vous souhaitez avoir toutes les clés pour rédiger une bonne dissertation ? Découvrez des conseils de profs avec notre ...
L'objectif de l'accroche en philosophie est d'introduire non seulement le sujet, mais surtout le problème que pose le sujet. Une mauvaise façon de commencer une introduction est sans doute de commencer par une liste de définitions des termes du sujet. Commencer à définir les termes du sujet est évidemment nécessaire dans ...
C'est pourquoi, si la recherche de la vérité passe par le doute, on peut tout aussi bien affirmer que la vérité elle-même doit conserver une part de doute et qu'il n'est pas possible de ne rien affirmer comme vrai qui s'émancipe du doute. Cette position est à la fois celle de Socrate qui expliquait que ce qu'il savait était ...