
- Actualités du milieu normatif
- Audit interne, audit fournisseur
- Objectifs, indicateurs et tableaux de bord
- Documentation
- Principes généraux de la qualité
- Outils et méthodes
- Ressources Humaines
- Communication interne
- Vidéothèque
- Sécurité Environnement
- Normes et réglementations
- Enquête de satisfaction
- Conduite de réunion
- Fonction métrologique
- Droit de l’environnement
- A propos de l’auteur
- Partenaires
- Mentions légales
- Contactez-nous
- Politique de cookies

L’application du droit international de l’environnement : le défi du XXIème siècle !
Ce dossier présente une réflexion sur certaines conditions d’application et d’effectivité du droit international de l’environnement. Cette amorce d’analyse a été menée par Mounir EL AJJOURI, juriste et doctorant en droit international de l’environnement .
La sauvegarde de l’environnement peut être entendue dans une perspective la dépassant, en considérant l’adaptation du droit aux évolutions politiques, économiques et sociales. Alors, que vous soyez acteur dans les démarches de management environnemental pour votre entreprise ou simple citoyen curieux d’appréhender les mécanismes juridiques internationaux relatifs à l’environnement, vous trouverez ici une base de réflexion sur les enjeux et les difficultés d’une application concrète…
Actuellement, aborder la question de la mise en œuvre du droit international de l’environnement revient clairement à se pencher principalement sur celle de l’effectivité des différents accords internationaux élaborés, signés, ratifiés en la matière. Cette effectivité se présente comme un des plus grands défis actuels posés à la gouvernance mondiale, ces accords s’étant considérablement multipliés avec le temps, actant de régimes complexes et impliquant de nombreux acteurs. Ces acteurs étant, entre autres, entendus comme les Etats souverains, si les accords internationaux sur l’environnement n’étaient simplement fondés que sur la simple somme des intérêts particuliers de ces Etats, c’est-à-dire, en se conformant seulement aux mécanismes classiques de régulation, c’est tant le nombre que l’efficacité de ces accords qui se verraient nettement diminués.
Etudier la question de l’effectivité du droit international de l’environnement implique alors de s’intéresser aux cycles d’influences qui s’opèrent entre le droit, le comportement des Etats et des individus et leur effet cumulé sur l’environnement.
Postulat de départ
En pratique, chaque nouvel accord multilatéral sur l’environnement a été porteur d’innovations institutionnelles, parfois modestes, comme dans le cas de la Convention de Ramsar, relative aux zones humides, parfois audacieuses, comme dans le cas du Protocole de Kyoto sur le changement climatique.
Il faut également signifier la différence de conception qui existe entre les accords internationaux fondés sur la réciprocité (partage des bénéfices par exemple) et ceux qui nécessitent une dose de multilatéralisme pour élaborer des solutions communes face aux problèmes qui affectent les biens publics.
Concernant la pertinence d’une étude sur l’effectivité du droit international de l’environnement : que les sources en soient publiques ou privées, qu’ils soient régionaux ou mondiaux, de nombreux et volumineux rapports attestent régulièrement de la dégradation continue de l’état de l’environnement. À l’entrée dans le XXIème siècle, les changements environnementaux revêtent une gravité toute particulière et présentent à plusieurs égards des risques d’irréversibilité. Ceci vaut tant pour les aspects environnementaux généraux que pour les particuliers comme peuvent en témoigner les travaux sur l’étude de la protection de la faune marine par le droit international de l’environnement.
Depuis plus d’une trentaine d’années, l’outil juridique est sollicité pour protéger l’environnement, et tout particulièrement le droit international dès lors que les enjeux revêtent une forte dimension transnationale. Le droit international de l’environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan quantitatif qu’au regard des domaines couverts.
Après une phase de frénésie normative, durant laquelle il s’agissait de construire un corps de règles et où peu d’attention était portée à la mise en œuvre, le constat d’une relative ineffectivité des instruments adoptés a été dressé. Au début des années 90, doctrine et praticiens amorcent une réflexion sur les causes de ces faiblesses et les moyens d’y remédier. Juristes et théoriciens des relations internationales suivent alors le même mouvement : après s’être intéressés principalement aux conditions de mise en place et au contenu des régimes internationaux, ils s’attachent à leur mise en œuvre. Jusqu’alors, un biais rationaliste avait trop vite conduit à penser que les gouvernements ne s’engagent qu’après avoir déterminé qu’il en va de leur intérêt, que, dès lors, ils mettent généralement en œuvre les traits et se conforment à leurs engagements et que, lorsqu’ils ne le font pas, des sanctions sont employées aussi bien pour « punir » les manquements, que pour décourager d’autres manquements éventuels.
La réalité est toute différente, et infiniment plus nuancée, particulièrement dans le domaine de l’environnement où des raisons très diverses peuvent pousser les Etats à s’engager, en le faisant parfois sans même l’intention de mettre en œuvre le moindre engagement, ou d’autres fois en cherchant au contraire à le mettre en œuvre, mais en ne disposant pas des capacités nécessaires.
L’effectivité du droit international de l’environnement : le défi mondial et collectif du XXIème siècle
La problématique de l’effectivité est devenue peu à peu un champ majeur de recherche en économie, en relations internationales et en droit international. Elle suscite des analyses variées, des plus empiriques aux plus théoriques, les auteurs cherchant à qualifier, voire quantifier, le degré d’effectivité des instruments et expliquer les disparités rencontrées. S’inscrivant dans un ordre juridique et institutionnel en pleine évolution, la compréhension de ces phénomènes s’avère un indispensable préalable à toute tentative de renforcer ce corps de règles et d’instruments et, plus largement, d’améliorer la « gouvernance » internationale de l’environnement. Cette perspective est d’ailleurs d’emblée mentionnée dans la préface du rapport annuel 2010 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, signifiant « qu’il est fort probable que la gouvernance environnementale internationale constitue un thème clé de l’agenda politique » (Achim Steiner, sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif du PNUE). Sur la question directe de l’effectivité, le même rapport pose la problématique d’un développement des mécanismes environnementaux internationaux qui bien que constaté, s’avère aussi à l’origine d’une plus grande fragmentation néfaste « pour relever les défis internationaux ». L’exemple récent de la difficulté de parvenir à un accord sur le changement climatique à Copenhague alimente d’ailleurs ce débat de la gouvernance.
L’intérêt de cette notion spécifique de l’effectivité réside essentiellement dans le fait que, sans être un principe du droit international, elle est cependant parfaitement représentative de l’esprit profond de ce droit.
Le droit international de l’environnement connaît une grande diversité de sources formelles, de la lex ferenda à la lex . La théorie classique des sources du droit international résiste d’ailleurs assez mal aux coups de boutoir assénés par cette jeune branche et ceci à plusieurs égards. Les conventions internationales ou traités constituent à ce jour l’outil le plus opérant de coopération interétatique, notamment parce que leur contenu est obligatoire en vertu du principe pacta sunt servanda rappelé à l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Ces dernières années, l’activisme diplomatique a encore régulièrement nourri le droit international de l’environnement de nouvelles conventions. Mais, au regard de la modestie des résultats, cette prolifération normative semble avoir pris des allures de fuite en avant.
Le paradoxe du droit mou
Poursuivant sur l’idée de cette prolifération, la profusion de la soft law (droit mou, c’est-à-dire des textes de lois fournissant des recommandations et non des obligations) est aujourd’hui telle qu’il s’annonce plus que délicat d’en dresser un quelconque inventaire. Citons le Doyen Carbonnier et son hypothèse du non-droit : « L’environnement appartient ainsi encore aux domaines pour lesquels le non-droit est quantitativement plus important que le droit » (le non-droit fait ici référence au droit mou). Actuellement, cette abondance de la soft law peut être interprétée comme le symptôme pathologique, s’il en est, d’une matière encore récente et bien loin d’être consensuelle à l’échelle mondiale.
Si l’on s’en tient au seul plan conventionnel, pour que les normes posées soient concrètement réalisées, encore faut-il que les conventions répondent à une double condition : être efficaces et effectives.
Pour Charles de Visscher, on peut tenir « pour efficaces les dispositions d’un acte international (…) quand, considérées en elles-mêmes, elles sont en adéquation aux fins proposées » . Cette première condition n’est pas aisément remplie dans le domaine de l’environnement. Par manque de connaissance ou par défaut de consensus, les objectifs environnementaux à atteindre ou les méthodes à suivre sont souvent peu clairement formulés. Ce niveau de réflexion mène hors des frontières du droit, dès lors qu’il s’agit de répondre, à partir d’une analyse substantielle, à la question : la qualité de l’environnement ou l’état de la ressource peuvent-ils être améliorés grâce au régime ou au traité ? Encore faut-il connaître les « besoins » de l’environnement ou de la ressource et être en mesure de les combler, ce qui s’avère plus ou moins facile selon les cas.
Les conditions d’application du droit international de l’environnement
Ensuite, les normes doivent être effectives, car l’efficacité d’un instrument international ne préjuge pas de son effectivité. Toujours selon de Visscher, on peut tenir pour effectives les dispositions d’un traité « selon qu’elles se sont révélées capables ou non de déterminer chez les intéressés les comportements recherchés » . Or, la remarque générale de cet auteur selon laquelle « trop (de traités) dotés d’une efficacité certaine et pourvus d’adhésions nominales nombreuses restent démunis d’effectivité » s’applique bien au droit international de l’environnement. Si les progrès de la coopération internationale sont notables, l’application nationale, notamment par la transcription des normes internationales dans les droits internes, demeure insuffisante. La plupart des obligations ne sont pas auto-exécutoires ; en outre, les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d’une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l’obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Cela contribue à rendre difficile la mise en œuvre des règles posées.
À priori, si ces deux conditions d’efficacité et d’effectivité sont remplies, in fine la qualité de l’environnement sera améliorée grâce au régime ou traité (problem-solving) . Le régime ou traité est alors effective au sens anglais ; l’ effectiveness couvrant ces deux aspects.
L’ effectiveness of est analysée comme l’ impact of a given international institution in terms of problem-solving or achieving its policy objectives. Outre le caractère polysémique du terme, l’évaluation de l’ effectiveness n’est toutefois pas aisée en raison de la complexité de systèmes sociaux et de systèmes écologiques en perpétuelle évolution, mais aussi de la difficulté d’établir un lien de causalité entre la mesure de politique internationale et le résultat observé. La chaîne d’action reliant les régimes, les politiques, les personnes à l’environnement naturel est complexe et incertaine, discontinue. Certains succès politiques ne sont pas conjugués avec des réussites sur le plan environnemental. Des indicateurs adéquats de cette effectivité font encore défaut.
L’ effectiveness est multidimensionnelle. Le régime pourra être jugé effective s’il :
- assure la protection de l’environnement ;
- conduit au respect des règles et standards posés ;
- conduit à la modification souhaitée du comportement humain ;
- est transposé aux différents niveaux institutionnels (régional, national, local) par l’adoption de lois, règlements et la conduite de certaines activités administratives.
- a un impact à travers sa seule existence, indépendamment de l’adoption de mesures spécifiques.
Or, rares sont les régimes qui réunissent toutes ces dimensions. Cela n’est possible que lorsque les problèmes environnementaux sont bien délimités et bien compris, et que les changements économiques et sociaux requis sont réduits. Le plus souvent, un régime n’est effective qu’au regard de l’une ou l’autre de ces dimensions.
Les analyses d’Oran Young rendent bien compte des difficultés pratiques rencontrées par les régimes ou institutions internationales. Ces difficultés sont rangées en trois catégories :
- des problèmes d’adéquation, de décalage entre les besoins de l’environnement, des écosystèmes et les institutions. En tant que construits sociaux, les institutions devraient pouvoir être adaptées aux caractères biogéophysiques des problèmes environnementaux. Pourtant, il existe des décalages et, même lorsqu’ils sont identifiés en tant que tels, il est difficile d’y remédier ;
- des problèmes d’interactions, qui concernent les liens horizontaux ou verticaux existant entre les différentes institutions ;
- des problèmes d’échelle, qui concernent les différences d’évolution différentes échelles spatiales et temporelles
Les difficultés rencontrées ont entraîné le développement de techniques spécifiques de mise en œuvre, en cherchant à adapter le droit et les procédures aux enjeux.
Car, si le droit international de l’environnement acte d’un sens, c’est aussi lorsqu’il tend à concilier les différentes politiques sectorielles. Mais la communauté internationale peine à relier l’ensemble de son action dans une démarche cohérente et ainsi à s’annoncer prête à développer le principe d’intégration des considérations environnementales dans les autres politiques. Pourtant, dès 1992, la nécessité de l’intégration est affirmée au principe 4 de la Déclaration de Rio et consacré par un chapitre entier, le huitième, d’Action 21.
À la veille de l’année 2012 qui verra venir Rio +20, la question de l’effectivité du droit se présente non plus seulement pertinente, mais bel et bien déterminante.
Bibliographie
- BOSKOVIC O., L’efficacité du droit de l’environnement ; mise en œuvre et sanctions, Dalloz, 2010.
- CARBONNIER J., Flexible droit, LGDJ, 2001.
- DE VISSCHER C., Les effectivités du droit international public, Paris, Pédone, 1968.
- FRITZ J-C. et BOUTELET M., L’ordre public écologique. Towards an ecological public order , Bruxelles, Bruylant, 2005.
- KISS A. et BEURIER J-P., Droit international de l’environnement, Limoges, Pédone, 2004.
- LAVIELLE J-M., Droit international de l’environnement, Ellipses, 2010.
- MALJEAN-DUBOIS S., Quel droit pour l’environnement, Hachette Education, 2008.
- MAZAUDOUX O., Droit international public et droit international de l’environnement, Pulim, 2008.
- YOUNG O., Emergent Patterns in International Environmental Governance, MIT Press, 2010.
Partager cette publication
Notre site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. En continuant à utiliser notre site, vous acceptez notre utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.
Le moteur de recherche des thèses françaises
Les personnes liées aux thèses, recherche avancée, le droit à un environnement sain en droit international, mots clés contrôlés, mots clés libres.
La présente thèse est consacrée à l’étude de la portée du droit à un environnement sain en droit international. Ce droit de l’Homme est appréhendé comme étant le résultat d’interactions entre le droit international des droits de l’Homme et le droit international de l’environnement ainsi qu’entre différents ensembles normatifs de protection des droits de l’Homme. Ce droit assiste à un essor remarquable au sein des États et des systèmes de protection des droits de l’Homme. En retraçant les différentes étapes de son développement progressif, cette thèse s’attache à en identifier les contours, tant sur le plan formel que sur le plan matériel. Elle envisage ensuite la mise en œuvre de ce droit au travers des obligations qui s’y rapportent et le contrôle qui peut en être réalisé. Il en ressort que les conditions sont désormais réunies pour en reconnaître la portée universelle. De surcroît, cette thèse envisage le droit à un environnement sain comme étant l’une des réponses possibles à la crise environnementale qui invite à un renouvellement des rapports que l’Homme entretient avec la nature. C’est à la lumière de cette perspective axiologique que le droit à un environnement sain est alors analysé.
DRT-7015 Droit international de l'environnement
Étude des régimes juridiques élaborés par les États pour protéger l'environnement sur le plan international. Étude des sources, des principes fondamentaux et de la responsabilité des États en matière d’environnement. Rôle du droit international dans la prise en compte des rapports entre le développement économique, la protection de l’environnement et le bien-être social, des relations entre les pays développés et les pays en développement. Étude des différents régimes juridiques en tenant compte du contexte nord-américain.
Cycles du cours
- Deuxième cycle
- Troisième cycle
Modes d'enseignement
À l'horaire
- Automne 2024
- Cours en développement durable
Responsables
- Faculté de droit
Restrictions à l'inscription
Doit être inscrit à:
- Doctorat en droit
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit
- Maîtrise en droit
- Maîtrise en études internationales
- Maîtrise en droit - avec mémoire
- Maîtrise en études internationales - avec mémoire
Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.
Cette activité est contributoire dans:
- Maîtrise en administration des affaires - responsabilité sociale et environnementale des organisations
- Maîtrise en études internationales - commerce international et investissement
- Maîtrise en études internationales - développement international
- Maîtrise en études internationales - relations internationales
- Maîtrise en études internationales - sécurité internationale
- Maîtrise en études internationales - commerce international et investissement - avec mémoire
- Maîtrise en études internationales - développement international - avec mémoire
- Maîtrise en études internationales - relations internationales - avec mémoire
- Maîtrise en études internationales - sécurité internationale - avec mémoire
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit - droit de l'environnement, développement durable et sécurité alimentaire
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit - droit des affaires
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit - droit international et transnational
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit - droits fondamentaux
- Microprogramme de deuxième cycle en administration des affaires - responsabilité sociale et environnementale des organisations
- Microprogramme de deuxième cycle en droit - droit de l'environnement et développement durable
Cours équivalents ou jumelés ULaval
- DRT-6013 Droit international de l'environnement Depuis l'été 2009
Les cours équivalents sont des activités de même cycle dont le contenu est identique ou très semblable. La réussite de l'un entraîne la reconnaissance de l'autre. Si, à l’une des sessions indiquées, vous avez réussi un cours équivalent, vous n’avez pas à vous inscrire au cours présenté sur cette page. Le cours équivalent vous sera reconnu.
Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.
Répartition hebdomadaire
- 0h Laboratoire ou travaux pratiques
- 6h Travail personnel
Pour vous inscrire, accédez à monPortail .
Automne 2024 – 1 section offerte
DRT-7015 A En classe | Restrictions
NRC 84333 Capacité maximale: 40 étudiants
Plage horaire
- Type: En classe
- Dates: Du 3 sept. 2024 au 13 déc. 2024
- Journée: Jeudi
- Horaire: De 8h30 à 11h20
- Pavillon: Charles-De Koninck
- Local: 1252
- Maîtrise en administration des affaires
- Microprogramme de deuxième cycle en administration des affaires
Automne 2023 – 1 section offerte
DRT-7015 A En classe
NRC 84299 Capacité maximale: 40 étudiants
- Dates: Du 5 sept. 2023 au 15 déc. 2023
- Local: 1245
Automne 2022 – 1 section offerte
NRC 84383 Capacité maximale: 35 étudiants
- Dates: Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022
- Journée: Mercredi
- Local: 1271

- THÈMES JURIDIQUES
- Méthodologies
- Commande & correction de doc
- LE BLOG JURIDIQUE
- Actualités en droit
- Conseils juridiques
Consultez tous nos documents en illimité !
à partir de 9.95 € sans engagement de durée
Exemples de sujets et de problématiques pour un mémoire en droit de l'environnement
Sur quels thèmes rédiger un mémoire en droit de l'environnement ? Vous trouverez ici quelques suggestions.

Credit photo : Pexels Singkham

Sujet 1 - La protection de l'environnement et la production des ressources maritimes Sujet 2 - Droit de l'environnement et développement durable Sujet 3 - Préservation de l'environnement pendant les conflits armés Sujet 4 - La gestion de la pollution en droit de l'environnement Sujet 5 - Les droits de l'homme et le droit de l'environnement
Sujet 1 - La protection de l'environnement et la production des ressources maritimes
Le droit de l'environnement est une matière très vaste, qui englobe différents processus et différents domaines d'activités, dont la protection des sites, qu'ils soient terrestres ou maritimes.
Problématique : comment le droit de l'environnement peut-il être une aide à la protection de l'environnement au niveau maritime ?
Définir le rôle et les objectifs du droit de l'environnement, le lien avec les diverses ressources exploitables marines. Quel est le cadre juridique, quel équilibre entre exploitation et protection ? Donner éventuellement des pistes pour une politique de gestion plus adaptée.
Sujet 2 - Droit de l'environnement et développement durable
Il s'agit de deux thèmes intrinsèquement liés, qui relèvent d'une vraie tendance depuis plusieurs années déjà.
Problématique : en quoi le droit de l'environnement peut-il être un atout à la mise en pratique du développement durable dans le monde entier ?
Définir dans un premier temps les différentes notions, et les liens entre elles. Quels sont les objectifs des chefs d'État en ce qui concerne ces deux thèmes et comment sont-ils appliqués ? Parler également de la législation, et du lien entre préservation de la nature et droit de l'environnement.
Sujet 3 - Préservation de l'environnement pendant les conflits armés
Le sujet épineux des conflits armés est souvent peu compatible avec la préservation de l'environnement et pourtant, il est essentiel d'y accorder une part importante, ne serait-ce que pour la préservation de la planète à longue échéance.
Problématique : comment le droit de l'environnement peut-il et doit-il devenir compatible avec les conflits autour du monde ? En quoi est-ce toujours important de préserver l'environnement même en temps de guerre ?
Définition des notions, parler également du partage du monde par les états. Mettre en avant les concepts technologiques, pas toujours en accord avec l'environnement, mais pourtant de plus en plus utilisés. Faire le lien entre les hommes libres dans un environnement sain et mettre en avant le fait que l'environnement est aujourd'hui une priorité pour tous les pays du monde.
Sujet 4 - La gestion de la pollution en droit de l'environnement
La pollution est un des sujets phares du droit de l'environnement, puisque tous les pays du monde veulent la combattre afin de pouvoir la réduire au maximum.
Problématique : en quoi la gestion de la pollution est-elle une constante dominante du droit de l'environnement ?
Le candidat définira d'abord les notions d'une manière approfondie, en mettant en avant les diverses règles juridiques et les interdictions, que ce soit en France ou dans un autre pays du monde au choix. Quels sont les régimes juridiques de protection de l'environnement, les modes de surveillance, les régimes de responsabilité, les côtés administratifs, civils et pénaux ?
Quel est en outre le lien entre gestion de la pollution et tourisme, entre tourisme et revenus pour les États ?
Sujet 5 - Les droits de l'homme et le droit de l'environnement
Depuis quelques années, il est fait mention du lien entre droits de l'homme et droit de l'environnement.
Problématique : en quoi la protection du droit de l'homme est-elle un des principaux facteurs d'un environnement sain ?
Définir les notions et les liens entre elles. Comment sont-elles nées, quelles sont leurs histoires ? Faire le lien entre les populations les plus pauvres et à fortiori les plus fragiles, ainsi qu'entre environnement sain et santé de la population. Parler également de la lutte contre les changements climatiques, du renforcement de la lutte pour les droits de l'homme dans tous les pays du monde.
Sources : Sofreco, Lextenso, ONU, Cairn, CNCDH
Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !
Documents conseillés, articles liés.

Les règles d'intégrité, transparence et de responsabilité...

Télétravail et fin de contrat de travail : la question de...

Les institutions internationales : OIG et ONG
Articles récents

Le rôle du Parlement européen dans la procédure...

Le fonctionnement du Parlement européen
- français
- Home
- Faculté de droit
- Faculté de droit – Thèses et mémoires
La spécificité du droit international de l’environnement dans son rapport avec la souveraineté étatique

- international environmental law
- common heritage of mankind
- Droit international de l’environnement
- Principe de souveraineté
- Patrimoine commun de l’humanité
- Principle of sovereignty
- Social Sciences - Law / Sciences sociales - Droit (UMI : 0398)
Abstract(s)
Collections.
- Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [23987]
- Faculté de droit – Thèses et mémoires [757]
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.
Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne. En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Français FR
Ressources numériques en sciences humaines et sociales
Nos plateformes
Bibliothèques
Suivez-nous
Redirection vers OpenEdition Search.
- Éditions de la Sorbonne ›
- Homme et société ›
- Humanités environnementales ›
- Chapitre 10. L’environnement : objet du...
- Éditions de la Sorbonne
Humanités environnementales
Ce livre est recensé par
- Ève Bureau-Point, L’Homme , mis en ligne le 21 janvier 2019. URL : https://journals.openedition.org/lhomme/32870 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lhomme.32870

Chapitre 10. L’environnement : objet du droit, objet de droit(s) ?
Plan détaillé, texte intégral.
1 Sans aucun conteste, l’environnement constitue désormais, en droit interne comme en droit international, un objet du droit. Un impressionnant arsenal législatif et réglementaire en témoigne. Le caractère prescriptif – et non descriptif – de la norme conduit le législateur à faire des choix qui orientent et contraignent les comportements humains et qui donnent à la définition de l’environnement pour le droit une dimension singulière par rapport à celles qui peuvent être retenues pour et par d’autres sciences humaines.
2 Dans ce contexte et parce qu’ils restent indéfinis, les contours de l’environnement comme objet du droit continuent de renouveler les pratiques et d’alimenter l’analyse par les juristes, publicistes et privatistes, des sources nationales et supranationales du droit de l’environnement.
3 De la création des premiers parcs naturels, dans les années 1960, à l’adoption récente de dispositifs de protection discontinue tels que les trames verte et bleue en 2007, la protection de l’environnement a conduit le législateur, le pouvoir réglementaire, les juges 1 et la doctrine 2 , non seulement à se détacher du carcan de catégories et dispositifs juridiques préétablis et fondamentaux – par exemple la propriété privée –, mais également à s’ouvrir à de nouveaux champs disciplinaires.
4 L’appréhension de l’environnement comme objet du droit s’est initialement traduite par la difficulté de comprendre la protection de l’environnement comme une branche du droit à part entière et comme une discipline juridique autonome, notamment en droit interne. Plusieurs étapes peuvent ainsi être mises en relief dans l’apparition du droit de l’environnement.
5 Les origines historiques en sont nombreuses et variées, selon les ressources et les époques. D’une certaine façon, la préoccupation environnementale n’a jamais été totalement absente de l’esprit des décideurs publics, comme en témoigne l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 de Colbert ou la loi sur les établissements insalubres de 1917. Néanmoins, les textes consacrés à la protection de la « nature » ou à la lutte contre les pollutions ne formaient pas au début du xx e siècle un ensemble cohérent et n’étaient pas appréhendés comme tel par les acteurs du droit.
6 C’est à partir des années 1960 qu’émerge à proprement parler un droit de l’environnement. Cette apparition se fait à la fois au niveau supranational, avec les premiers travaux onusiens sur la gestion des ressources naturelles, symbolisés par la Déclaration adoptée à l’issue de la première conférence des Nations unies sur l’environnement en juin 1972 à Stockholm et au niveau national, sous l’influence des premiers écologistes et ingénieurs, hommes de l’ombre derrière les décideurs politiques, notamment sous la présidence de Georges Pompidou, qui ont inspiré les premières grandes luttes et mesures de protection de l’environnement (Ambroise-Rendu, 2007).
7 La maturation de la matière est, quant à elle, à l’échelle française, essentiellement l’œuvre d’universitaires et de chercheurs qui vont porter le droit de l’environnement et son enseignement pendant de nombreuses années, notamment entre 1970 et 2000. Parmi eux se distinguent notamment les publicistes Michel Prieur, Jacqueline Morand-Deviller et Yves Jegouzo, l’internationaliste Alexandre-Charles Kiss ainsi que les privatistes, notamment Michel Despax et Martine Rémond-Gouilloud.
8 En droit positif interne et à partir des années 1990, avec l’adoption de la loi n° 95-101, dite loi Barnier, du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, la codification du droit de l’environnement en 2000, l’adoption de la Charte constitutionnelle de l’environnement en 2005 3 ou la définition du ministère de l’Écologie comme ministère d’Etat en 2007, la légitimité du droit de l’environnement n’est plus discutée. Les années 1990 à 2010 sont empreintes d’un essor sans précédent de la réglementation environnementale au niveau national, européen et international ainsi que des études y afférant. Les formations qui lui sont consacrées se développent dans de nombreuses universités françaises et l’intérêt des universitaires et des praticiens du droit pour la matière est croissant 4 .
9 Tout au long du processus qui se déroule des années 1960 à aujourd’hui, les exigences propres à la compréhension des enjeux environnementaux incitent les juristes professionnels et la doctrine universitaire à constater les limites d’une analyse juridique en vase clos et à développer une connaissance interdisciplinaire de ce qu’ils perçurent longtemps comme l’objet d’un droit nouveau.
10 Pour arrêter la définition de l’environnement et de ses composantes, le droit fait appel à la biologie, la géographie, la sociologie et l’écologie. L’économie jouera un rôle primordial dans la définition des politiques publiques et de la réglementation environnementales à partir du début du xxi e siècle, mais c’est également à travers la philosophie, la sociologie et l’éthique que le juriste puise les fondements nécessaires pour répondre à la question de savoir si l’environnement est objet du droit, source du droit ou sujet de droit (Ost, 2003 ; Zabalza, 2007 : 45).
11 Aussi est-il commun de trouver au sein de grandes institutions publiques dédiées à la réglementation de la protection de l’environnement des chercheurs et praticiens issus de disciplines diverses. Cette interdisciplinarité n’est pas totalement étrangère aux juristes, mais elle reste, le plus souvent, l’initiative et le fait, en droit de l’environnement, des économistes, politistes et philosophes.
12 Par ailleurs, l’interdisciplinarité engendrée par l’apparition du droit de l’environnement dépasse le strict cadre théorique et doctrinal. À cet égard, la question plus pragmatique de la pertinence de la formation des juges aux problématiques environnementales ou du recours croissant à l’expert dans les procédures contentieuses est fréquemment soulevée. En effet, si la Cour de cassation et le Conseil d’Etat consacrent aujourd’hui de nombreux travaux d’étude au droit de l’environnement, la formation des juges en la matière, notamment dans ses aspects techniques, au sein des juridictions de première instance, mérite d’être perfectionnée. Le législateur n’échappe pas à cet élan. Il se fait le relais de transformations induites par l’érection du droit de l’environnement. Il est ainsi à l’origine d’évolutions sémantiques qui dépassent largement le cadre des analyses juridiques. Le droit de l’environnement se fait le réceptacle de concepts nouveaux et mouvants. La « protection de la nature » de la fin des années 1960 devient « protection de l’environnement » dans les années 1990 puis « développement durable » depuis une dizaine d’années, ce dernier concept étant lui-même né au niveau supranational du croisement de considérations économiques, sociales et environnementales.
13 Confrontés à l’exigence et l’exercice d’interdisciplinarité, les juristes se heurtent toutefois aux risques d’incompatibilité des concepts et dispositifs juridiques classiques aux catégories issues des champs disciplinaires qui les inspirent, tels que l’écologie ou l’économie. Ainsi par exemple, malgré un succès certain auprès des spécialistes du droit de l’environnement, professionnels et académiques, la catégorie des biens publics mondiaux révélée par les économistes, à partir des travaux de Paul Samuelson dans les années 1950 (1954), ne trouve pas encore son pareil en droit et sa transposition directe bouscule les catégories et figures classiques du droit des biens, par exemple celle du domaine public. De même, dans la mise en œuvre du principe de précaution, notamment en matière d’OGM et de pesticides, les pouvoirs publics font face à la nécessité de faire des choix de société allant bien au-delà de la seule réflexion juridique, et d’investir les abîmes philosophiques et scientifiques du défi environnemental.
14 Les textes de droit de l’environnement se multiplient, mais les concepts fondamentaux de la matière restent flous. Aussi les juristes s’en remettent-ils aux figures traditionnelles du droit, notamment du droit des biens d’inspiration utilitariste et potentiellement contradictoires à la finalité protectrice guidant en principe la réglementation environnementale.
15 Dès lors, si le temps où le droit n’avait pas prise sur le monde naturel est bien révolu, le nombre limité de travaux récents, les quinze dernières années, proposant une approche renouvelée du statut juridique de la nature et de ses composantes, permet de considérer l’environnement comme un objet du droit fuyant, mouvant et ce malgré l’importance de la réglementation qui organise la protection et la reconnaissance d’un droit à l’environnement.
16 Ces carences constituent un obstacle certain au travail du législateur et des juges administratifs et judiciaires. Elles se traduisent par la multiplication de textes à valeur déclarative et l’utilisation fréquente par les praticiens du droit de termes scientifiques et économiques pour désigner les biens environnementaux, au détriment de leur qualification juridique. Les catégories juridiques classiques sont alors écartées et il apparaît que les juristes doivent repenser, d’une part, la place des composantes de la nature au-delà de la distinction « personnes-choses » et, d’autre part, les fondements devant guider leur qualification juridique.
17 C’est à la fois dans la désignation de l’environnement, comme nouvel objet du droit, et dans la définition des droits et obligations afférents à sa protection que ces difficultés apparaissent. Elles se manifestent essentiellement en droit interne, ordre juridique de référence, mais également en droit international comme en droit européen, ces trois ordres juridiques ne pouvant en tout état de cause être isolés les uns des autres en raison de l’intégration des normes supranationales dans l’ordre interne mais aussi des influences métajuridiques que le droit supranational exerce sur le droit interne en matière environnementale.
18 L’environnement demeure un objet du droit insaisissable, le témoin des apories d’une analyse juridique isolée. En devenant objet de droit(s) , voire sujet de droit, l’environnement ouvre encore davantage aux juristes le champ des possibles.
L’environnement : un objet du droit insaisissable ?
19 Comme le peintre, le juriste vit « la difficulté de saisir la nature même » (Guéry, 1991 : 12). Le travail d’abstraction induit par l’existence du droit de l’environnement, qui vise à définir et qualifier juridiquement l’environnement et les choses de la nature pour en faire les objets d’un droit à finalité protectrice, est plus redoutable qu’il n’y paraît. En effet, « toute pensée originaire des individus et des peuples est matérielle ou sensible. L’esprit ne s’affranchit du monde extérieur qu’après y être resté soumis pendant un certain temps et s’être préparé […] à la compréhension de la pensée abstraite » (Von Jhering, 1886-1887 : 113-114).
20 Cette difficulté est renforcée en droit de l’environnement par la multiplication des plaidoyers au sein de la doctrine environnementaliste invitant le juriste à s’inspirer directement de la nature, de son fonctionnement systémique et des concepts originaires de la biologie ou de l’écologie scientifique. À l’inverse, le droit des biens, innervé par un utilitarisme a priori opposé à la finalité protectrice portée par le droit de l’environnement ignore parfois démesurément la véritable nature des choses naturelles et transforme sans gêne des lapins en immeubles 5 .
21 Ces atermoiements relatifs à l’étendue de la prise en compte de la nature des choses dans la construction scientifique et à la représentation de l’environnement ne sont pas le propre du droit de l’environnement qui les renouvelle, néanmoins, dans la sphère juridique. Les économistes s’interrogent également à partir du « basculement d’une logique de maîtrise à une logique de respect » : « Le milieu naturel est complexe, faut-il chercher à se faire une alliée de cette complexité, ou faut-il imposer au milieu une configuration simplifiée ? » (Godard, 1992 : 192 ; Labrot, 2007 : 29).
22 Sous l’influence des économistes et face à la complexité de la nature et de ses différentes composantes, le législateur, le pouvoir réglementaire et le juge peinent à arrêter une définition mais surtout à retenir une qualification de l’environnement pour le droit et ce depuis l’apparition du droit de l’environnement dans les années 1960 jusqu’à aujourd’hui.
À la recherche d’une définition juridique de l’environnement
23 Il n’existe en droit positif, c’est-à-dire dans la réglementation en vigueur, de définition communément admise par l’ensemble de la doctrine ni de l’environnement, ni du droit de l’environnement. L’approche qui consiste à décrire le droit de l’environnement comme l’ensemble des règles fixées dans le Code de l’environnement, depuis la première codification opérée en 2000, doit être écartée puisque, d’une part, elle ne permet pas de saisir l’objet étudié et, d’autre part, elle est erronée. Si les dispositions du Code constituent une mine d’informations précieuse pour en délimiter les contours, les dispositions afférentes à la protection de l’environnement peuvent être identifiées dans des législations diverses, bien au-delà du seul Code de l’environnement.
24 Dans ce contexte, la doctrine universitaire environnementaliste définit le droit de l’environnement par sa finalité protectrice et par le fait de s’attacher à définir les contours de la notion d’environnement pour le droit à partir de cet objectif. Le contenu de l’objet protégé par la règle de droit ne semble, quant à lui, pas strictement arrêté 6 .
25 Au xx e siècle en France, à l’origine du droit de l’environnement et avant son apparition comme branche du droit autonome, la réglementation visait essentiellement deux objectifs. Le premier est la protection de la salubrité publique, à travers la lutte contre les pollutions industrielles au début du xx e siècle, dont la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes marque une étape décisive. Le second est la protection de la nature « sauvage » ou « naturelle », marquée par la création des premiers parcs naturels suite à l’adoption de la loi n° 60-708 relative à la création de parcs nationaux le 22 juillet 1960. Plus lente à mettre en place, la politique de protection des espaces naturels s’est heurtée, dès ses débuts dans les années 1960, à de nombreux obstacles parmi lesquels la protection des droits privatifs des personnes sur les ressources naturelles et, plus particulièrement, de l’ usus , du fructus et de l’ abusus du propriétaire foncier (Rémond-Gouilloud, 1989).
26 Nonobstant, à partir de la fin des années 1970, la réglementation fait évoluer la perception qu’ont les juristes de l’environnement. Ce mouvement est marqué par l’apparition des grandes lois de protection de l’environnement consacrant une approche plus globale et entérinant au fil du temps une profonde évolution sémantique : la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, la loi n° 95-101, dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement ainsi que la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. De plus en plus centrées sur la promotion du développement durable, ces lois jalonnent un mouvement profond d’élargissement du concept d’environnement, mais aussi d’intégration d’intérêts externes à l’objectif de protection de l’environnement, tels que le développement économique et social.
27 La réglementation de la protection de l’environnement, auparavant perçue par les juristes professionnels et universitaires comme une branche du droit administratif et/ou de l’aménagement du territoire devient autonome à partir des années 1970. Cette autonomie est le fruit d’un long processus, marqué par des événements notoires allant de la création d’un ministère de l’Environnement en 1971 à la codification propre au droit de l’environnement en 2000.
28 Le corollaire de cette émancipation est la nécessité de définir un objet du droit à part entière. Pourtant, il n’existe pas en droit positif de définition précise de l’environnement mais plutôt plusieurs définitions potentielles.
29 Ainsi, la Charte de l’environnement, issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005 et partie intégrante du bloc de constitutionnalité, ne donne pas de définition de l’environnement. Elle se réfère, dans ses considérants, aux ressources et équilibres naturels, au milieu naturel de l’humanité, aux conditions de vie de l’homme ou à la diversité biologique.
30 La législation et la réglementation, internes et européennes, ne pallient pas strictement cette absence de définition de l’environnement au plus haut rang de la hiérarchie des normes.
31 En effet, l’article L. 110-1 alinéa I er du Code de l’environnement 7 dispose : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » Cet article ne définit pas non plus stricto sensu ce qu’est l’environnement pour le droit, mais vise une série d’éléments qui « font partie » du patrimoine commun de la nation. L’emploi de la locution verbale « faire partie de » corrobore l’idée selon laquelle le législateur a – volontairement ou non – fixé une liste ouverte de composantes de l’environnement. Malgré son défaut d’exhaustivité et de portée juridique, cette disposition donne une forme à l’ensemble que recouvre le terme environnement, c’est-à-dire aux objets protégés par les différentes dispositions du droit de l’environnement. Elle s’apparente à une « quasi-définition ».
32 D’autres dispositions du Code de l’environnement destinées à mettre en place des dispositifs juridiques protecteurs, issues de la législation antérieure et postérieure à la codification en 2000, font référence aux composantes de l’environnement. Ces dispositions, car elles sont multiples et divergentes, ne sauraient être considérées comme donnant une définition rigoureuse de l’environnement pour le droit. Par ailleurs, il faudrait justifier le choix de s’en tenir à une disposition plutôt qu’à une autre, la multiplication de définitions ne servant guère plus la clarté de la réglementation.
33 Le droit européen, à travers les nombreuses directives adoptées en matière environnementale depuis les années 1960, fournit également des définitions multiples de l’environnement dont le juge français pourrait se saisir. Si, comme le souligne Christian Huglo 8 , les définitions données par les directives semblent plus strictes, claires et mobilisables (2006), elles ne répondent, pas plus qu’en droit interne, à une définition unitaire, mais plutôt à des définitions « au sens de » chaque directive, ou à une définition précise, car elles visent également des listes non exhaustives de composantes de l’environnement. Le même constat peut être fait en droit international où les définitions retenues par les traités et convention depuis les années 1960 varient d’un texte à l’autre.
34 En l’absence de définition précise de l’environnement en droit positif, la doctrine ne s’attache pas non plus à définir l’environnement, mais s’attelle plus volontiers à l’analyse de dispositifs juridiques déterminés. Tout se passe comme si, petit à petit, notamment ces vingt dernières années, était admis le caractère insaisissable de l’environnement pour le droit, dont on retient une conception de plus en plus proche de tout ce qui nous entoure.
35 À cet égard, l’environnement implique sans doute la maîtrise de certaines connaissances scientifiques, mais il est également un terme « à la mode » et politiquement connoté (Prieur, 2011 : 1). Ces deux caractéristiques constituent des facteurs de complexification du travail de définition qui incombe au juriste. Par ailleurs, l’exercice de définition de l’environnement pour le droit fait surtout apparaître les limites d’une approche juridique cloisonnée, et la nécessité de puiser au-delà du droit les éléments permettant de le comprendre comme objet du droit. Deux disciplines vont, plus particulièrement, jouer un rôle fondamental pour appréhender l’environnement comme objet du droit : l’écologie et l’éthique.
36 En « écologie », entendue au sens large et non strictement scientifique, l’environnement désigne l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs, naturels et culturels constituant le cadre de vie d’un individu et/ou susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines 9 . C’est à partir de cette définition que se sont construites et détachées, à travers l’« éthique », des définitions de l’environnement pour le droit dont il est en réalité autant de variantes que de courants de pensée écologiste, à la fois comme science et courant politique.
37 En effet, les éthiciens posent les fondements philosophiques et moraux du rapport « homme-nature » (Larrère et Larrère, 2009b ; Afeissa, 2007) 10 . Ces analyses éthiques sont saisies dans le débat politique alimenté par les mouvements écologistes. Elles sont essentielles car elles sont susceptibles d’orienter le travail de définition de l’environnement pour le droit, source de contraintes pour l’homme. Aldo Léopold – père de la land ethic – ne définissait-il pas l’éthique comme « une limite imposée à la liberté d’agir dans la lutte pour l’existence » (1949 : 255-258), c’est-à-dire une limite imposée à l’homme dans l’exploitation de la nature ?
38 L’éthique environnementale anthropocentrée place l’homme au cœur de la réflexion comme maître et possesseur de la nature, sur fond de philosophie cartésienne, et envisage la nature comme un réservoir de ressources pour l’homme, dans un rapport utilitariste. L’homme, mesure de toute chose, a une valeur intrinsèque , entendue comme valeur morale, et les composantes non humaines une valeur instrumentale.
39 Les limites avérées d’une conception purement utilitariste de la nature, qui impliquerait la possibilité pour l’homme de puiser dans ce réservoir sans restriction, ne font plus guère l’objet de contestations au sein la doctrine environnementaliste depuis les années 1970.
40 Toutefois, l’influence du courant anthropocentriste reste centrale en droit et reflète une réalité, celle de l’homme environné, propriétaire privé absolu doté sur ses biens des célèbres, et non moins critiquées, prérogatives d’ usus , fructus et abusus. Une conception plus souple de cette approche permet néanmoins à partir des années 1980, sous l’influence des travaux du philosophe allemand Hans Jonas, d’introduire le principe de responsabilité et la prise en compte de l’intérêt des générations futures dans les rapports homme-nature.
41 Selon la conception biocentrée de l’environnement, apparue dans les années 1970 grâce aux travaux des éthiciens de l’environnement, le bien-être de chaque être vivant a une valeur intrinsèque, indépendante de son utilité pour l’homme et qui doit être prise en compte dans le cadre des actions menées par les membres de la communauté humaine. La « perspective biocentrique » condamne la supériorité des humains et emporte un « renversement de la charge de la preuve » qui impose aux hommes de justifier de la nécessité d’exercer toute activité susceptible de porter atteinte à la valeur des êtres vivants (Taylor, 1981 : 197).
42 La question de la transposition de ces principes en droit dans les sociétés occidentales contemporaines fait l’objet de nombreuses controverses. Le plaidoyer de Christopher D. Stone pour l’attribution de droits et d’un intérêt à agir aux arbres faillit convaincre les juges de la Cour suprême des États-Unis (1972). La reconnaissance pour chaque être vivant d’une valeur morale digne de protection conduit en effet les défenseurs de l’éthique biocentrée à considérer que tous sont susceptibles d’être titulaires de droits juridiques (Taylor, 1981 : 197) 11 .
43 Sur la base d’une éthique écocentrée, souvent présentée par les éthiciens comme une voie médiane, l’opposition entre l’homme-sujet et l’environnement-objet de la vision anthropocentrée est dépassée, mais les êtres de l’environnement ne sont pas tous envisagés comme de potentiels sujets-titulaires de droit. L’homme attribue en revanche une valeur intrinsèque aux composantes de la nature. L’éthique écocentrée est finaliste et peut se traduire en droit par une approche élargie de la responsabilité environnementale.
44 En droit, ni le pouvoir constituant, ni le législateur ou le pouvoir réglementaire n’ont encore opté pour une définition précise et unitaire de l’environnement pouvant être rattachée à une éthique donnée. Cependant, malgré l’absence de définition en droit positif, la doctrine relève désormais, à juste titre, que le droit de l’environnement s’est longtemps fait le réceptacle d’une vision anthropocentrée des rapports homme-nature (Morand-Deviller, 2015).
45 Cet état du droit apparaît comme la continuation d’une tradition juridique marquée par l’influence de l’esprit humaniste et de la philosophie des Lumières, centrés sur l’humain, ainsi que par la place centrale accordée en droit à la summa divisio opposant les personnes aux choses.
46 Ainsi, les fondements et le texte de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution en 2005 se sont faits l’écho d’un certain anthropocentrisme en recentrant la protection de l’environnement autour de l’humain. De même, en droit européen originaire 12 , les textes consacrés à l’environnement se rattachent à l’objectif de développement durable 13 et de protection de la santé des personnes consacrant ainsi également une vision anthropocentrée de l’environnement.
47 Toutefois, les textes, les juges et la doctrine ont intégré, notamment durant les dernières décennies des apports de la vision écocentrée, tirant en quelque sorte les leçons des limites d’une vision purement utilitariste de la nature, par exemple en ordonnant, dans certaines conditions, la réparation des dommages causés aux éléments de la nature inappropriés et dépourvus de propriétaire, titulaire ou représentant. Ce changement de paradigme se traduit depuis les années 1970 par l’adoption en droit international comme en droit interne de textes qui organisent la protection des milieux de développement de la vie animale et végétale per se.
48 Deux évolutions plus récentes du droit positif témoignent ainsi de la réception des idées écocentristes. Il s’agit, d’une part, du passage de la conception d’un « environnement-objet » à un « environnement-système » (Godard, 1997 : 98) et de la prise en compte de l’interdépendance entre l’homme et son milieu. La greffe de concepts issus de l’écologie, comme la biodiversité, la biocénose ou l’écosystème, en droit de l’environnement en est le reflet. D’autre part, la consécration par le juge judiciaire du préjudice écologique pur en 2010 – et prochainement par le législateur qui examine actuellement les textes en prévoyant l’introduction expresse dans le Code civil – symbolise l’attribution d’une valeur intrinsèque aux ressources naturelles et la mise en œuvre d’une protection de l’environnement per se.
49 La définition de l’environnement pour le droit apparaît alors comme évolutive, comme la représentation ou la photographie dans une société et à une époque données des rapports entre les humains et la nature. Paradoxalement, pour cette même raison, les juristes ont dû se défaire du socle idéologique sur lequel repose la conception de la nature retenue dans une société et une époque données. Le concept d’environnement naît à travers l’idée de protection de la nature et s’en détache, apparaissant au fur et à mesure comme un concept plus neutre, d’un point de vue éthique, philosophique et politique. Aussi, depuis les années 1960, la définition de l’environnement, tel un curseur, se place – et se déplace – entre anthropocentrisme et biocentrisme, entre la nature sauvage ou naturelle et le « tout [ce] qui nous entoure ». Dès lors, l’environnement apparaît comme une notion éminemment complexe, une universalité indéterminée qui n’est jamais « entièrement » appréhendée par le droit.
50 Les difficultés théoriques qui entourent la définition de l’environnement pour le droit ne sont pas des obstacles dirimants pour en organiser la protection. En revanche, les juristes ont progressivement jugé indispensable, pour ce faire, de mettre à la disposition des acteurs du droit de l’environnement de véritables qualifications juridiques, vectrices d’un régime protecteur.
À la recherche d’une qualification juridique de l’environnement
51 Il est coutume, en droit, d’attacher à une qualification juridique prédéterminée un certain régime juridique. Le droit de l’environnement étant un droit finaliste, ce travail de qualification juridique apparaît, à la différence de l’exercice définitionnel, comme une condition sine qua non et un gage d’efficacité.
52 Ce n’est pas seulement pour l’environnement appréhendé comme un ensemble d’éléments que se pose cette question mais également pour chacun des éléments qui le composent et sont dans la sphère juridique des choses ou des biens dont le droit de l’environnement offre une nouvelle perspective.
La qualification juridique unitaire de l’environnement comme patrimoine commun
53 Initialement reçue en droit international, à la fin des années 1950, pour garantir un usage commun de ressources singulières, grâce à la consécration d’un patrimoine commun de l’humanité, l’expression « patrimoine 14 commun » s’est transformée au courant des années 1970, accompagnant l’adoption de nouveaux textes, en un concept vecteur de la protection de l’environnement.
54 Le législateur national y a également eu recours en qualifiant l’environnement de patrimoine naturel dont chacun a le devoir de veiller à la sauvegarde avec l’adoption de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, puis de patrimoine commun de la nation par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, l’expression étant désormais codifiée à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
55 Ce « patrimoine commun » transcende le concept de droit civil et s’y oppose sous certains aspects, mais n’emporte pas, à proprement parler, l’application d’un régime juridique aux éléments qui le composent. À ce titre il a été dénoncé par une partie majoritaire de la doctrine comme un concept purement incantatoire. En effet, le rattachement des composantes de l’environnement au patrimoine commun de la nation n’entraîne pas a priori l’application d’un régime juridique particulier.
56 Il n’est pas pour autant dépourvu de toute portée et ne peut être condamné. Une partie grandissante de la doctrine propose alors de lui donner une véritable portée, un sens en droit, le rapprochant d’une véritable qualification juridique, ainsi par exemple – mais sur des fondements différents – le philosophe et théoricien du droit François Ost (2003) et le privatiste François-Guy Trébulle.
57 Dans le cadre marqué par cette évolution, le patrimoine commun fait une apparition remarquée en jurisprudence dans la décision rendue par la Cour d’appel de Paris en 2010 dans l’affaire Erika. En effet, c’est sur la base de la consécration du « patrimoine commun » et à travers la reconnaissance d’un « intérêt collectif » que les juges de la Cour d’appel de Paris 15 entérinent la reconnaissance du préjudice écologique pur défini comme le préjudice « résultant d’une atteinte aux actifs non marchands réparables par équivalents monétaire, […] préjudice objectif, autonome, s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel […] qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ». Les juges d’appel, qui fondent leur décision, entre autres, sur l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, visent directement la qualification de patrimoine commun de la nation des éléments de l’environnement et en déduisent l’interdépendance existante entre l’homme et la nature en ces termes : « Il découle que toute atteinte non négligeable au milieu naturel constitue une agression à la collectivité des hommes qui vivent en interaction avec lui et que cette agression doit trouver sa réparation […] atteinte, de manière directe ou indirecte, à un intérêt collectif. » Pour la première fois, le « patrimoine commun » sert à fonder dans une décision de justice 16 la reconnaissance d’un intérêt collectif, distinct de l’intérêt général de protection de l’environnement auquel il est intimement hé, et légitime la réparation des dommages environnementaux.
58 Malgré cette jurisprudence, le concept de patrimoine en droit de l’environnement semble encore se cantonner au rôle de « réservoir » de valeurs (Rémond-Gouilloud, 1995 : 60). La référence au patrimoine commun n’a pas fleuri dans les décisions de justice et il demeure difficile de lui attacher un régime juridique déterminé et commun à ses composantes, elles-mêmes indéterminées.
59 Cependant, trois propositions, formant une chaîne de causalité, sur la portée (idéale ?) de ce concept, dont la théorie juridique reste à élaborer, peuvent être formulées.
60 Tout d’abord, le patrimoine « environnemental » est composé d’un ensemble de « biens environnementaux » dont le législateur affirme la volonté de protéger la valeur écologique pour parer le risque d’épuisement des ressources naturelles (Rémond-Gouilloud, 1989 : 108) et les conséquences de l’irréversibilité des dommages écologiques. Le statut juridique de ces biens, défini par d’autres branches du droit, importe peu à leur intégration dans ce patrimoine commun que les pouvoirs publics prétendent protéger comme une richesse collective à transmettre aux générations futures.
61 Par ailleurs, définie comme étant d’intérêt général par le législateur, la protection des biens environnementaux apparaît également à travers l’action du milieu associatif, notamment comme un intérêt collectif qui vient nécessairement se superposer aux intérêts individuels , et qui pose, dans certains cas, la question de leur annihilation.
62 Enfin et par conséquent, ce nouvel intérêt et objectif interroge l’articulation entre les droits des « titulaires de ce patrimoine commun » et ceux des propriétaires sur leurs biens. Certains voient le patrimoine commun comme « une qualification législative ambitieuse, opérant la dévolution symbolique des biens à un groupe identifié » (Groulier, 2005 : 1034), d’autres la reconnaissance effective de droits que ces titulaires (indéterminés) pourraient faire prévaloir sur les droits des propriétaires privés ou publics.
63 Sur ce point, la qualification patrimoniale offre en droit de l’environnement un grand nombre d’interprétations possibles, dont on ne peut encore dessiner un consensus doctrinal, ce qui explique certainement pourquoi les juges en font une utilisation très parcimonieuse.
64 Il n’est donc pas aisé de trancher la question de savoir si le patrimoine est, en droit de l’environnement, un « principe » (Groulier, 2005 : 1034) 17 , un « terme empirique » ou une « pure abstraction » (Sève, 1979 : 248), une représentation, une idée, un affichage politique, une simple « étiquette », un standard d’usage raisonnable, à l’image de celui de l’ancien « bon père de famille » imposant une gestion raisonnable des ressources ou une véritable qualification juridique.
65 Autrement dit, le patrimoine commun n’est pas (encore) cette catégorie juridique définie nécessaire à l’affectation de biens à des buts communautaires qu’évoquait le doyen Carbonnier (2008 : 381), mais il n’est pas non plus voué à demeurer dans le langage incantatoire, comme en témoigne sa mobilisation récente par les juges judiciaires.
66 Contribuant à cette imprécision, ni les réglementations mises en place par le législateur et le pouvoir réglementaire, ni les solutions adoptées par les juridictions administratives et judiciaires depuis la fin des années 1970 ne répondent précisément à l’idéologie qui lui est sous-jacente, à savoir celle d’un rapport de droit collectif de protection primordial entre les sujets et l’environnement. En effet, dans la majeure partie des cas, l’objectif de préservation des composantes de l’environnement doit intégrer ou s’articuler avec un objectif de valorisation économique des ressources naturelles.
La qualification juridique des biens environnementaux
67 Le droit de l’environnement ne s’intéresse pas uniquement à la protection de l’environnement comme ensemble, mais également dans la diversité de ses composantes. Pourtant, ces dernières ne sont pas toujours strictement dotées d’une qualification juridique par le législateur et le pouvoir réglementaire, notamment lors de l’adoption de grandes lois sectorielles dans les années 1980 et 1990, par exemple la loi littoral en 1986, la loi sur l’eau de 1992 ou encore la loi sur l’air en 1996. Ces derniers s’inspirent généralement des concepts et catégories issus des sciences naturelles.
68 En outre, même lorsqu’elles existent, les qualifications protectrices des composantes de la nature pour le droit de l’environnement sont susceptibles de se heurter aux qualifications utilitaristes du Code civil et, plus largement, du droit des biens. Ainsi, le Code de l’environnement adopte ses propres qualifications que le Code civil ne connaît pas. Les choses de la nature relèvent de la matière mais ne sont pas pour autant toujours appropriables et elles ne peuvent toujours être soumises ni à notre joug, ni à l’approche réificatrice du Code civil.
69 Ainsi, à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, le législateur, depuis les grandes lois de 1976 et de 1995, rattache au patrimoine commun de la nation, « les espaces et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques ». Les termes retenus et l’utilisation du pluriel à plusieurs reprises font indéniablement écho à la grandeur de la nature, en même temps qu’ils questionnent le rapport individu-chose (au singulier cette fois).
70 Aussi, le droit de l’environnement ne s’intéresse-t-il pas à la protection d’un animal ou à la parcelle d’un propriétaire mais à la protection des « espèces » et des « espaces » en lien – un lien de droit encore flou – avec la « communauté » de la nation.
71 En dehors des composantes de article L. 110-1 du Code de l’environnement, d’autres biens environnementaux apparaissent dans la législation environnementale, voire dans la pratique économique, dont le droit se saisit, par exemple depuis une quinzaine d’années la biodiversité ou les « services écologiques ». Ces biens ne peuvent, jusqu’à présent, être expressément rattachés ni aux biens appropriés, ni aux choses communes 18 en vertu des textes et de la jurisprudence. Ils répondent à une dynamique qui ne s’ajuste pas à celle du droit de propriété. Il en va de même de certains éléments appréhendés par le droit que l’on refuse parfois de rattacher sur le principe au droit de l’environnement mais qui ne mettent pas moins en avant de nouveaux biens environnementaux : par exemple le « vivant » ou la « matière nucléaire ». Enfin, certains biens, initialement définis comme tels par le pouvoir normatif, comme les quotas de gaz à effet de serre introduits en droit interne en 2004 ou les certificats d’économie d’énergie créés en 2005, sont rattachés à la catégorie des droits de propriété, mais celle-ci évoque bien plus une approche économique que juridique de la propriété.
72 Dans ce contexte, la doctrine environnementaliste cherche donc à établir ces nouvelles catégories de choses et de biens que met en relief la législation environnementale. Ainsi, François-Guy Trébulle distingue deux composantes essentielles au sein de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement et oppose la « nature » au « patrimoine humain » (2009 : 17). La nature recouvre la majeure partie des biens environnementaux 19 , énumérés par le Code de l’environnement, par exemple les espaces, ressources et milieux naturels, tandis que le « patrimoine humain » renvoie à une dimension plus anthropocentrée – l’environnement comme milieu et son aspect culturel –, par exemple à travers la protection des sites et des paysages.
73 Enseignant-chercheur en droit privé, Nadège Reboul-Maupin propose, quant à elle, de distinguer au sein des « biens environnementaux » tout d’abord des biens « élémentaires » et des biens « complexes », comme les troupeaux ou les forêts, puis des biens « objectifs » et « subjectifs », selon leur dimension affective et sensible dans leur rapport à l’homme et/ou, enfin, des biens « durables » et des biens « précaires » (2009).
74 La doctrine tente plus largement de rattacher les composantes de l’environnement aux catégories établies du droit des biens, ce qui aboutit, le plus souvent, soit à déformer ces catégories, soit à élargir grossièrement la catégorie des choses communes, alors même que le propriétaire – voire dans certains cas de « simples » exploitants – exerce indéniablement sur une partie de ces biens des prérogatives fortes, notamment le droit d’en disposer et d’en abuser.
75 L’inadéquation est donc à double sens puisque les catégories de biens appropriés visées par le Code civil ne sont pas, non plus, adaptées à la réception des biens environnementaux, comme en témoigne la rigide opposition entre les biens meubles 20 et les biens immeubles, à laquelle le vivant, la biodiversité, les animaux, voire les sols, ne sauraient se plier dans une approche strictement environnementale.
76 Cette double inadéquation s’est largement manifestée à travers les difficultés rencontrées par le législateur interne depuis la formation du droit de l’environnement pour organiser un véritable droit de la protection des sols dans le carcan de la propriété foncière.
77 Les objectifs poursuivis et les méthodes employées sont différents en droit de l’environnement et en droit des biens, ce qui justifie certainement des qualifications juridiques différentes mais crée, par ailleurs, des risques de distorsions dans l’application des règles de droit et des difficultés pour le juge de se saisir de nouvelles catégories de biens qui n’embrassent pas les qualifications juridiques du droit des biens. Mais le rapport entre l’homme et les choses, certainement essentiel en droit, doit-il nécessairement être unidimensionnel ?
78 Rien ne fait obstacle à retenir, a priori , une approche pluridimensionnelle du rapport entre l’homme et les choses qui l’entourent, à partir du moment où sont prévues les règles qui permettent de résoudre les conflits entre l’application de droits fondés sur des finalités divergentes. D’ailleurs, cette vision permettrait de dépasser l’approche moniste du droit de propriété, qui n’envisage que la fonction utilitariste des biens (Trébulle, 2009 : 23).
79 Or de ce point de vue, le principe d’intégration ne remplit pas sa fonction, concernant les biens environnementaux. Il est encore majoritairement conçu comme une norme d’articulation des exigences économiques et environnementales dans les politiques publiques, sans que ne puissent en être déduites des règles concrètes relatives au statut des biens.
80 Sans doute, l’établissement de nouvelles catégories de biens, dans le Code civil, et/ou la qualification plus stricte de certains biens dans la législation environnementale participeraient-ils d’une plus grande mise en cohérence de ces législations. Toutefois, ces inadéquations ne semblent pas se restreindre à des apories définitionnelles. Elles éveillent la nécessité de donner une nouvelle traduction à un jeu complexe entre les différentes utilités des choses de la nature pour les êtres humains.
L’environnement : un objet de droit(s) indéfini ?
81 Même s’il n’a pu être strictement défini ou qualifié, l’environnement est devenu un objet du droit majeur protégé par un nombre de textes sans cesse croissant. Cette évolution n’est pas seulement quantitative. Elle est également marquée, dans sa dimension qualitative, par la reconnaissance de l’environnement comme objet de droit(s), de droit des personnes sans aucun doute, voire de droit(s) de l’environnement per se. La consécration du droit à l’environnement et la reconnaissance du préjudice écologique pur en sont les manifestations les plus notoires. Néanmoins dans un cas comme dans l’autre, les avancées du droit de l’environnement soulèvent bien plus de questions qu’elles n’en résolvent.
Les contours imprécis du droit à l’environnement
82 Dans l’ordre juridique interne, la première formulation législative expresse du droit à l’environnement est le fruit de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ainsi, en vertu de l’article L. 110-2, alinéa premier, du Code de l’environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. » Toutefois, ce droit n’était pas directement invocable et, de valeur législative, il devait « s’effacer » devant les droits de valeur constitutionnelle (Rebeyrol, 2009 : 32). C’est donc essentiellement le « droit à l’environnement » de valeur constitutionnelle, consacré à l’article premier de la Charte de l’environnement en vertu duquel « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », qui a suscité l’attention de la doctrine et dont les juges ont encore à déterminer le contenu et l’étendue.
83 En outre, la consécration d’un droit de l’homme au respect de l’environnement ou d’un droit à l’environnement conçu comme droit fondamental dépasse la consécration constitutionnelle réalisée par la Charte de l’environnement, puisqu’il est formulé dans des textes de droit international, reconnu par des droits étrangers et appliqué indirectement, par le biais de « droits-relais » par les juges supranationaux (Kiss, 2004), notamment par la Cour européenne des droits de l’homme.
84 Comme l’a souligné Michel Prieur, la reconnaissance d’un « droit à l’environnement » a certainement été la contribution la plus importante de la Charte de l’environnement sur le plan symbolique et juridique (2005 : 1157). L’étendue des conséquences potentielles de cette reconnaissance n’a néanmoins pas fini d’être analysée, mesurée et critiquée, tant les applications effectives de ce droit par le juge national sont encore restreintes. À cet égard, c’est le Conseil constitutionnel qui, jusqu’à présent, a défini le plus précisément la portée de ce nouveau droit à partir de l’articulation du droit à l’environnement et du devoir de protection de l’environnement respectivement consacrés par les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement. En effet, les juges constitutionnels considèrent que
[…] le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif, mais également à l’ensemble des personnes ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ; qu’il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation ; que toutefois, il ne saurait, dans l’exercice de cette compétence, restreindre le droit d’agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée 21 .
85 Avec l’adoption de la Charte, l’environnement devient donc l’objet d’un droit individuel, mais l’incidence du passage d’une protection directe des éléments de l’environnement à la reconnaissance d’un droit subjectif ou, du moins d’un droit de la personne, voire d’un droit fondamental à l’environnement, n’est pas dénuée d’ambiguïté.
86 Au-delà des hésitations jurisprudentielles dont il est encore l’objet, le droit à l’environnement renouvelle le débat théorique relatif à la place de l’environnement dans le monde du droit. Aussi la consécration d’un droit à l’environnement soulève-t-elle deux séries de questions centrales : la première tenant à la place accordée à l’individu au détriment de l’environnement, et la seconde à la potentielle disparition de la dimension collective du rapport entre les êtres humains et la nature.
87 En effet, la reconnaissance du droit à l’environnement entraîne le déplacement de l’attention du juriste des biens vers la personne. Ne serait-ce que symboliquement, en cas d’atteinte au droit à l’environnement ainsi consacré, les juges 22 se focalisent sur la violation du droit d’une personne et non plus strictement sur l’atteinte aux biens environnementaux, qui relève alors du domaine factuel. Dès lors, le droit reconnu à l’article I er de la Charte place la personne et la vie humaine au cœur du dispositif et de l’exigence de protection de l’environnement.
88 Ces interrogations sont renforcées au vu de la jurisprudence constitutionnelle et de la reconnaissance d’une obligation de vigilance de chacun à l’égard des atteintes à l’environnement. À partir de la critique de la référence conjointe aux articles 1 et 2 de la Charte pour désigner une « obligation », là où le texte de l’article I er consacre un « droit », Vincent Rebeyrol, professeur associé et avocat, met ainsi en relief la place secondaire attribuée aux biens environnementaux : « Définir un droit comme uniquement créateur d’obligations pour ses sujets, c’est le qualifier de droit personnel […] mais tous les droits, loin s’en faut, ne sont pas des droits personnels. Particulièrement, le droit à un environnement sain et équilibré se rapproche bien davantage d’un droit réel : non seulement son objet est constitué de choses matérielles (eau, air […]) mais il reconnaît à son titulaire un droit de jouissance sur cet objet, indépendamment de toute obligation » (2011 : 1258).
89 Ce déplacement du droit des biens et du droit de l’environnement vers un droit de la personne soulève de nombreuses questions. Si une personne décide d’invoquer son droit à l’environnement en cas d’atteinte à une chose qui n’appartient à personne au sens du Code civil, par exemple l’air, faudra-t-il évaluer le préjudice qui est causé à la ressource ou celui qui est causé à la personne ? Sera-t-il possible d’évaluer à la fois la valeur instrumentale et intrinsèque des ressources naturelles ? Comment articuler ce droit, le cas échéant, avec l’exercice de prérogatives du propriétaire d’un bien environnemental ?
90 La formulation retenue par la Charte écarte toute incertitude sur la titularité du droit. Le constituant consacre bien un droit individuel à l’environnement. Le caractère individuel de ce droit est considéré comme la garantie de sa meilleure effectivité, puisqu’il lui permet d’entrer dans les canons du droit largement déterminés par la théorie de la personnalité juridique (Rebeyrol, 2009 : 105). En revanche, cette titularité individuelle du droit à l’environnement n’implique pas nécessairement que son exercice soit strictement individuel.
91 Si l’exercice de ce nouveau « droit à » peut être collectif, comme en témoigne l’admission par le juge de l’intervention d’une association de protection de l’environnement sur le fondement de l’article I er de la Charte de l’environnement 23 , la véritable dimension collective du droit à l’environnement est désormais essentiellement philosophique ou morale. Elle découle, entre autres, de la référence dans le préambule de la Charte au « patrimoine commun des êtres humains ». Or, si l’environnement est le « patrimoine commun des êtres humains », le droit des hommes sur l’environnement ne devrait-il pas également être un droit collectif ?
92 L’environnement est incontestablement devenu l’objet d’un droit individuel des personnes, mais la portée de cette reconnaissance est encore à définir. Dès lors, la nature indéterminée du « droit à l’environnement », qui se heurte aux catégories du droit civil, notamment à la distinction droit réel-droit personnel 24 et n’intègre pas pleinement la catégorie des droits et libertés fondamentaux, invite indéniablement le juriste à repenser les liens de droit qui unissent les hommes à la nature depuis le seul prisme du droit de l’environnement, sans nécessairement craindre de bousculer les catégories traditionnelles du droit des biens (Deffairi, 2015).
93 Pour Mireille Delmas-Marty, professeur honoraire au Collège de France, les limites des possibilités offertes par les droits « de l’homme » invitent le juriste à concevoir une nouvelle relation entre l’humain et le non-humain « afin de mettre le droit au service de la relation entre les humains et les autres espèces vivantes, plutôt qu’au seul service du bon fonctionnement de la société humaine » (2011 : 277). Il serait alors possible de distinguer le droit de l’homme à un environnement sain du droit de l’animal, de l’environnement, du respect de l’intégrité des organismes vivants, etc.
La reconnaissance inaboutie de droit(s) de l’environnement per se ?
94 Il y a très peu de temps encore, la consécration d’un préjudice écologique pur semblait impossible aux juristes car elle était incompatible avec les fondements du système juridique. Pourtant, après sa consécration jurisprudentielle, entre 2007 et 2010, il est désormais sur le point d’être reconnu par le législateur. Cette (Révolution témoigne d’une prise en compte de l’environnement per se et non plus uniquement en considération de sa valeur pour les êtres humains. Elle modifie profondément les carcans de la pensée juridique et exhume les débats relatifs à la reconnaissance d’une nature sujet de droit.
95 En effet, la consécration du préjudice écologique pur par les juges judiciaires dans le cadre de l’affaire Erika 25 , pétrolier dont le naufrage avait causé des dommages environnementaux considérables dont une grande partie touchaient des ressources naturelles inappropriées, et sa reconnaissance en cours par le législateur 26 suscitent plusieurs réflexions sur les rapports que les choses de la nature entretiennent avec les sujets de droit. Elle emporte la nécessité de délimiter les différents chefs de préjudice invocables dans le contentieux de la responsabilité environnementale, donc d’identifier plus clairement les droits auxquels les dommages à l’environnement sont susceptibles de porter atteinte et, le cas échéant, de souligner les carences du droit en la matière.
96 La reconnaissance du préjudice écologique pur invite les juristes à opérer une clarification sur la distinction entre les différents intérêts appréhendés par le droit, notamment les intérêts de la nature, l’intérêt général ainsi que les intérêts collectifs et privatifs. Aussi la doctrine s’attache-t-elle plus particulièrement depuis 2010 à distinguer la protection de l’environnement per se et, non seulement, la protection de l’intérêt collectif des êtres humains de jouir d’un environnement sain, mais également la protection des droits privatifs des personnes sur l’environnement et ses composantes, par exemple un propriétaire sur son terrain (Deffairi, 2015). Dans cette même optique, depuis la consécration du préjudice écologique pur, elle s’attelle à clarifier les différents postes de préjudice pouvant être soulevés dans le contentieux indemnitaire engendré par la réalisation de dommages à l’environnement (Martin et Neyret, 2012).
97 De 2000 à aujourd’hui, le travail d’identification du préjudice écologique pur a ainsi permis d’affiner sa définition et ses fondements, d’une part, et de le détacher de l’intérêt collectif auxquels les juges d’appel l’avaient initialement rattaché, d’autre part. L’intérêt collectif de protection de l’environnement est un intérêt des êtres humains, alors que le préjudice écologique pur renvoie à la prise en compte de l’intérêt de l’environnement et de ses composantes, ces intérêts pouvant coïncider ou s’opposer.
98 À cet égard, à partir des textes, les juristes identifient plus facilement les fondements juridiques, c’est-à-dire les raisons d’être, de la réparation des atteintes causées aux intérêts collectifs, par exemple à travers le concept de patrimoine commun reconnu à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement ou la reconnaissance par l’article L. 161-1-4° du même code des services écologiques rendus au bénéfice du public.
99 Le fondement juridique substantiel du préjudice écologique pur restant, quant à lui, à clarifier, deux raisonnements différents peuvent être formulés.
100 Le premier consiste à considérer que l’environnement en tant que tel ne peut pas être lui-même titulaire de droits et que la protection de la valeur intrinsèque de l’environnement résulte d’un choix éthique des êtres humains. Dans ce cas, ce choix éthique peut être rattaché à des fondements juridiques divers, notamment au devoir de toute personne de contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement consacré à l’article 4 de la Charte de l’environnement ou à la reconnaissance, dans la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, du dommage environnemental et, plus particulièrement, des services écologiques rendus par les composantes de l’environnement au bénéfice des ressources naturelles elles-mêmes (article L. 161-1. 4° du Code de l’environnement).
101 Sur la base du second, on admet que la nature et ses composantes ont des intérêts juridiques propres, c’est-à-dire qu’elles peuvent être titulaires de droits, donc sujets de droit. Saisie comme une révolution quant aux fondements philosophiques qu’elle invoque et aux transformations juridiques quelle implique, la « nature-sujet » reste l’œuvre d’une doctrine environnementaliste minoritaire 27 qui ne convainc pas toujours sur le plan théorique. Pourtant, elle pourrait, dans une certaine mesure, enrayer les excès d’une approche strictement utilitariste et donner à la fiction du droit de l’environnement une certaine cohérence en faisant des intérêts de l’environnement des intérêts suffisamment forts pour affronter les autres intérêts défendus (Caballero, 1981 : 311), c’est-à-dire les intérêts humains.
102 En effet, si la réparation d’un préjudice est celle de la lésion d’un intérêt pour ne pas dire d’un droit subjectif, la réparation du préjudice écologique n’emporte-t-elle pas nécessairement la reconnaissance des intérêts (subjectifs ?) de la nature ?
103 La reconnaissance d’un environnement sujet de droit permettrait de lutter à la fois contre les excès d’une conception réificatrice et utilitariste, réductrice des composantes de l’environnement, et contre la dépendance de la défense de la nature à l’existence d’intérêts humains.
104 Bien qu’il reste l’apanage d’une doctrine minoritaire en France (Hermitte, 1985), ce plaidoyer pour la qualification de la nature comme sujet de droit n’est ni utopique ni fantaisiste, comme en témoigne sa consécration dans les législations étrangères. Ainsi, les constitutions équatorienne et bolivienne, pays marqués par les cultures indigènes de la Terre-Mère, établissent des droits de la nature, appréhendée per se , ou des « droits à », en quelque sorte des droits subjectifs, de la nature mais c’est surtout dans la loi sur la Terre-Mère du 21 décembre 2010 que le législateur bolivien, qui définit la Terre-Mère comme un « système vivant » sur le plan biologique et comme un « sujet collectif d’intérêt public » sur le plan juridique, accorde des droits à la nature : le droit à la vie, le droit à la diversité de la vie, le droit à l’eau, à l’air propre, à l’équilibre, à la réparation et le droit de vivre sans pollution résultant d’une activité humaine 28 .
105 Néanmoins, il s’avère que la consécration expresse d’une nature-sujet en droit ne résoudrait pas nécessairement l’ensemble des problèmes liés à son statut d’objet.
106 Reste ainsi à désigner quels seront les porte-parole de ces intérêts de la nature, de l’environnement per se. Les associations, les collectivités territoriales, voire les justiciables individuellement pourraient en être chargés. La résolution de cette question a néanmoins souvent été un frein à la consécration du préjudice écologique pur par le pouvoir législatif. En effet, l’identification des composantes de la nature auxquelles serait attribuée la qualité de sujet de droit et la détermination incontournable de personnes susceptibles de la représenter en justice font débat. Pour Martine Rémond-Gouilloud, l’incapacité à se passer de la médiation de l’homme rend l’attribution de la qualité de sujet de droit à la nature dénuée d’une « utilité décisive » en droit de l’environnement (1985 : 217) 29 . Autrement dit, si elle ne peut se passer d’une intervention humaine, l’imputation de droits et obligations à la nature à travers sa qualification comme sujet de droit n’est pas déterminante dans la protection de cet intérêt. En ce sens, la doctrine a pu proposer une comparaison de la nature avec la famille qui « n’a pas eu besoin d’être érigée en sujet de droit pour que des devoirs et des droits en régissent le fonctionnement » (Huglo et Lepage-Jessua, 1995 : 81).
107 Aussi, le droit positif français ne reconnaît-il pas la nature comme sujet de droit. L’attribution de droits propres de l’environnement ne prend, jusqu’à présent, que des formes inabouties ou inavouées, par exemple à travers la réparation du préjudice écologique pur ou la reconnaissance par le législateur des animaux comme « êtres vivants doués de sensibilité » sans condamner leur statut d’objet de droit par ailleurs 30 .
108 Malgré des avancées certaines du droit, l’animal, être vivant, et l’ensemble des composantes de la nature (Farjat, 2002 : 221) 31 , ne trouvent que difficilement leur place en étant à la fois objets de droit – en raison de leur valeur patrimoniale – et sujets en devenir – en raison de la valeur affective et/ ou écologique que le législateur leur attribue désormais. En d’autres termes, l’alliance des exigences d’exploitation économique et de protection de l’environnement leur empêche de trouver leur place en droit, d’intégrer les catégories juridiques établies.
109 C’est encore la place centrale de la fonction économique des animaux et des choses de la nature ainsi que leur utilité pour l’homme qui les rend difficilement détachables du statut de choses ou de biens. Sans nul doute serait-il beaucoup plus facile de lever l’obstacle éthique de la frontière humanité-animalité dans l’élaboration de nouveaux concepts juridiques si cette finalité économique ne devait être préservée.
110 Le droit de l’environnement devient alors le lieu de la réception de concepts et du développement de propositions théoriques novatrices dans le monde du droit comme la reconnaissance de « centres d’intérêt » (Farjat, 2002), du « non sujet de droit » (Carbonnier, 1989 : 197) ou de « choses-milieux » (Vanuxem, 2012 : 107). Ces analyses, d’une part, révèlent le dépassement du diptyque sujet-objet à partir de l’exigence de protection de valeurs nouvelles et en principe non marchandes, et sont d’autre part la preuve de l’insuffisance d’une réflexion centrée sur le seul objet appréhendé par le droit.
111 Il est majoritairement considéré par les juristes que la fonction dite économique ou utilitaire des composantes de l’environnement ne peut être totalement annihilée, et que la summa divisio opposant les personnes aux choses ne devrait pas être abandonnée dans la fiction du droit. Même en admettant ces postulats désormais remis en cause par la perspective environnementaliste, il apparaît nécessaire de redéfinir le rapport de maîtrise des sujets de droit sur l’environnement pour y intégrer et/ou y superposer un rapport de protection de la valeur intrinsèque de ses composantes, à la hauteur des intérêts qui la contrarient.
Notes de bas de page
1 Le terme désigne ici à la fois les juges judiciaires et administratifs.
2 La doctrine peut à la fois désigner l’ensemble des auteurs et/ou l’ensemble des travaux juridiques, couvrant notamment les opinions de ceux qui enseignent le droit ou écrivent sur le droit.
3 L’idée d’une « constitutionnalisation » du droit de l’environnement est appelée de ses vœux par une partie de la doctrine à partir du milieu des années 1970, mais ce n’est qu’en 2005 qu’elle se concrétise avec l’adoption de la Charte de l’environnement. Cette dernière est rédigée par une commission dirigée par Yves Coppens, professeur au Collège de France et paléontologue, composée de professionnels et de personnalités. Elle intervient « à froid » et, comme le décrit le professeur Jegouzo, renforce l’importance donnée aux préoccupations environnementales lors de son adoption (2005).
4 Cette évolution s’accompagne des travaux d’une nouvelle « génération » d’enseignants-chercheurs en droit de l’environnement, par exemple et à titre non exhaustif, Agathe Van Lang, François-Guy Trébulle, Philippe Billet, Laurent Fonbaustier et Gilles Martin puis plus tard Laurent Neyret.
5 Voir par exemple l’article 524 du Code civil.
6 Voir notamment l’article L. 110-1 du Code de l’environnement et nos développements ultérieurs.
7 Introduit à l’origine par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (anciennement codifié à l’article L. 200-1 du Code rural), modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
8 Christian Huglo est un avocat français spécialisé en droit de l’environnement ; également auteur et enseignant, il fonde un des premiers cabinets d’avocats spécialisés en la matière où il est rejoint par Corinne Lepage, avocate et femme politique. Ils interviennent tous deux dans de nombreuses conférences et ont activement participé à faire évoluer le droit de l’environnement.
9 Il s’agit de la définition commune et non propre à un champ scientifique tirée du Petit Robert de la langue française.
10 Sur ces questions, voir la contribution dans ce volume de C. Larrère.
11 L’auteur fait alors référence, non pas à des droits moraux , mais bien à des droits juridiques et précise : « L’on pourrait envisager de leur accorder une protection juridique, ce qui signifierait qu’on leur reconnaîtrait un titre juridique à être protégé – moyen par lequel une société souscrivant à l’éthique du respect de la nature reconnaîtrait publiquement leur valeur inhérente. »
12 Le droit européen originaire désigne les traités fondateurs par opposition au droit européen dérivé qui désigne les normes produites par les institutions européennes.
13 Voir par exemple les articles 11 et 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
14 Le terme patrimoine est lui-même une notion héritée du droit romain où il désignait l’ensemble de biens du paterfamilias , comme universalité de fait que ce dernier protégeait et gérait pour le transmettre en héritage. Il recouvre des sens proches mais divergents dans les différentes branches du droit et notamment en droit civil, en droit administratif, en droit du patrimoine culturel, etc. Il renvoie généralement à l’idée d’un ensemble de biens qui doit être géré et ou protégé de façon diligente et raisonnable afin d’être transmis aux héritiers, aux générations futures, etc. (Deffairi, 2015 : 20 et suiv.). Le patrimoine commun se traduit en anglais par les termes common heritage souvent utilisés en droit international.
15 Dans l’arrêt d’appel rendu dans l’affaire du naufrage de l’Erika, CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278.
16 Toutefois, Mireille Delmas-Marty (2001 : 276) relève que l’expression « patrimoine commun de la Communauté européenne » avait également été utilisée dans les décisions de la CJCE « pour justifier la limitation de la marge d’appréciation nationale », voir l’arrêt de la CJCE, Commission c/Espagne , C-235-04, 28 juin 2007, § 23-27.
17 Pour cet auteur, « partant du concept que le législateur l’introduit toujours en droit positif comme une donnée première, conditionnant les développements normatifs qui suivent, il faut analyser le concept […] comme un principe, au sens le plus élémentaire du terme, et plus précisément comme un principe dans le droit. L’expression “principe juridique” pourrait en effet conduire à une assimilation erronée avec les principes œuvrant déjà dans la discipline. L’habit du principe est ici une voie d’effectivité du concept de patrimoine commun qui érode considérablement l’exclusivisme juridique présidant au rapport des sujets de droit aux choses ».
18 Les choses communes sont définies par l’article 714 du Code civil comme les choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage appartient aux tous. Elles sont en principe inappropriables et s’opposent traditionnellement à la catégorie des biens appropriés. Entre les deux on trouve également les res nullius ou res derelictœ qui n’appartiennent à personne mais sont susceptibles d’appropriation.
19 L’expression est ici entendue comme couvrant à la fois des choses inappropriables ou appropriables et des biens appropriés.
20 Les biens meubles sont ici définis comme les biens qui peuvent être transportés d’un lieu à un autre par opposition aux immeubles qui ne peuvent être déplacés.
21 Saisi, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge néanmoins que l’article L. 112-16 du CCH, qui restreint dans des circonstances bien précises l’exercice d’une action en réparation pour les dommages causés par des troubles anormaux du voisinage, ne méconnaît pas le droit à l’environnement défini à l’article I er de la Charte. Voir la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC.
22 Notons ici une différence entre son invocabilité en droit interne qui n’est, a priori , pas exclusive de l’engagement d’une action en responsabilité classique concernant l’atteinte aux biens avec, depuis peu, la possibilité de se prévaloir d’un dommage écologique pur et sa protection par les juges supranationaux devant lesquels seules les atteintes portées aux droits de l’homme sont invocables.
23 Voir l’ordonnance du 29 avril 2005 du TA de Châlons-en-Champagne, n os 0500828, 0500829, 0500830, Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne et autres.
24 Le titulaire d’un droit réel exerce son droit sur un bien, alors qu’il exerce un droit personnel face à une personne.
25 Voir TGI de Narbonne 4 octobre 2007, TGI de Tours, 24 juillet 2008 et Cass. Crim., 25 septembre 2012, dans l’affaire de l’Erika, arrêt n° 3439, pourvoi n° 10-82.938 et en appel, CA de Paris, 30 mars 2010, RG 08/02278.
26 Voir la proposition de loi visant à inscrire la notion de dommage causé à l’environnement dans le Code civil (proposition « Retailleau ») votée par le Sénat le 16 mai 2013.
27 Voir plus largement sur ces questions les travaux de Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherches au CNRS et directeur d’études à l’EHESS.
28 Voir les articles 3 à 7 de la loi n° 071 du 21 décembre 2010 (http://bolivia.infoleyes.com/ shownorm.php?id=2689).
29 Effectivement l’attribution de la qualité de sujet de droit n’est pas dénuée d’intérêt pour la « défense de la nature », mais ces avantages ne sont pas « décisifs » puisqu’ils peuvent être obtenus par d’autres biais.
30 Voir la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
31 Mais pour des raisons parfois divergentes. Pour certains, l’animal ferait partie des choses personnifiées en raison de sa proximité avec l’être humain, de son caractère vivant, alors que le statut des composantes de la nature évoluerait, avant toute assimilation (sauf pour les tenants du biocentrisme), en raison d’une exigence de protection accrue.
Docteure en droit de l’environnement et maître de conférences en droit public à l’université Paris II Panthéon-Assas, elle a publié en 2015 aux éditions IRJS La patrimonialisation en droit de l’environnement , thèse de doctorat remaniée, rédigée sous la direction de Maryse Deguergue. Elle travaille également sur le droit de l’environnement, le droit administratif général, le droit administratif comparé, le droit de l’urbanisme et le droit au logement.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books . Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Être Parisien
Claude Gauvard et Jean-Louis Robert (dir.)

Les historiens croient-ils aux mythes ?
Kalifa Dominique (dir.)

Enfermements. Volume II
Règles et dérèglements en milieu clos ( iv e - xix e siècle)
Heullant-Donat Isabelle, Claustre Julie, Bretschneider Falk et al. (dir.)

Une histoire environnementale de la nation
Regards croisés sur les parcs nationaux du Canada, d’Éthiopie et de France
Blanc Guillaume

Temps de travail et travail du temps
Monchatre Sylvie et Woehl Bernard (dir.)

Enfermements. Volume III
Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos ( xiii e - xx e siècle)
Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset et al. (dir.)

Se faire contemporain
Les danseurs africains à l’épreuve de la mondialisation culturelle
Altaïr Despres

La vengeance en Europe
xii e au xviii e siècle
Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)

Couples en justice iv e - xix e
Allessandro Stella Claude Gauvard (dir.)

La décapitation de Saint Jean en marge des Évangiles
Essai d’anthropologie historique et sociale
Claudine Gauthier

Enfermements. Volume I
Le cloître et la prison ( vi e - xviii e siècle)
Julie Claustre, Isabelle Heullant-Donat et Élisabeth Lusset (dir.)

Du papier à l’archive, du privé au public
France et îles Britanniques, deux mémoires
Jean-Philippe Genet et François-Joseph Ruggiu (dir.)

Accès ouvert freemium
PDF du chapitre
Édition imprimée
Ce livre est cité par
- Le Meur, Pierre-Yves. Rodary, Estienne. (2022) Le foncier rural dans les pays du Sud . DOI: 10.4000/books.irdeditions.45513
- Cottet, Marylise. Morandi, Bertrand. Piégay, Hervé. (2021) River Restoration . DOI: 10.1002/9781119410010.ch1
- (2022) À l'est des rêves . DOI: 10.3917/dec.marti.2022.02.0281
- Bretelle-Establet, Florence. Gaille, Marie. Katouzian-Safadi, Mehrnaz. (2019) Boston Studies in the Philosophy and History of Science Making Sense of Health, Disease, and the Environment in Cross-Cultural History: The Arabic-Islamic World, China, Europe, and North America . DOI: 10.1007/978-3-030-19082-8_1
- (2021) Premio Ricerca «Città di Firenze» Biopolitica ed ecologia . DOI: 10.36253/978-88-5518-384-0
- Khalsi, Khalil. (2021) Faute de mieux : instaurer les autres qu’humains. Cahiers de recherche sociologique . DOI: 10.7202/1097425ar
- Petitat, André. (2019) Codes et intelligences : externalisation, effets en retour et brouillage des frontières entre nature et culture. SociologieS . DOI: 10.4000/sociologies.9625
- Guimont, Clémence. (2018) La perte de biodiversité au prisme du New public management : les angles morts des indicateurs écologiques. Pôle Sud , n° 48. DOI: 10.3917/psud.048.0043
- Laslaz, Lionel. (2017) Jalons pour une géographie politique de l’environnement. L’Espace Politique . DOI: 10.4000/espacepolitique.4344
- Milanovic, Fabien. (2018) Protéger des espaces naturels. Revue d'anthropologie des connaissances , 12. DOI: 10.3917/rac.038.0057
- Costa, James. (2020) Through the looking glass. Language, Culture and Society , 2. DOI: 10.1075/lcs.00024.cos
- Orain, Olivier. (2017) Nature, environnement et géographie. L’Espace géographique , Tome 46. DOI: 10.3917/eg.463.0231
- Barraud, Régis. Andreu-Boussut, Vincent. Chadenas, Céline. Portal, Claire. Guyot, Sylvain. (2019) Ensauvagement et ré-ensauvagement de l’Europe : controverse et postures scientifiques. Bulletin de l'Association de géographes français , 96. DOI: 10.4000/bagf.5141
- Charles, Lionel. Kalaora, Bernard. (2019) Société du risque, environnement et potentialisation des menaces : un défi pour les sciences sociales. Développement durable et territoires . DOI: 10.4000/developpementdurable.15302
- Crenn, Chantal. Gobatto, Isabelle. Ndiaye, Abdourahmane. Tibère, Laurence. Seye, Moustapha. Ka, Abdou. (2023) Alimentation, environnement et santé : l’Afrique au cœur des changements globaux contemporains. Anthropology of food . DOI: 10.4000/aof.14182
- Guyot-Téphany, Josselin. Perrin, Jacques-Aristide. (2018) Potentialités et limites de la notion de capital environnemental au regard de la crise environnementale contemporaine. VertigO . DOI: 10.4000/vertigo.19050
- Babou, Igor. (2017) The political workshop of nature. Questions de communication . DOI: 10.4000/questionsdecommunication.11764
- Boisvert, Valérie. Carnoye, Leslie. Petitimbert, Rémy. (2019) « La durabilité forte : enjeux épistémologiques et politiques, de l’économie écologique aux autres sciences sociales ». Développement durable et territoires . DOI: 10.4000/developpementdurable.13837
- Uhl, Magali. Khalsi, Khalil. (2021) Introduction. Cahiers de recherche sociologique . DOI: 10.7202/1097414ar
- Babou, Igor. (2017) L’atelier politique de la nature. Questions de communication . DOI: 10.4000/questionsdecommunication.11423
- Hollister, Lucas. Posthumus, Stephanie. Simon, Anne. (2021) Conversation questions for Professors Anne Simon and Stephanie Posthumus. Contemporary French and Francophone Studies , 25. DOI: 10.1080/17409292.2021.1865051
- Chateauraynaud, Francis. Dubois, Cathy. (2019) Et si la climatologie devenait une science sociale comme les autres ? À propos du colloque « Entre connaissance et action : regards croisés sur les enjeux climatiques et environnementaux ». Natures Sciences Sociétés , 27. DOI: 10.1051/nss/2019022
- Pascual Espuny, Céline. (2022) La communication environnementale, au cœur des humanités environnementales. Questions de communication . DOI: 10.4000/questionsdecommunication.28993
- Ribac, François. Harkins, Paul. (2020) Popular Music and the Anthropocene. Popular Music , 39. DOI: 10.1017/S0261143019000539
- Grisoni, Anahita. Némoz, Sophie. (2017) Les mouvements socio-écologistes, un objet pour la sociologie. Socio-logos . DOI: 10.4000/socio-logos.3116
- González Besteiro, Ana. (2022) Political ecology, écologie politique, ecología política : les faux amis. Géocarrefour , 96. DOI: 10.4000/geocarrefour.17877
- Barthes, Angela. (2022) Quels enjeux des éducations environnementales et de développement durable entre transition écologique, urgence climatique et Anthropocène ?. Éducation relative à l'environnement . DOI: 10.4000/ere.9419
- Denayer, Dorothée. Bréda, Charlotte. (1969) Si le Loup y était... Quelles compétences humaines et animales sont instaurées dans l’anticipation d’une coexistence située ? (Région wallonne, Belgique). Anthropologica , 62. DOI: 10.3138/anth.2018-0098.r2
- Julienne, Clarine. (2018) La lutte contre l’ambroisie. Revue d'anthropologie des connaissances , 12. DOI: 10.3917/rac.040.0455
- Renou, Gildas. (2018) L’avenir de la socioéconomie écologique. Environnement et valeur au-delà du Yalta disciplinaire. Natures Sciences Sociétés , 26. DOI: 10.1051/nss/2019007
- Villalba, Bruno. (2020) À propos de quelques angles morts de la théorie politique environnementale. Approche critique à la lumière de la pensée de Günther Anders. VertigO . DOI: 10.4000/vertigo.26659
- Boisvert, Valérie. Carnoye, Leslie. Petitimbert, Rémy. (2020) « La durabilité forte : enjeux épistémologiques et politiques, de l’économie écologique aux autres sciences sociales ». Développement durable et territoires . DOI: 10.4000/developpementdurable.17502
- Bureau-Point, Eve. (2021) Pesticides et récits de crise dans le monde paysan cambodgien. Anthropologie et Santé . DOI: 10.4000/anthropologiesante.9054
Merci, nous transmettrons rapidement votre demande à votre bibliothèque.
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books . Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Le captcha ne correspond pas au texte.
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Référence numérique du livre
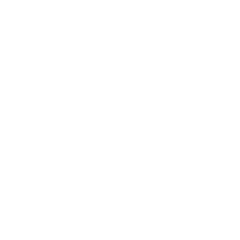
« Les défis contemporains du droit international : la protection des déplacés environnementaux » mémoire validé par OUEDRAOGO Aimé
Le samedi 13 Août 2022 s’est tenue à l’Université Privée de Ouagadougou, la soutenance de OUEDRAOGO Aimé. Pour l’obtention du diplôme de Master en Droit public fondamental, M. OUEDRAOGO s’est présenté au jury afin d’exposer son travail dont le thème est le suivant : Les défis contemporains du droit international : la protection des déplacés environnementaux.
D’entrée de jeu, l’impétrant, sur cette affirmation du GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés) qui explique que : « depuis la nuit des temps, des cas de dégradation de l’environnement ont occasionné des déplacements de populations », fait également le constat que la dégradation de l’environnement a atteint un niveau d’alerte maximal et les personnes déplacées, en raison, se comptent par millions à travers le monde. Le changement climatique et les catastrophes environnementales en sont les causes à travers les effets que sont, la montée du niveau de la mer, la sécheresse, la désertification, la tarification des eaux, les éruptions volcaniques et les ouragans. Ces diverses formes de manifestation de la dégradation de l’environnement ont conduit à des qualifications différentes de ses victimes dans le monde scientifique. Des concepts tels que « migrants environnementaux », « réfugiés climatiques », « réfugiés environnementaux » ont été employé par la doctrine pour désigner les victimes de la dégradation de l’environnement. En l’absence d’un concept légal, c’est le concept de « déplacés environnementaux » utilisé dans le projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux qui a retenu l’attention. C’est un concept qui prend en compte toutes les victimes des dégradations de l’environnement, et de surcroît, ne prête pas à confusion à la notion de « réfugiés » définie dans la Convention relative au statut de réfugié. S’il n’est pas faux que le concept des déplacés environnementaux ne fait pas l’unanimité au sein de la doctrine, il est, d’autant plus vrai, que les victimes des dégradations de l’environnement existent et ils ont besoin d’une protection internationale. Selon le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), il y aura environ un huitième de milliard de déplacés environnementaux à travers le monde d’ici à 2050.
Beaucoup d’approches doctrinales ont été proposés dans le cadre de la nécessité d’une protection des déplacés environnementaux. A cet effet, l’impétrant s’est posé la question de savoir, dans quelle mesure le droit international relève-t-il le défi de la protection des déplacés environnementaux ? Pour répondre à cette question principale, l’impétrant s’est posé deux questions secondaires. Tout d’abord, le droit international contemporain offre-t-il une protection aux déplacés environnementaux ? Ensuite, est-il nécessaire d’organiser une protection spécifique des déplacés environnementaux dans le droit international contemporain ?
Une thématique à double intérêt, constate-t-il, car l’étude permettra de réfléchir sur la protection internationale des déplacés environnementaux dans un contexte international marqué par de nombreuses ruptures environnementales entrainant les déplacements de populations mais également permettra de cerner les réalités et les manœuvres juridiques nécessaires liées à la protection des déplacés environnementaux en droit international. Nul besoin de rappeler que la prise en compte d’une telle question est essentielle dans les réformes en cours du droit international.
Une étude comparative des instruments internationaux et sous-régionaux de protections des personnes a permis à l’impétrant de mieux appréhender la problématique susmentionnée.
Les résultats de la recherche ont permis à l’impétrant de dégager les points suivants, à savoir : l’absence d’une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux d’une part et la nécessité d’une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux d’autre part.
Pour ce qui est du premier point, l’impétrant souligne que l’absence d’une protection internationale trouve ses racines dans l’inexistence du statut international des déplacés environnementaux et dans l’insuffisance des instruments internationaux de protection des personnes. Cette absence s’établit dans le droit international général ainsi que dans le droit international spécial.
Dans le droit international général, l’inexistence du statut des déplacés environnementaux se démontre dans le droit international général conventionnel et dans le droit international général non-conventionnel. Dans le droit international général non-conventionnel, il n’y pas de pratique convergente qui se dégage du comportement des Etats pouvant permettre la reconnaissance d’un statut des déplacés environnementaux dans la coutume internationale. Il en est de même, de l’absence de solutions nationales convergentes pouvant établir l’existence d’un tel statut du côté des principes généraux de droit international.
En ce qui concerne le droit international spécial, l’inexistence du statut des déplacés environnementaux est plus établie dans le droit international de l’environnement au regard du lien étroit entre la question de la protection des déplacés environnementaux et cette branche. Le caractère spécifique d’importants instruments conventionnels et d’instruments non conventionnels de protection de l’environnement démontre qu’aucun de ces instruments ne prête le flanc à l’existence d’un statut international des déplacés environnementaux.
Hormis l’inexistence de leur statut, l’insuffisance matérielle des instruments internationaux de protections des personnes justifie l’absence de protection internationale des déplacés environnementaux, constate par ailleurs l’impétrant. Dans le droit international général, en ce qui concerne le droit international général conventionnel, cette insuffisance s’explique par l’absence de règles consacrées à la protection des déplacés environnementaux, le caractère exclusif des règles de protections existantes, et la présence des facteurs limitants de l’évolution du droit international comme la souveraineté des Etats. Dans le droit international général non-conventionnel, la difficulté de la preuve et le manque d’intérêt des Etats traduisent respectivement l’insuffisance de la coutume internationale et les principes généraux de droit international à la protection des déplacés environnementaux. Concernant la jurisprudence internationale, le silence du juge international et la réponse mythique du comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire TETIOTA démontrent son insuffisance à la protection des déplacés environnementaux. En ce qui concerne le droit international spécial, son insuffisance à la protection des déplacés environnementaux, trouve son fondement dans l’insuffisance matérielle des instruments de protections issues des branches spécialisées et dans leur mise en œuvre. Ces instruments sont soit, inadaptés parce qu’adoptés dans de contextes différents de celui du phénomène des déplacements environnementaux, soit inapplicable aux déplacés environnementaux en raison du caractère exclusif de leur objectif. De leur côté, les institutions de mise en œuvre du droit international, comme le PNUE, ne disposent pas de mécanismes leur permettant de prendre en compte la question de la protection des déplacés environnementaux.
Pour ce qui est de la nécessité d’une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux, l’impétrant souligne cette position de Norman MEYER à savoir que « Nous ne pouvons, cependant, pas continuer à ignorer les déplacés environnementaux, simplement parce qu’il n’y a pas de mode institutionalisé de les aborder ». L’adoption d’une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux trouve sa raison d’être dans sa nécessité et dans sa possibilité.
La nécessité d’adopter cette protection internationale s’explique par des considérations humanitaires et des considérations juridiques. Les considérations humanitaires se fondent sur les constatations des violations des droits humains par la dégradation de l’environnement. En ce qui concerne les considérations juridiques, la protection des déplacés environnementaux permet de combler un vide juridique du droit international et de garantir des droits à la nouvelle catégorie de personnes. A travers le processus de la catégorisation des déplacés environnementaux, leur qualification juridique permet de déterminer le régime juridique qui leur est applicable. Cela permet de protéger les déplacés environnementaux en garantissant leurs droits communs et particuliers grâce au Pacta Sunt Servanda du droit international.
A cet égard, deux modalités permettent d’envisager une telle protection. Il s’agit de la réforme des instruments internationaux de protections qui existent, et l’élaboration de nouveaux instruments spécifiques de protections.
Comme perspectives, l’impétrant précise qu’il semble judicieux de pratiquer une opération juridique sur le droit international qui va permettre d’offrir une protection internationale suffisante aux déplacés environnementaux à travers une convention spécifique. Ce processus pourra aboutir, plus tard, à la naissance effective d’un droit international des déplacés environnementaux.
Le jury a, à l’unanimité après l’exposé du travail, apprécié l’originalité du thème ainsi que sa pertinence. La qualité rédactionnelle du document, qui est agréable à lire, a été reconnue. Le jury, composé du Pr Mathieu NAMOUNTOUGOU en sa qualité de Président du jury, du Dr Alexis NAGALO en tant que rapporteur et du directeur de mémoire en la personne du Pr Vincent ZAKANE, a finalement sanctionné l’impétrant de la note de 16/20 en plus des félicitations des membres du jury.
ZOMA Michel
revuejuris.net
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Sur cette question, v. not. notre contribution : Y. Petit, « Le changement climatique et la sécurité internationale », in R. Kherad (dir.), La sécurité humaine.Théorie(s) et pratique(s), Pedone, 2010, p. 193-209 ; le débat public que le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu le 17 avril 2007 à la demande du Royaume-Uni sur le thème « Energie, sécurité et climat », S/PV.5663 ; la ...
En outre, si le juge national demeure le juge de droit commun du respect du droit international, il intervient encore peu à cet effet. Les procès climatiques pourraient toutefois créer un élan et favoriser à l'avenir l'implication du juge national dans le renforcement de l'effectivité du droit international de l'environnement.
Dissertation - 5 pages - Droit de l'environnement. Le principe de précaution est « Au carrefour de la philosophie, du droit et des sciences ». C'est ce que montre le magistrat retraité, Norbert Calderaro, dans son livre publié en 2015. Ce principe désigne « l'absence de certitude qui, compte tenu des connaissances scientifiques, ne doit ...
Ce dossier présente une réflexion sur certaines conditions d'application et d'effectivité du droit international de l'environnement. Cette amorce d'analyse a été menée par Mounir EL AJJOURI, juriste et doctorant en droit international de l'environnement.. La sauvegarde de l'environnement peut être entendue dans une perspective la dépassant, en considérant l'adaptation du ...
Le premier cours, Introduction au droit international de l'environnement, est desti-né à offrir une vue d'ensemble du sujet. Le cours retrace l'évolution du droit international de l'environnement, étudie les sources de ce droit et les procédures de création du droit, et expose les principes fondamentaux du droit international de l ...
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et instruments connexes Différends maritimes Chapitre XIV. Droit international de l'environnement Développement et environnement Protection de l'atmosphère et changements climatiques Diversité biologique Activités et substances dangereuses Désertification Chapitre XV. Cours d'eau ...
La mise en ˇuvre du droit international de lÕenvironnement 6 Institut du d"veloppement durable et des relations internationales Convention de Ramsar relative aux zones humides, parfois consid"rables, comme dans le cas du Protocole de Kyoto sur le changement climatique. Cet article souligne "galement la diff"rence de conception
Le défi actuel du droit de l'environnement, qu'il soit national ou international, n'est ignoré de personne : renforcer son application là où elle est timide et permettre celle-ci là où elle ne l'est pas encore. Pour contribuer à relever ce défi dans un pays comme le Mali, il n'est pas inutile, dans un contexte de pluralisme juridique très accentué, de questionner les ...
Droit international de l'environnement, point d'étape. 1 Si les intérêts des générations futures l'emportent rarement au plan national, ils ont trouvé dans l'alchimie des négociations internationales un cadre propice à leur reconnaissance. Aujourd'hui, cette dynamique est entravée.
La présente thèse est consacrée à l'étude de la portée du droit à un environnement sain en droit international. Ce droit de l'Homme est appréhendé comme étant le résultat d'interactions entre le droit international des droits de l'Homme et le droit international de l'environnement ainsi qu'entre différents ensembles normatifs de protection des droits de l'Homme. Ce ...
Droit international de l'environnement. Étude des régimes juridiques élaborés par les États pour protéger l'environnement sur le plan international. Étude des sources, des principes fondamentaux et de la responsabilité des États en matière d'environnement. Rôle du droit international dans la prise en compte des rapports entre le ...
En détail. Le droit international de l'environnement est le domaine du droit international qui vise à défendre et promouvoir l'environnement. Il repose sur un principe de solidarité au nom de la protection du bien commun que représente l'environnement au sens large, pour les générations actuelles et futures. Il est donc avant tout ...
La pollution est un des sujets phares du droit de l'environnement, puisque tous les pays du monde veulent la combattre afin de pouvoir la réduire au maximum.. Problématique : en quoi la gestion de la pollution est-elle une constante dominante du droit de l'environnement ?. Le candidat définira d'abord les notions d'une manière approfondie, en mettant en avant les diverses règles ...
En droit international de l'environnement, on ne peut pas parler du principe de souveraineté étatique absolue. Dans le contexte des problèmes environnementaux globaux, l'interdépendance écologique ne permet pas l'imperméabilité du territoire, ce qui a des impacts sur l'exercice de la souveraineté de l'État.
6 DEEC : Droit européen de l¶environnement et du climat DICC : Droit international des changements climatiques DIE: Droit International de l¶Environnement DIP: Droit International Public ou DPI : Droit Public International DPSP : Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches DTS: Droits de Tirages Spéciaux EPEEC : Equipe Pluridisciplinaire d'Etude de l'Environnement Côtier
Sans aucun conteste, l'environnement constitue désormais, en droit interne comme en droit international, un objet du droit. Un impressionnant arsenal législatif et réglementaire en témoigne. Le caractère prescriptif - et non descriptif - de la norme conduit le législateur à faire des choix qui orientent et contraignent les comportements humains et qui donnent à la définition de ...
Cet article explique comment les règles du droit international applicables à des problèmes transversaux peuvent combiner avec bonheur les compétences existantes et les forces institutionnelles de différentes branches du droit international applicables simultanément. Il étudie également comment les divers cadres de référence utilisés par ceux qui travaillent dans les différents ...
L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement ... L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement. Actes de la réunion constitutive du comité sur l'environnement de l'AHJUCAF, Jun 2008, Porto-Novo, Bénin. pp.291-301. �hal-00499293� ...
Revue libre de Droit U. K. KIANGUEBENI La protection de l'environnement et le développement durable : limites normatives et institutionnelles 35 1 - Les Origines de la protection de l'environnement Le droit de l'environnement est le domaine du droit qui vise à défendre et à promouvoir l'environnement.
de vue selon lesquels la responsabilité dans le droit international a les mêmes sources que d'autres types de responsabilité sociale, à savoir le devoir moral devant la société3. La spécificité principale de la responsabilité internationale est liée aux particularités du droit international et de ses sujets principaux- Etats souverains.
Le samedi 13 Août 2022 s'est tenue à l'Université Privée de Ouagadougou, la soutenance de OUEDRAOGO Aimé. Pour l'obtention du diplôme de Master en Droit public fondamental, M. OUEDRAOGO s'est présenté au jury afin d'exposer son travail dont le thème est le suivant : Les défis contemporains du droit international : la protection des déplacés environnementaux. […]
Michel Prieur. L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement. Actes de la réunion constitutive du comité sur l'environnement de l'AHJUCAF, Jun 2008, Porto-Novo, Bénin. pp.291-301. hal-00499293
35 Que le droit à l'environnement ne puisse s'inscrire parmi les droits de l'homme ne signifie pas qu'il n'existe par un droit international de l'environnement. Le noyau dur de ce droit porte sur les dommages présentant un caractère transfrontière ainsi que sur les « trafics » liés à la protection de la nature : le trafic d'espèces ...
Une prise de position inédite qui devrait faire jurisprudence dans le droit climatique international en construction. Les juges du Tribunal international du droit de la mer lors de la lecture de ...